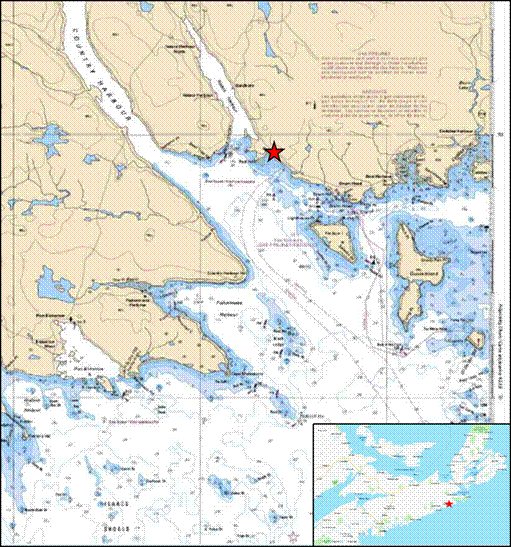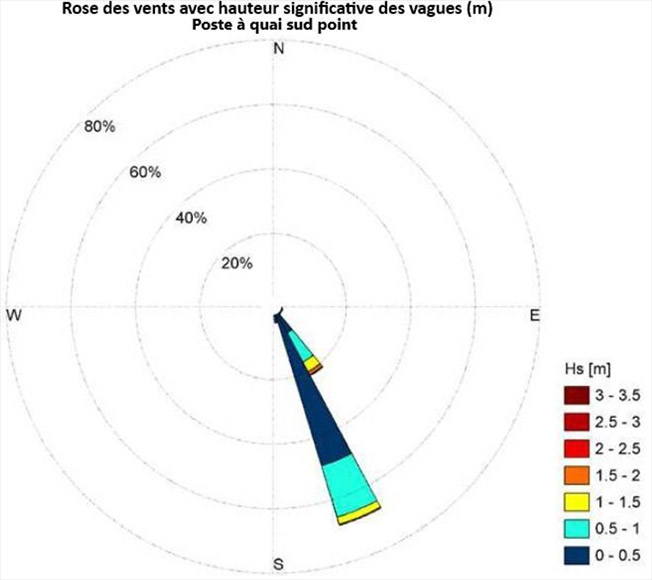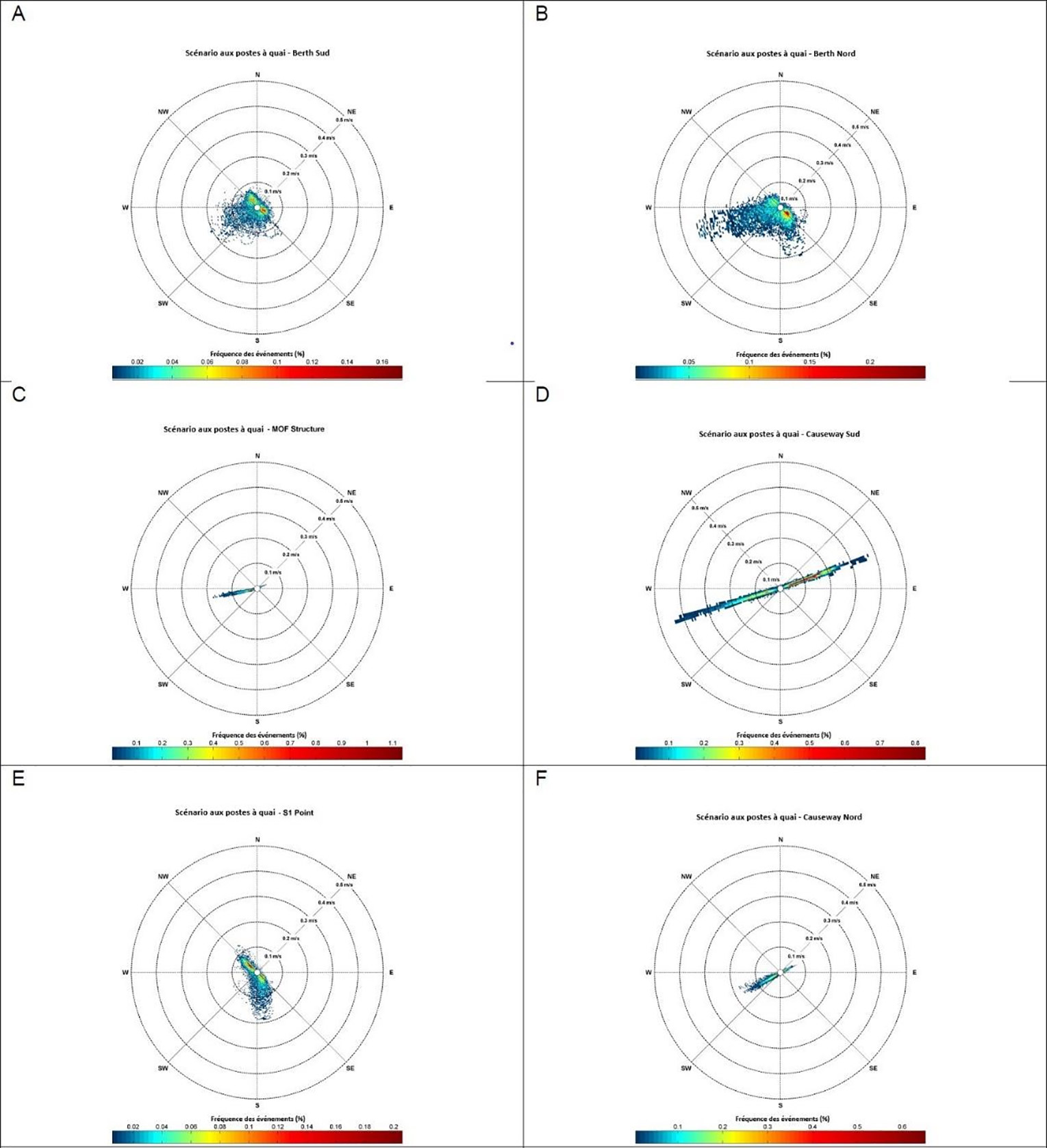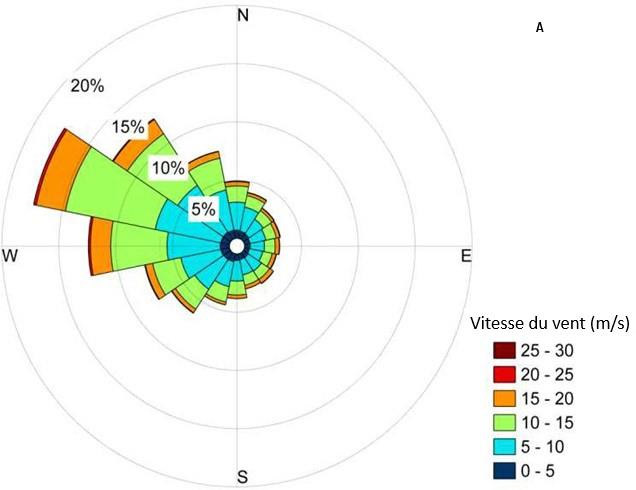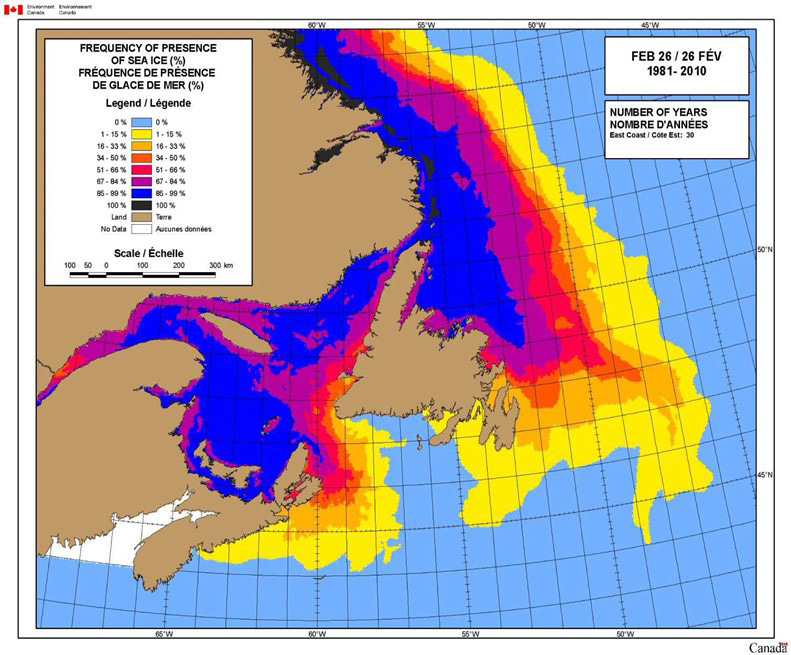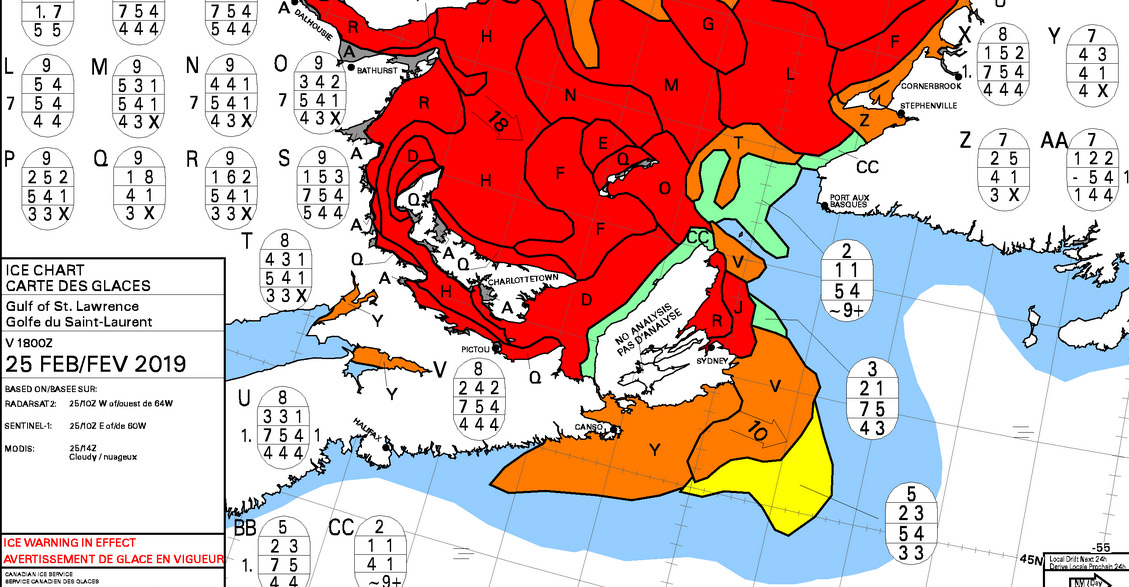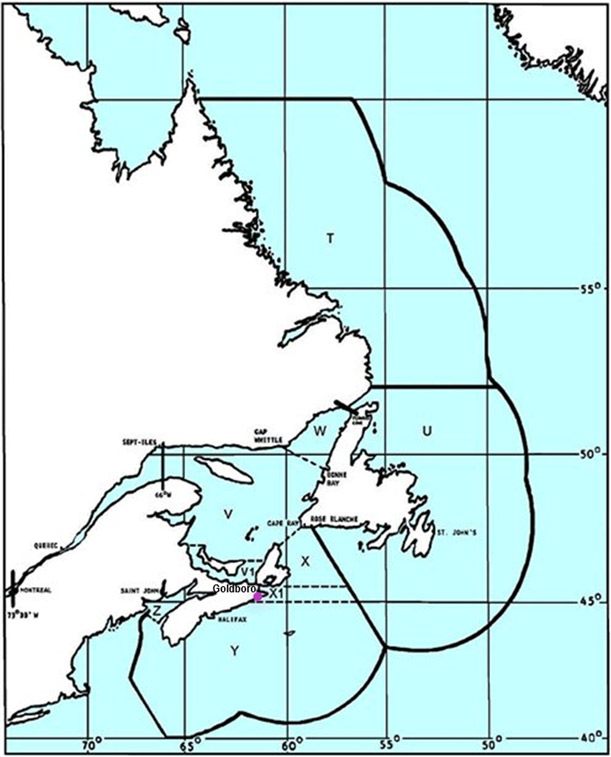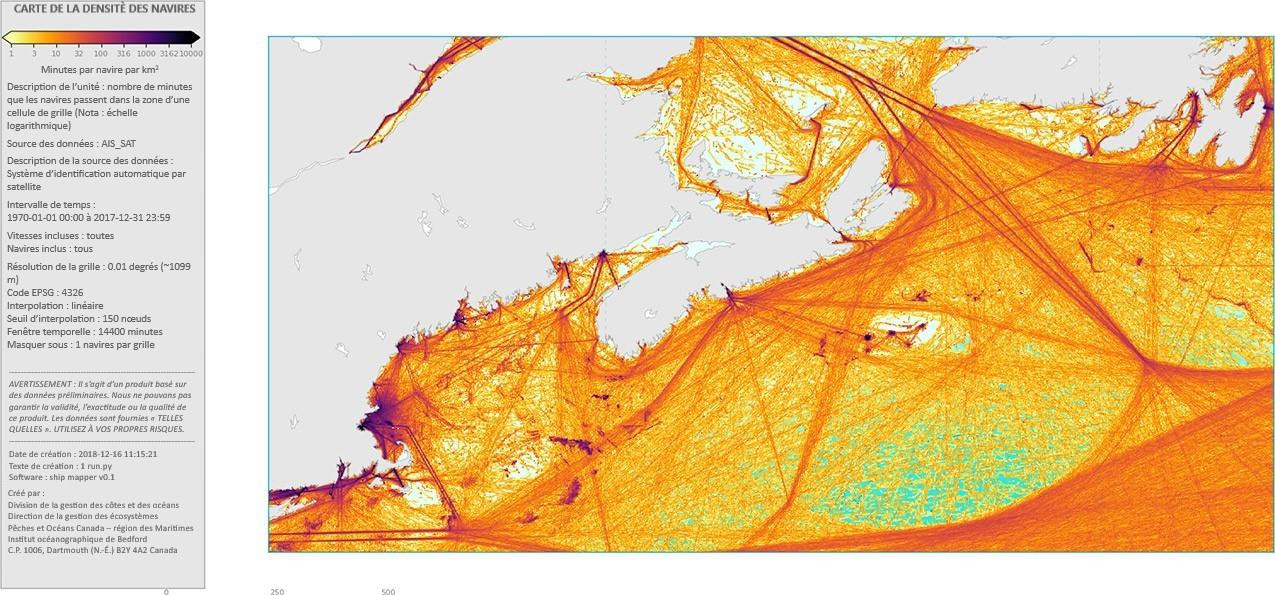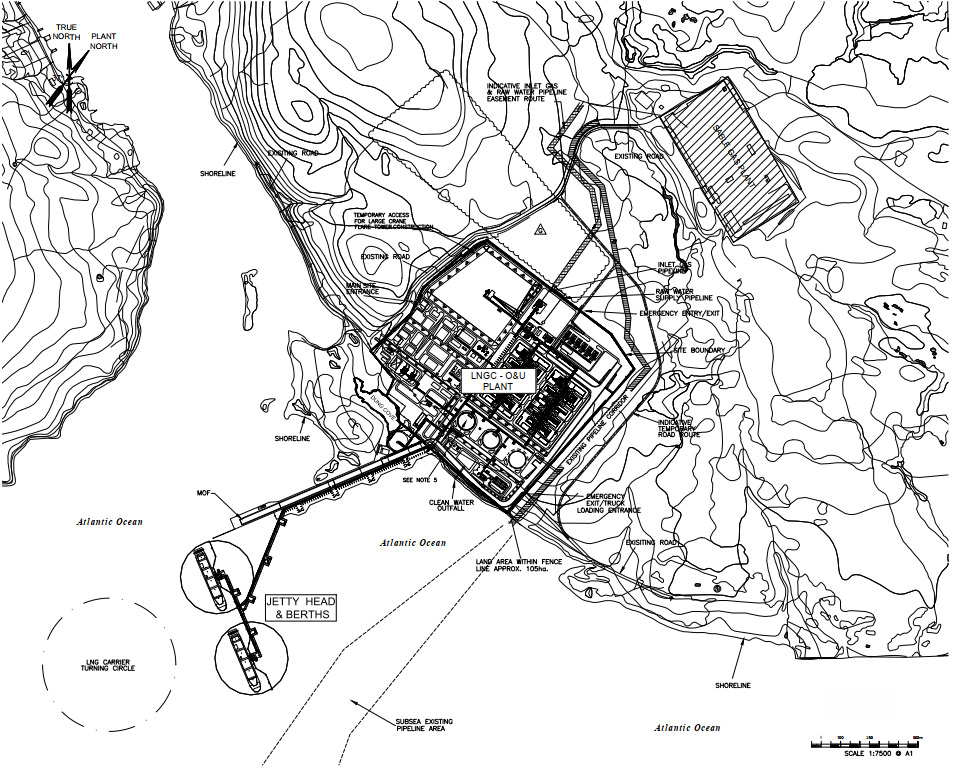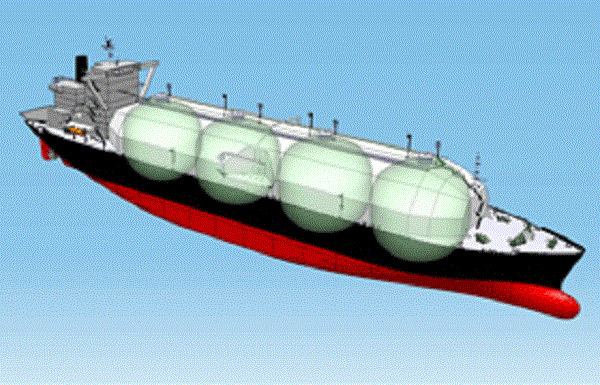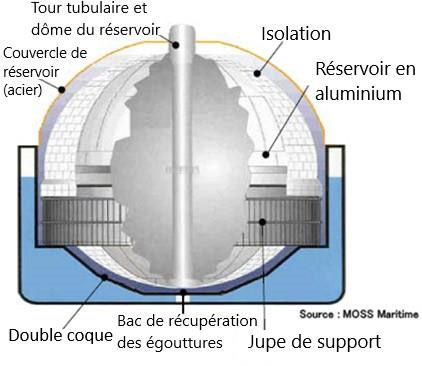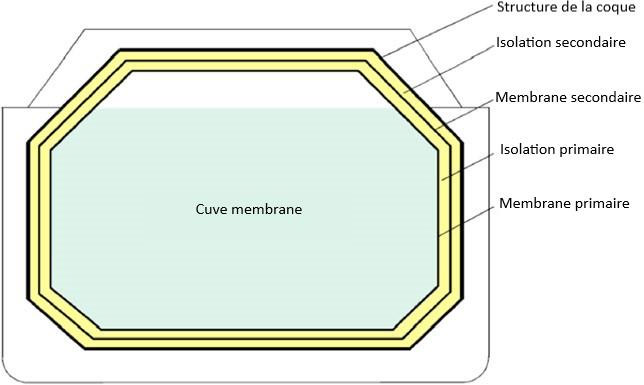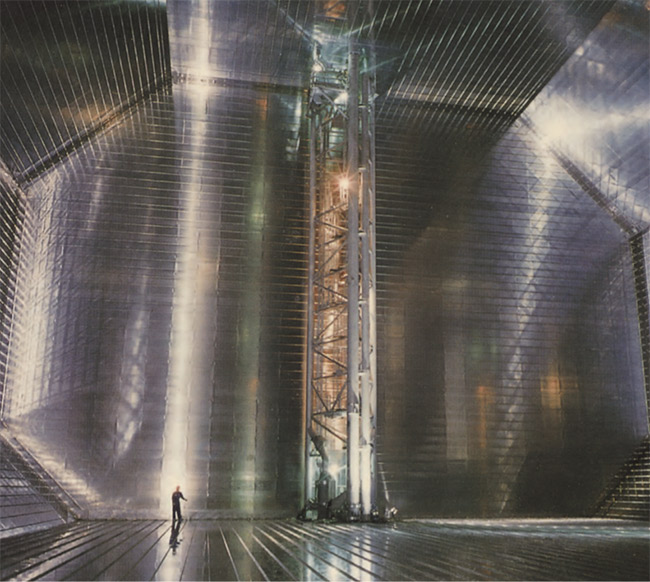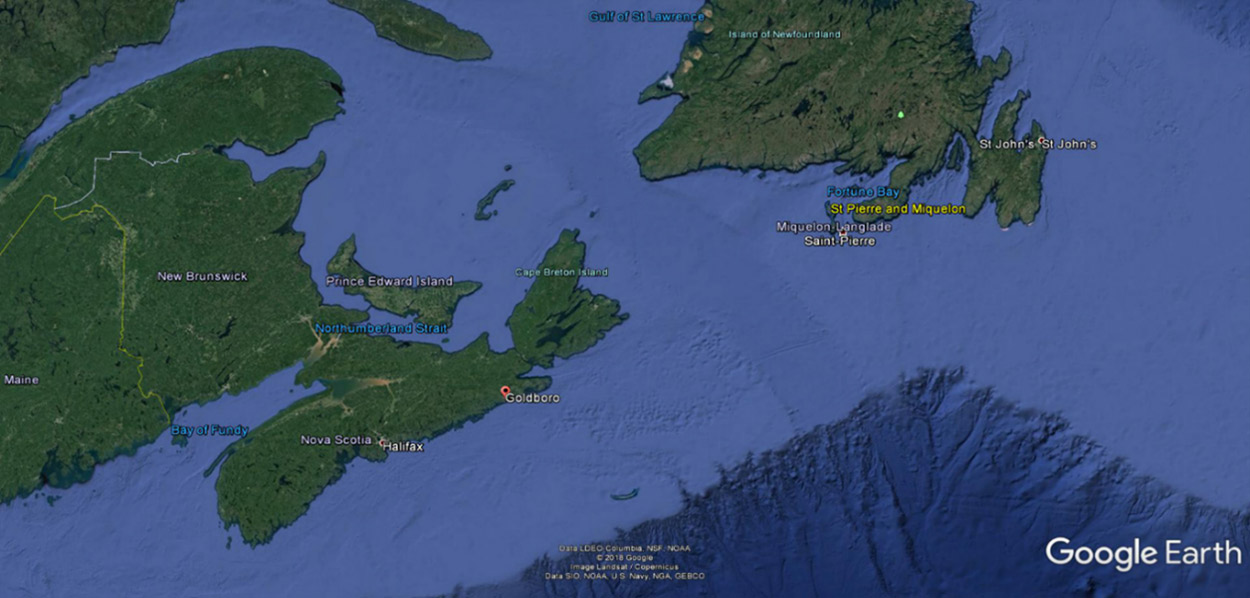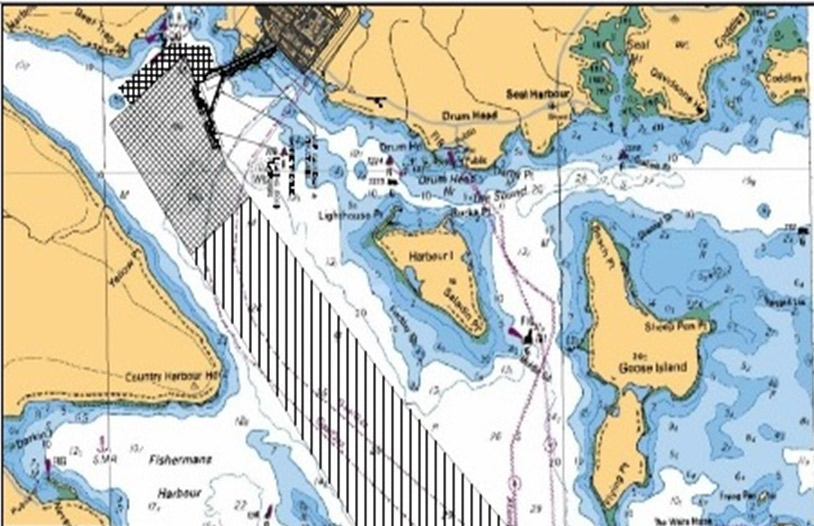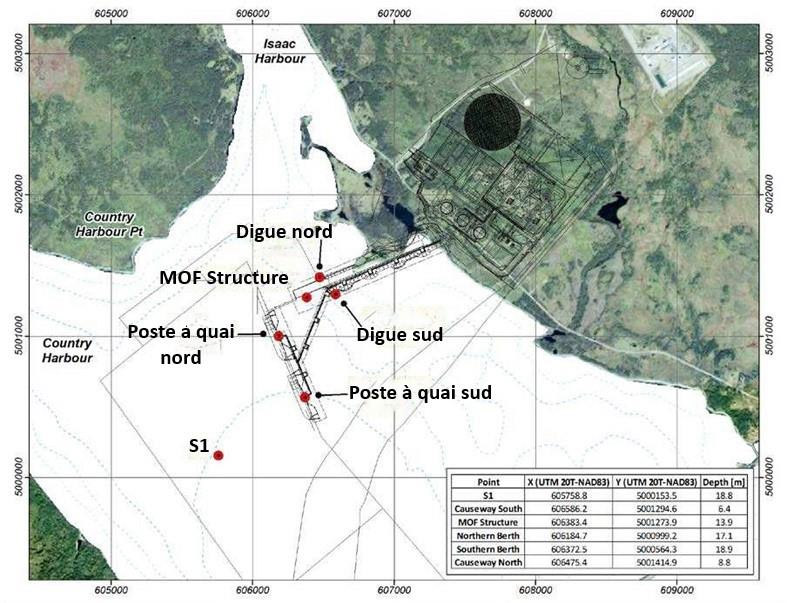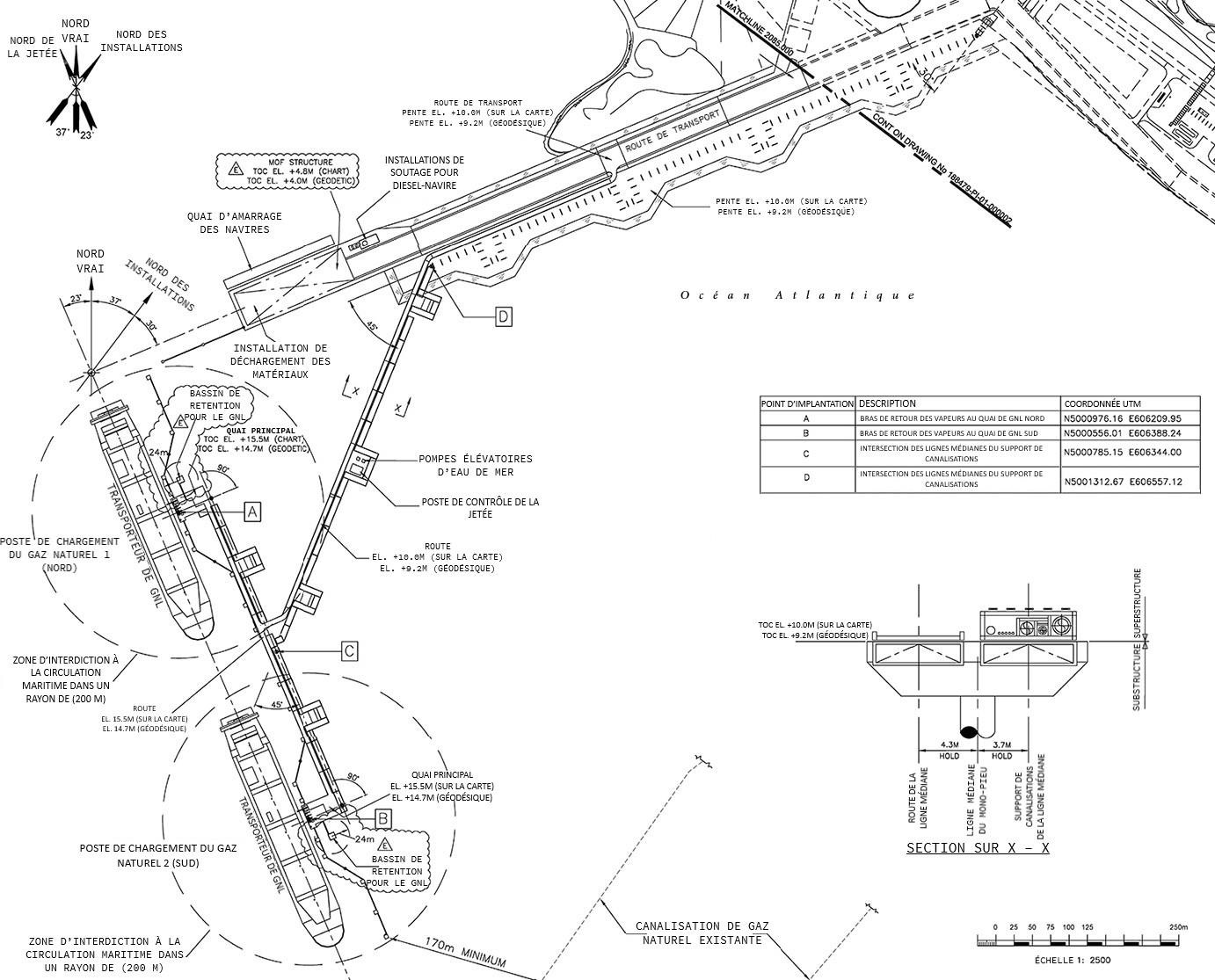Ce rapport présente les opinions du Comité d'examen TERMPOL (CET) qui a examiné la proposition de projet et rédigé le rapport. Les conclusions et recommandations du rapport d'examen TERMPOL ne dégagent pas Pieridae Energy Limited, Goldboro LNG Limited [Goldboro GNL] et les navires associés au projet de leur obligation de respecter pleinement toutes les exigences législatives et réglementaires en vigueur, avec leurs modifications successives, qui s'appliquent à la sécurité de la navigation et à la protection de l'environnement.
Sur cette page
- Preambule
- Sommaire executif
- 1.0 Introduction
- 2.0 Participation autochtone
- 3.0 Analyse
- 4.0 Conclusion
- Annexe 1 : Conclusions et recommandations
- Annexe 2 : Documents soumis au processus d'examen TEMPOL
- Annexe 3 : Conception des navires
- Annexe 4 : Information sur les terminaux et la navigation
- Annexe 5 : GNL Goldboro – étude de simulation de navigation
- Annexe 6 : Glossaire
- Annexe 7 : Acronymes et abréviations
- Annexe 8 : Liste de références
Preambule
Le rapport d'examen TERMPOL sur le projet Goldboro GNL a été réalisé par des représentants des services et autorités suivants
- Transports Canada :
- La sûreté et la sécurité maritimes Note de bas de page 1
- Environnement et changement climatique Canada :
- Programmes d'évaluation environnementale et programmes marins
- Ministère des Pêches et des Océans :
- Garde côtière canadienne
- Service hydrographique du Canada
- Gestion des océans et des zones côtières
- Administration de pilotage de l'Atlantique
- Comté de Guysborough
Veuillez noter que ce rapport d'examen TERMPOL ne constitue pas une déclaration de politique gouvernementale. Ne présumez pas que le gouvernement approuve le projet proposé en tout ou en partie. Ce rapport présente les opinions du Comité d'examen TERMPOL (CET) qui a examiné la proposition de projet et rédigé le rapport.Note de bas de page 2
Les conclusions et recommandations du rapport d'examen TERMPOL ne dégagent pas Pieridae Energy Limited, Goldboro LNG Limited [Goldboro GNL] et les navires associés au projet de leur obligation de respecter pleinement toutes les exigences législatives et réglementaires en vigueur, avec leurs modifications successives, qui s'appliquent à la sécurité de la navigation et à la protection de l'environnement.
Julie Gascon
Directrice générale
Sûreté et sécurité maritimes
Transports Canada
Sommaire exécutif
Pieridae Energy (Canada) Ltd. (Pieridae, le promoteur) propose de développer et d'exploiter une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) pour le stockage et l'exportation à un site de Country Harbour, dans le comté de Guysborough, près de Goldboro, en Nouvelle-Écosse.
La conception de Pieridae pour cette installation permettra d'accoster des navires de GNL d'une capacité de fret allant jusqu'à 266 000 m3 Note de bas de page 3. Cette opération se traduira par l'exportation d'environ 9,6 millions de tonnes de GNL par an (MTPA)Note de bas de page 4, avec un maximum de 206 navires de GNL arrivant au port du Country Harbour chaque année (7 à 13 expéditions par mois)Note de bas de page 5. Pieridae ne prévoit pas de modifications des routes maritimes existantes ni de disposer de navires GNL d'une capacité dépassant 266 000 m3.
Transports Canada (TC) dispose d'un processus volontaire d'examen technique des systèmes de terminaux maritimes et des sites de transbordement que l'on appelle TERMPOLNote de bas de page 2. Il évalue les risques de navigation liés à la mise en place et à l'exploitation de terminaux maritimes pour les pétroliers transportant du pétrole en vrac, des produits chimiques, du gaz liquéfié et d'autres cargaisons dangereuses. Un CET se sert du processus d'examen pour évaluer les projets proposés.
En 2014, après avoir reçu une autorisation d'évaluation environnementale dans le cadre du régime d'examen environnemental de la province de Nouvelle-Écosse, Pieridae a demandé un examen TERMPOL à TC. L'approbation de la N.-É. était sous réserve du respect de certaines conditions, notamment de se soumettre à un examen TERMPOL et de mettre en œuvre toutes les recommandations.
Un CET a été établi avec des membres de TC, de Pêches et Océans Canada (MPO), d'Environnement et Changement climatique Canada (ECC), de l'Administration de Pilotage de l'Atlantique (APP) et du Comté de Guysborough. Ils ont défini la portée de l'examen et ont demandé à Pieridae de soumettre des études qui pourraient aider à démontrer comment elle pourrait réaliser les composantes de transport maritime du projet en toute sécurité, compte tenu des lois et règlements canadiens en vigueur, de meilleures pratiques de l'industrie, des programmes et services maritimes.
En 2016, Pieridae a présenté une Note de bas de page 6 étude préparée par Amec Foster Wheeler comme partie de sa soumission. Afin de faciliter la préparation d'autres études dans le cadre de la soumission, Pieridae a chargé HR Wallingford Ltd. de réaliser une analyse générale des risques et des simulations de manœuvres de navires.
Le 26 juillet 2018, Pieridae a soumis le rapport d'information visant à satisfaire aux exigences du TERMPOL pour l'installation d'exportation de GNL de Goldboro au CETNote de bas de page 7. La soumission comportait les informations suivantes :
| 3.1 | Introduction |
| 3.2 | Enquête du trafic maritime |
| 3.3 | Enquête des itinéraires, des abords caractéristiques et de la navigabilité |
| 3.4 | Enquête spécifique sur le dégagement sous quille |
| 3.5 | Enquête sur les temps de transit et les retards |
| 3.6 | Enquête sur les données relatives aux accidents |
| 3.7 | Spécifications du navire |
| 3.8 | Schémas et données techniques du site |
| 3.9 | Systèmes de transfert et de transbordement des cargaisons |
| 3.10 | Éléments de chenal, de manœuvre et d'ancrage. |
| 3.11 | Procédures et dispositions en matière d'amarrage |
| 3.13 | Analyse globale des risques et méthodes envisagées pour les réduire |
| 3.14 | Aperçu du Livre d'information sur les ports |
| 3.15 | Aperçu du Manuel d'exploitation des terminaux |
| 3.16 | Planification d'urgence |
| 3.18 | Considérations sur les matières dangereuses et nocives |
Les membres du CET ont également participé aux simulations de manœuvre de navires à Howbery Park, Wallingford, au Royaume-Uni. Le dernier rapport, Goldboro GNL, Étude de simulation de navigation, a été soumis au CET le 2 avril 2019.
Le comité a étudié la proposition de Pieridae en tenant compte de leurs mandats respectifs, des autorités de régulation, des responsabilités et de l'expertise.
Le comité souhaite que le projet respecte toutes les exigences légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité maritime et de protection de l'environnement. Plusieurs mesures de sécurité réglementaires ont été mises en place au Canada pour assurer que les grands navires qui entrent dans les eaux canadiennes respectent les exigences internationales et canadiennes, et qu'ils ne présentent pas de risque pour la sécurité ou l'environnement. Conformément à ces exigences, les terminaux maritimes, les navires de GNL et leurs opérations, y compris celles prévues pour l'installation de Pieridae à Goldboro, doivent satisfaire aux exigences de sécurité et de protection de l'environnement définies dans les accords internationaux et le régime réglementaire canadien en matière de sécurité maritime lorsqu'ils se trouvent dans les eaux relevant de la juridiction canadienne.
Les exigences canadiennes et internationales portent notamment sur les domaines suivants :
- Une conception et une construction sécuritaires des navires, y compris des exigences relatives aux effectifs de sécurité
- Qualifications et formation de l'équipage
- Conditions de travail
- Systèmes de gestion de la sécurité
- Équipement de radiocommunication
- Équipement pour la navigation en toute sécurité, y compris les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) et les systèmes d'identification automatique (SIA)
- Planification de voyage
- Notification des navires
- Règlements visant à prévenir les collisions
Les transporteurs de GNL devront en outre suivre le processus d'acceptation des navires et les procédures des terminaux de Pieridae.
Bien que tout projet présente un certain degré de risque, le CET n'a pas identifié de préoccupations majeures concernant les transporteurs de GNL de Pieridae, les opérations, la route proposée, la navigabilité, les autres utilisateurs des voies navigables ou les opérations du terminal maritime. Après avoir examiné la soumission de Pieridae, le CET a fait 52 recommandations et a proposé des actions à entreprendre par Pieridae Energy Ltd avant que le terminal proposé ne devienne opérationnel. Conjointement avec les engagements de Pieridae, ils assureront un niveau de sécurité plus élevé pour les opérations des navires GNL.
Bien que le CET ne considère pas que l'augmentation du trafic maritime soit une question de sécurité, il est en faveur de mesures supplémentaires qui sont conformes aux meilleures pratiques des terminaux GNL pleinement opérationnels, y compris l'installation GNL de Saint John, NB. Ces dernières comprennent :
- Application d'un contrôle approfondi et de critères de compatibilité avant d'autoriser un navire à entrer dans le terminal
- Utilisation de remorqueurs ayant les caractéristiques adéquates pour escorter les transporteurs de GNL jusqu'à leurs postes d'amarrage et à partir de ceux-ci
- Définition de critères environnementaux limitatifs pour les arrivées, les départs et le transfert de marchandises
- Mise à jour des cartes marines du SHC pour la zone avant le début des opérations en terminal
- Demander à tous les pilotes maritimes brevetés de la région de suivre une formation par simulation ou un entrainement à la manœuvre sur modèles avant le début des opérations du terminal
- Envisager des zones de sécurité autour des transporteurs de GNL et du terminal pour un meilleur niveau de sécurité pour les navires, les vies et les biens à proximité. Cela correspond aux meilleures pratiques en vigueur dans des terminaux GNL similaires et pleinement opérationnels.
Toutes les conclusions et recommandations du CET sont énumérées à l'Annexe 1.
1.0 Introduction
1.1 Contexte et description du project
En 2014, après avoir examiné l'évaluation environnementale soumiseNote de bas de page 8 par Pieridae, le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse a approuvé le projet de GNL Goldboro, sous réserve de plusieurs conditions.
La condition 2.11 de l'évaluation environnementale est la suivante :
« L'achèvement du processus de révision du TERMPOL en consultation avec TC, Sûreté et sécurité maritime (SSM), afin d'évaluer de manière adéquate les risques concernant le terminal maritime de GNL de Goldboro.
Le titulaire de l'agrément doit se conformer à toutes les recommandations du processus d'examen TERMPOL, à l'exception de celles qui ont été approuvées par le NSE ».
Pieridae a commencé un processus de révision TERMPOL avec TC en novembre 2013 et a convenu de la portée et de la nature des études. Pieridae a fourni la dernière partie de cette soumission le 2 avril 2019.
Le 31 octobre 2018, la Nova Scotia Utility and Review Board a octroyé un permis pour la construction d'une installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Goldboro, en Nouvelle-Écosse, sous réserve de certaines conditions, notamment la délivrance de copies des permis et des approbations d'autres autorités.
Dans le cadre du projet Goldboro GNL (le projet), Pieridae envisage de construire et d'exploiter une installation et un terminal maritime pour le stockage et l'exportation de GNL.
Le GNL est du gaz naturel à l'état liquide. Il est principalement composé de méthane, mais il contient également des hydrocarbures plus lourds et des traces d'autres composés. Une fois refroidi à environ -160 °C, à la pression atmosphérique, le gaz naturel devient un liquide clair, incolore et inodore. Le GNL est cryogénique, non corrosif et non toxique. Le processus de conversion du GNL en liquide permet d'éliminer l'eau, l'oxygène, le dioxyde de carbone et les composés sulfuriques du gaz naturel. À l'état liquide, le volume de gaz naturel est réduit de 600 fois, ce qui facilite son transport à l'étranger. Après le transport, le GNL est réchauffé et retransformé en gazNote de bas de page 9 .
L'Organisation maritime internationale (OMI) classifie le GNL comme une substance dangereuse et nocive (SNPD). L'OMI considère comme SNPD toute substance autre que les hydrocarbures dont le rejet dans le milieu marin est susceptible de nuire à l'homme, aux ressources vivantes et à la vie marine ou d'entraver d'autres utilisations de la merNote de bas de page 10. TC a retenu la définition du GNL comme substance dangereuse et nocive dans ce rapport.
Si le projet se réalise, l'installation de Goldboro GNL exportera jusqu'à 10 MTPA de GNL et sera capable de charger des navires de 125 000 m3 à 266 000 m3. Goldboro GNL va :
- Recevoir du gaz naturel par un gazoduc dédié.
- Liquéfier le gaz.
- Stocker le GNL sur place.
- Charger le GNL sur des transporteurs de GNL.
- Expédier le GNL dans le monde entier.
Les transporteurs de GNL qui vont s'amarrer à l'installation de Goldboro seront des navires-citernes affrétés, appartenant à des propriétaires indépendants. Les propriétaires des transporteurs de GNL seront chargés de s'assurer que les navires sont sécuritaires.
En opérant dans les eaux relevant de la juridiction canadienne, les transporteurs de GNL doivent également respecter toutes les réglementations. De plus, les transporteurs de GNL devront respecter le processus d'acceptation des navires et les procédures du terminal propres à Pieridae.
L'aménagement proposé du terminal, tel que détaillé dans la soumission, sera composé d'une chaussée allant de la rive à deux postes d'amarrage. Les postes d'amarrage sont conçus pour accueillir deux transporteurs de GNL :
- Le poste d'amarrage 1 (nord) peut recevoir des navires d'une capacité de 125 000 m3 à 266 000 m3.
- Le poste d'amarrage 2 (sud) peut recevoir des navires d'une capacité de 125 000 m3 à 220 000 m3.
Vous pouvez consulter l'aménagement proposé à la Section 3.3.1 et l'Annexe 4.
1.2 Processus d'examen TERMPOL
TERMPOL désigne le processus d'examen technique des systèmes de terminaux maritimes et des sites de transbordement. Les directives TERMPOL sont présentées dans le Processus de révision TERMPOL, version de 2014 (TP 743).Note de bas de page 2
TERMPOL est un processus d'examen sur une base volontaire pour les entreprises (promoteurs) qui désirent construire et exploiter un terminal maritime pour la manutention en vrac de pétrole, de produits chimiques et de gaz liquéfiés. Cet examen est axé sur les parties d'un projet relatives au transport maritime (c'est-à-dire lorsqu'un navire pénètre dans les eaux canadiennes, navigue dans des chenaux, s'approche des postes d'amarrage d'un terminal maritime et charge ou décharge du pétrole, du gaz ou des produits chimiques en vrac).
L'objectif de ce processus est de perfectionner les parties d'une proposition qui risquent, dans certaines circonstances, d'endommager la coque d'un navire pendant la navigation ou le transfert de la cargaison au terminal.
Un promoteur doit soumettre les études TERMPOL définies dans le processus d'examen TERMPOL, version de 2014, TP 743, afin de :
- Identifier les risques majeurs dans le cadre de l'exploitation proposée.
- Évaluer les risques liés à ces dangers.
- Identifier les manières de réduire les risques à un niveau acceptable en recourant aux meilleures technologies et pratiques disponibles.
Tout au long du processus d'examen technique, un promoteur travaille avec un CET présidé par TC qui est composé de membres de ministères et d'autorités ayant une expertise ou des responsabilités pertinentes.
Le CET examine la proposition et évalue :
- Les études, enquêtes et données techniques fournies à l'appui du TP 743.
- Les réglementations nationales et internationales actuelles et anticipées pour assurer la sécurité de l'exploitation des navires.
- Les activités actuelles de transport maritime le long de l'itinéraire proposé.
Le promoteur examine une gamme de sujets, notamment :
- La sécurité de la navigation sur le(s) itinéraire(s) du navire
- Les services qui contribuent à la sécurité de la navigation, tels que :
- les aides fixes et flottantes
- les services de trafic maritime
- les systèmes électroniques de positionnement
- Les exigences en matière de pilotage, d'escorte par remorqueur et de communications radio le long de la (des) route(s)
- Si le navire est bien adapté à la navigation sur le(s) itinéraire(s) proposé(s) et à l'amarrage prévu au poste d'amarrage
- La sécurité opérationnelle du confinement et de la manutention de la cargaison du navire
- Si le poste d'amarrage du navire et les exigences de service du terminal sont adéquats
- Les conséquences possibles de l'augmentation du trafic maritime sur les réseaux régionaux de transport maritime, y compris la pêche, la navigation de plaisance et les navires qui ne doivent pas être équipés d'un système d'identification automatique (SIA)
- Les préoccupations en matière de pollution liées à ces navires supplémentaires
- Les dangers pour les communautés situées le long de la (des) route(s)
- La prévention de la pollution, les plans d'urgence et les interventions d'urgence
Le Comité examine la soumission TERMPOL et présente un rapport comprenant :
- Un sommaire, une analyse, des conclusions et des recommandations
- Des rapports portant sur des sujets spécifiques pour répondre à toute situation spécifique à un site
Le succès du processus d'examen TERMPOL repose sur le respect des procédures du TP 743 par le promoteur et sur la qualité des données soumises au CET. Le promoteur est responsable de s'assurer que les études sont conformes aux normes industrielles et internationales.
Les « recommandations » du CET sont des mesures proposées pour améliorer la sécurité au-delà des réglementations existantes. À ce titre, ils correspondent à des aspects que le promoteur peut contrôler. Les « conclusions » sont des observations faites pour saisir, renforcer ou faire des commentaires sur les principaux engagements du promoteur. Ils servent parfois à mettre en évidence des actions en cours ou à noter quelque chose en rapport avec un programme ou un règlement particulier.
Le processus d'examen TERMPOL ne peut remplacer les exigences en matière de sûreté, de sécurité et d'environnement de tout loi ou règlement en vigueur, et ne constitue pas non plus un processus d'approbation ou de rejet d'un projet. Il faut noter, aux fins du présent document, que les lois et règlements mentionnés peuvent avoir été modifiés depuis la mise en œuvre du terminal de Goldboro et que, par conséquent, il est attendu du promoteur qu'il se conforme aux lois et règlements les plus récents relatifs à ce projet.
Le processus TERMPOL n'est pas un instrument de réglementation. Aucun autorisation ou permis n'est délivré à la suite de l'examen ou du rapport TERMPOL. À ce titre, le rapport TERMPOL ne doit pas être interprété comme une déclaration de politique gouvernementale ou une approbation de la part du gouvernement fédéral. Bien que les conclusions et les recommandations du rapport TERMPOL ne soient pas contraignantes, un promoteur peut néanmoins intégrer les améliorations suggérées dans son ingénierie, sa planification et sa conception.
L'autorisation accordée par leNote de bas de page 8 ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse (NSE) dans le cadre de l'évaluation environnementale comportait plusieurs conditions. La condition 2.11 exige que le promoteur réalise un processus d'examen TERMPOL afin d'évaluer les risques du projet et de mettre en œuvre les recommandations, à l'exception de celles qui ont été approuvées par le NSE.
Remarques :
- Les recommandations ne peuvent pas alléger les exigences réglementaires de la Loi de la marine marchande du Canada (LMMC, 2001) et de toute autre réglementation applicable.
- Aucun autorisation ou permis n'est délivré à la suite de l'examen TERMPOL. Cependant, les autorités gouvernementales et les autres organismes peuvent utiliser le rapport d'examen TERMPOL pour identifier :
- Les problèmes et les possibilités pour améliorer la sécurité maritime
- Toute conséquence sur les services et programmes maritimes
- Le CET et ses départements et organisations compétents ne sont pas responsables de l'application des conditions prévues par l'évaluation environnementale.
1.3 Portée d'un examen TERMPOL
La portée d'un processus d'examen TERMPOL dépendra de la nature et de l'emplacement de chaque projet.
Le promoteur, en consultation avec le CET, déterminera la portée la plus appropriée pour le projet afin de déterminer la zone géographique, les études, les enquêtes, les données techniques et les échéances de l'examen. Le promoteur doit également tenir compte des activités de transport maritime préexistantes et des circonstances particulières de la région.
Les autres considérations sont les suivantes :
- Le terminal traitera-t-il du pétrole en vrac, des produits chimiques, des gaz liquéfiés ou d'autres cargaisons nocives et dangereuses?
- Le projet est-il un nouveau terminal ou s'agit-il d'un terminal existant?
- Le projet est-il envisagé pour une zone qui n'est pas déjà une route maritime commerciale bien établie?
- Est-ce que les navires du projet sont plus grands que ceux qui se trouvent actuellement dans cette zone?
- S'agit-il d'une nouvelle cargaison, qui ne provient pas actuellement de la région?
- Le projet est-il situé à l'extérieur des limites d'une autorité portuaire canadienne?
- Est-ce le premier examen TERMPOL pour la région? Dans l'affirmative, les opérations, les navires ou la cargaison sont-ils différents de l'examen précédent?
- Le projet se traduira-t-il par une augmentation importante du trafic maritime?
- Les risques de sécurité ont-ils été convenablement évalués dans la zone de délimitation du périmètre du projet?
L'examen TERMPOL est un processus autonome, distinct de toute évaluation environnementale. Il ne considère pas les impacts environnementaux d'un projet, y compris ceux causés par des accidents ou des dysfonctionnements.
Les examens TERMPOL ne fixent pas les normes pour le site, la conception, la construction ou l'exploitation du terminal, et n'examinent pas non plus les infrastructures terrestres comme les installations de réception du gaz naturel et de production de GNL.
Les examens TERMPOL sont indépendants des exigences de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC)Note de bas de page 11. En vertu de laquelle les promoteurs doivent faire une demande d'approbation s'ils veulent construire, placer, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou mettre hors service un ouvrage important dans, par-dessus, au-dessus, en dessous, ou à travers une eau navigable. Le projet ne doit pas porter atteinte à la sécurité de la navigation sur cette voie navigable.
Par contre, le processus d'examen TERMPOL étudie les parties d'un projet relatives au transport maritime dans le contexte des règlements, programmes et services maritimes existants, et envisage de nouvelles interventions qui pourraient être mises en place dès le début des opérations du projet.
1.4 Méthodologie pour l'examen du projet Goldboro GNL
Pieridae Energy Ltd (Pieridae) a formellement demandé un examen TERMPOL par une lettre adressée à TC le 4 novembre 2013. Après que la demande a été acceptée, des représentants de Pieridae et du CET se sont réunis pour définir la portée adéquate des enquêtes et des études.
Les membres du CET ont représenté :
- SSM de TC
- MPO Canada : SHC, Gestion des océans et des zones côtières, Garde côtière canadienne (GCC) - Programmes de navigation, Gestion des incidents et Services de gestion intégrée des activités
- ECC : Programmes d'évaluation environnementale et programmes marins
- APA
- Comté de Guysborough
Pieridae a rédigé sa soumission conformément au Processus d'examen TERMPOL TP 743, version de 20142. Le comité d'examen technique a évalué les documents afin de repérer les lacunes en matière d'information et de fournir un retour d'information.
Tel qu'indiqué dans les lignes directrices pour l'examen TERMPOL, Pieridae a présenté les études, enquêtes et données techniques figurant dans le tableau 1.3-1 pour examen et analyse par le CET :
| Numéro | Titre de l'étude TERMPOL |
|---|---|
| 3.2 | Enquête du trafic maritime |
| 3.3 | Enquête des itinéraires, des abords caractéristiques et de la navigabilité |
| 3.4 | Enquête spécifique sur le dégagement sous quille |
| 3.5 | Enquête sur les temps de transit et les retards |
| 3.6 | Enquête sur les données relatives aux accidents |
| 3.7 | Spécifications du navire |
| 3.8 | Schémas et données techniques du site |
| 3.9 | Systèmes de transfert et de transbordement des cargaisons |
| 3.10 | Éléments de chenal, de manœuvre et d'ancrage |
| 3.11 | Procédures et dispositions en matière d'amarrage |
| 3.13 | Analyse globale des risques et méthodes envisagées pour les réduire |
| 3.14 | Livre d'information sur les ports (aperçu) |
| 3.15 | Manuel d'exploitation des terminaux (aperçu) |
| 3.16 | Planification d'urgence |
| 3.18 | Considérations sur les matières dangereuses et nocives |
Pieridae et le CET ont convenu de ne pas inclure deux études qui ne s'appliquent pas au projet :
- 3.12 - Dispositions relatives à l'amarrage à point unique
- 3.17 - Exigences relatives aux installations de manutention du pétrole
Pieridae a travaillé avec HR Wallingford Ltd. à Howbery Park, Wallingford, Royaume-Uni, pour réaliser des simulations de manœuvre de transporteurs de GNL afin de :
- Valider la conception et la configuration de son terminal.
- Valider les caractéristiques et la composition des remorqueurs.
- Vérifier les limites environnementales pour une exploitation sécuritaire.
- Évaluer la conformité des aides à la navigation existantes.
Les simulations ont été réalisées en novembre 2018 par une équipe de l'APA, SSM de TC, Pieridae et HR Wallingford Ltd. Pour de plus amples renseignements sur le rapport de simulation, consulter la Section 3.2.3.2.
Le CET a examiné les ébauches d'enquêtes et d'études entre juillet 2018 et mai 2019 et a communiqué aux Pieridae les modifications ou ajouts à apporter aux informations qu'ils avaient soumises.
Les résultats de l'examen du CET sont décrits dans la section Analyse du présent rapport, répartis dans les cinq sections suivantes :
- Informations sur les navires
- Informations sur les itinéraires
- Exploitation des terminaux
- Évaluation des risques et planification d'urgence
- Préparation et réponse aux déversements de GNL et de pétrole
Le CET a fondé son analyse et ses commentaires dans ce rapport sur les informations, la documentation et les technologies disponibles au moment de sa rédaction. Il se peut que certains aspects de cette analyse doivent être réévalués en cas de retard important dans le démarrage des opérations ou si Pieridae apporte des modifications à la proposition.
Ce rapport d'examen TERMPOL, dont les recommandations et les conclusions s'appliquent spécifiquement aux éléments de sécurité maritime du projet de GNL Goldboro proposé par Pieridae, a pour objectif de réduire les risques en utilisant les meilleures technologies et pratiques disponibles.
Veuillez lire ce rapport en même temps que le processus d'examen TERMPOL, version de 2014 (TP 743) et les études présentées par le promoteur. Pour obtenir une copie des études du promoteur, contactez :
Pieridae Energy Ltd
1718 Argyle St Suite 730
Halifax NS B3J 3N6
Tél. : 902-492-4044
Télécopieur : 902-492-5200
Courriel : info@pieridae.com
2.0 Participation autochtone
De nombreuses communautés et organisations autochtones peuvent être touchées par le projet Goldboro GNL ou avoir un intérêt direct envers celui-ci. La zone de portée est utilisée pour les activités traditionnelles, notamment la chasse, la pêche et la cueillette.
Dans leur proposition, Pieridae a décrit leur engagement avec les groupes autochtones locaux entre 2013 et 2018. Ils se sont également engagés à continuer ces discussions au fur et à mesure que le projet avance et franchit des étapes clés. Bien que l'obligation de consulter ait été initialement motivée par les exigences de l'évaluation environnementale de la Nouvelle-Écosse, certaines parties de l'examen TERMPOL ont aussi été considérées dans la consultation de Pieridae.
Au terme de l'évaluation environnementale, Pieridae s'est engagé à travailler de manière proactive avec les groupes autochtones pour définir et conclure un accord sur les avantages de la collaboration, qui, selon le promoteur, visera à garantir la participation active des Premières nations au développement et à l'exploitation du projet.
Pendant le processus d'examen TERMPOL, TC a régulièrement communiqué des mises à jour aux groupes autochtones locaux ainsi qu'à d'autres ministères provinciaux et fédéraux. TC va mettre le Rapport d'examen TERMPOL de Pieridae sur le projet Goldboro GNL à la disposition du public.
TC peut tenir des réunions d'information technique avec des groupes autochtones et des utilisateurs locaux des voies navigables pour :
- Leur donner un aperçu du rapport TERMPOL.
- Fournir une occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses.
- Expliquer comment le comité d'examen est parvenu à ses conclusions.
3.0 Analyse
3.0 Introduction
Le rapport TERMPOL correspond à l'analyse du CET sur les plans de Pieridae et la gestion des risques. Les « améliorations en matière de sécurité » auxquelles Pieridae s'est engagé ont été des éléments importants de l'évaluation de la sécurité du projet par le CET. Le CET exige que le promoteur gère ces risques.
Le rapport contient des recommandations et des conclusions qui s'appliquent aux transporteurs de GNL, aux itinéraires proposés et à la sécurité des terminaux. Le CET invite le promoteur à donner suite aux recommandations contenues dans ce rapport. Alors que le promoteur peut faire appliquer certaines recommandations, d'autres impliquent de s'adresser à diverses autorités. Pieridae doit s'assurer de prévoir suffisamment de temps au cas où des discussions seraient nécessaires avant de donner suite à certaines recommandations.
Si Pieridae apporte des modifications à une partie du projet, à des paramètres opérationnels ou à des caractéristiques, il est important d'en informer les autorités compétentes afin de leur donner suffisamment de temps pour les examiner.
Les transporteurs de GNL du projet et leurs exploitations doivent respecter toutes les lois canadiennes et internationales qui s'appliquent, y compris :
- La Loi de la marine marchande du Canada, 2001; qui est la principale loi régissant la sécurité du transport maritime et qui protège l'environnement marin contre la pollution causée par les navires au Canada. La LMMC, 2001, concerne tous les navires opérant dans les eaux canadiennes, les navires canadiens dans le monde entier et, dans certains cas, les navires étrangers dans la zone économique exclusive.
- Le Règlement de pilotage de l'Atlantique (RPA) en vertu de la Loi sur le pilotage, qui a instauré des zones de pilotage obligatoire le long de la côte atlantique du Canada.
- La Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM) régit la sûreté du transport maritime et s'applique aux navires, aux ports et aux installations maritimes au Canada, aux navires canadiens à l'étranger et aux installations et structures maritimes.
Conclusion 1. Le CET reconnaît que Pieridae doit discuter des délais avec toutes les autorités compétentes pour donner suite aux recommandations formulées dans le présent rapport.
Recommandation 1. Le CET conseille à Pieridae d'informer les autorités compétentes s'il souhaite modifier des parties du projet, des critères opérationnels ou des caractéristiques, afin que les autorités puissent examiner les éventuelles répercussions sur la sécurité qui résulteraient de ces modifications.
3.1 Information relative aux navires
3.1.1 Dispositions générales
Des transporteurs de GNL spécialisés vont transporter le GNL du terminal de Goldboro vers le marché. Selon PieridaeNote de bas de page 12, son terminal maritime pourra accueillir des navires allant de 125 000 m3 à 266 000 m3. Les transporteurs de GNL seront des navires affrétés battant pavillon étranger et ils devront respecter toutes les lois, réglementations et conventions internationales, de l'État du pavillon et du Canada qui s'appliquent au navire au moment de l'inspection. En fonction du plus petit navire prévu, ils devront satisfaire à l'ensemble des exigences sans aucune dérogation liée à la taille.
Le Canada a adopté des parties de deux accords internationaux à la LMMC de 2001, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), et exige que les navires les respectent. Par exemple :
- Les systèmes essentiels à bord des navires, comme les systèmes de direction, d'alimentation et de navigation, doivent disposer de systèmes de secours à bord afin que la défaillance d'un système ne compromette pas la sécurité du navire. (SOLAS, chapitre IV et V).
- La convention SOLAS nécessite un ensemble complet d'équipements de navigation pour une navigation sécuritaire et précise.
- Tous les transporteurs de GNL doivent disposer de matériel de sauvetage en nombre suffisant, composé de canots de sauvetage, de radeaux de sauvetage, de gilets de sauvetage, de bouées de sauvetage et de signaux de détresse, etc. Ils doivent également disposer d'un plan de lutte contre l'incendie à bord, avec des informations détaillées sur le matériel de lutte contre l'incendie essentiel.Note de bas de page 13
- La convention SOLAS exige que les navires disposent d'un dispositif de remorquage d'urgence à bord.Note de bas de page 14
- Tous les transporteurs de GNL doivent avoir un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures à bord du navire, approuvé par l'administration.Note de bas de page 15
- Émissions atmosphériques : Goldboro est située dans la zone nord-américaine de contrôle des émissions (ZCE-NA), ce qui implique que le combustible marin utilisé par les navires dans la ZCE-NA ne peut contenir plus de 0,1 % de soufre. La limite de 0,1 % de soufre est applicable depuis le 1er janvier 2015.Note de bas de page 16
La construction d'un transporteur de GNL doit être conforme aux exigences de l'État du pavillon ainsi qu'aux instruments appropriés des conventions et codes de l'OMI. Les transporteurs de GNL doivent également se conformer à la version du Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquides en vrac (Code IGC) qui est en vigueur au moment de leur construction, ainsi qu'aux directives des sociétés de classification. Des lignes directrices et des recommandations sont également émises par l'Oil Company International Marine Forum (OCIMF) et la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO).
Le code IGC inclut des exigences pour les éléments et contrôles suivants :
- Matériaux de construction pour le confinement des cargaisons
- Contrôle de la pression et de la température de la cargaison
- Contrôle environnemental
- Protection contre l'incendie et extinction des incendies
- Protection du personnel
- Limites de capacité pour les citernes à cargaison
Le système de membrane consiste en une isolation intégrée directement dans la coque du navire, ainsi qu'en un revêtement de membrane à l'intérieur des réservoirs pour préserver leur intégrité. La coque du navire supporte directement la pression de la cargaison de GNL. Le système de membrane utilise la totalité du volume de la coque d'un navire et est moins coûteux à construire. Ces navires ont une meilleure visibilité à partir des fenêtres de la passerelle que la conception sphérique et ne seront pas aussi perturbés par le vent.
Les réservoirs indépendants et autoportants, tels que le système Kvaerner-Moss, sont constitués de réservoirs sphériques isolés et autoportants, soutenus à l'équateur par une jupe cylindrique continue. La citerne et la coque du navire sont deux structures distinctes. Ils ne sont pas perturbés par les éventuels dommages causés à la coque du navire. Le modèle Kvaerner-Moss se trouve généralement sur les petits GNL.
Pieridae a soumis des données pour quatre grandeurs de navires pouvant faire escale à Goldboro Note de bas de page 17:
| Capacité des navires | 125 000 m3 | 177 000 m3 | 216 000 m3 | 266 000 m3 |
|---|---|---|---|---|
| Réservoir | Sphérique | Sphérique/membrane | Membrane | Membrane |
| LHT (m) | 285,3 | 300 | 315 | 345 |
| LPP (m) | 273,4 | 286,5 | 302 | 332 |
| Largeur (m) | 43,7 | 52 | 50 | 53,8 |
| Creux minimal (m) | 25 | 28 | 27 | 27 |
| Enfoncement (m) | 11,5 | 11,7 | 12 | 12 |
| Enfoncement du lest (m) | 10 | 9,5 | 9,4 | 9,6 |
| Déplacement en charge (mt) | 102 804 | 128 533 | 146 054 | 178 564 |
| Déplacement du lest (mt) | 82 500 | 98 887 | 111 900 | 141 990 |
| Zone de charge du vent longitudinal (m2) | 6 450 | 9 918 | 7 130 | 8 759 |
| Zone de charge du vent transversal (m2) | 783 | 1 943 | 1 510 | 1 612 |
| Charge du vent longitudinal du lest (m2) | 6 865 | 10 478 | 8 000 | 9 552 |
| Charge du vent transversal du lest (m2) | 850 | 2 055 | 1 650 | 1 741 |
Recommandation 2. Le CET recommande que Pieridae identifie toutes les exigences canadiennes spécifiques qui ne font pas actuellement partie des conventions, codes ou normes internationaux. Pieridae devrait mettre l'accent sur ces exigences dans le Livre d'information sur les ports pour les navires faisant escale au terminal GNL de Goldboro.
3.1.2 Procédures de contrôle des navires-citernes
Tous les navires-citernes étrangers faisant escale dans un port canadien sont soumis à des inspections. TC procède à l'inspection des navires-citernes lors de leur première escale dans un port canadien, et au moins une fois par an par la suite.
Les inspecteurs veillent à ce qu'ils respectent les exigences canadiennes et les conventions internationales pertinentes. Le Canada considère que les transporteurs de GNL sont des navires-citernes à des fins d'inspection.
Les sociétés de classification (comme le Lloyd's Register, l'American Bureau of Shipping, DNV-GL, etc.) ont les compétences nécessaires pour inspecter, vérifier et certifier que les navires sont construits, entretenus et exploités conformément aux règles, règlements et normes reconnus.
Le programme de Contrôle des navires par l'État du port est un régime international qui permet aux navires étrangers d'être arraisonnés et inspectés afin de s'assurer que les principales conventions maritimes internationales sont respectéesNote de bas de page 18. TC se sert du programme pour faire appliquer la LMMC, 2001, la Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM) et d'autres conventions internationales.
L'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) donne des conseils sur le contenu et l'application d'un programme d'inspection des navires-citernes dans le cadre du Rapport d'inspection des navires (SIRE), un processus d'inspection volontaire. Les sociétés membres exigent que les navires soient inspectés par un inspecteur SIRE accrédité. Il existe une division des responsabilités en cascade au sein de SIRE pour assurer le respect des réglementations applicables. L'expéditeur vérifie le propriétaire du navire avant les nominations. L'exploitant du terminal maritime examinera ensuite les navires-citernes désignés afin de s'assurer qu'ils sont compatibles avec l'aménagement, les installations et les équipements du terminal. L'adhésion des membres de l'industrie au programme SIRE favorise une amélioration continue.
Les directives de gestion et d'autoévaluation des navires-citernes de l'OCIMF (Tanker Management Self-Assessment - TMSA) encouragent les entreprises à comparer leurs systèmes de gestion de la sécurité à des indicateurs de performance clé et fournissent une attente minimale (niveau 1) ainsi que trois niveaux croissants de conseils sur les meilleures pratiques. Les résultats de l'auto-évaluation pourront être utilisés pour élaborer des plans d'amélioration afin de favoriser une amélioration continue de leurs systèmes de gestion des navires. Les entreprises sont incitées à comparer régulièrement les résultats de leur auto-évaluation aux indicateurs de performance clé de la TMSA et à élaborer des plans d'amélioration. En veillant à ce que leurs politiques et procédures correspondent aux meilleures pratiques de l'industrie, les entreprises améliorent leurs performances et atteignent des normes élevées de sécurité et de prévention de la pollution.
Étant donné que la TMSA est généralement acceptée par le secteur des pétroliers, de nombreuses associations de protection et d'indemnisation (P&I Clubs) et de nombreux terminaux ont commencé à demander la TMSA auprès d'autres types de navires. L'auto-évaluation concerne les points suivants Note de bas de page 19:
- Le leadership et le système de gestion de la sécurité
- Recrutement et gestion du personnel à terre
- Gestion du recrutement et du bien-être du personnel des navires
- Fiabilité et entretien des navires, notamment des équipements essentiels
- Sécurité de la navigation
- Opérations de cargaison, de lest, de nettoyage des citernes, de soutage, d'amarrage et d'ancrage
- Gestion des changements
- Signalement des incidents, enquêtes et analyses
- Gestion de la sécurité
- Gestion de l'environnement et de l'énergie
- Préparation aux situations d'urgence et planification en cas d'urgence
- Mesures, analyses et améliorations
- Sécurité maritime
Le Chemical Distribution Institute—Marine (CDI-M) publie des rapports d'inspection annuels sur la flotte mondiale de navires-citernes pour produits chimiques et gaz de pétrole liquéfié. En 2018, plus de 600 propriétaires de navires et 5400Note de bas de page 20 transporteurs de produits chimiques et de gaz ont participé à cet effort. Il y a plus de 70 inspecteurs accrédités par le CDI-M qui mènent des inspections dans les ports à travers le monde. Les navires qui ont un rapport CDI-M dans la base de données active sont répertoriés dans le système européen d'information sur la qualité des navires (EQUASIS - European Quality Ship Information System). Les membres du Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du Port qui participent à EQUASIS ont accès à la base de données qui leur permet d'obtenir des informations à partir des rapports d'inspection des navires.
Pieridae a annoncé qu'il établira un processus de contrôle et d'approbation pour évaluer la capacité d'un transporteur de GNL à faire escale et à charger au terminal GNL de Goldboro de manière sûre et efficace.Note de bas de page 21 Cette procédure est divisée en deux activités différentes :
- « Compatibilité avec le terminal » - contrôle des aspects physiques du transporteur de GNL par rapport aux exigences du terminal.
- « Assurance qualité du transporteur de GNL et de son exploitant » - évalue la capacité du transporteur de GNL à respecter les normes de sécurité et d'environnement.Note de bas de page 21
La procédure de contrôle concernerait également :
- La sécurité et la sûreté au poste d'amarrage.
- Vérification du transporteur de GNL avant l'accostage.
- Détails de la cargaison et du transporteur lors du chargement.
- Qualifications de l'équipage.
- Sécurité des terminaux et procédures opérationnelles.
La Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) a développé un questionnaire de compatibilité navire-terre pour vérifier que les navires-citernes sont adéquatement configurés pour le terminal.Note de bas de page 22 Pieridae a affirmé que tous les navires faisant escale à Goldboro devront satisfaire à toutes les exigences internationales et canadiennes en matière de contrôle et devront être munis d'un certificat valide du programme de rapport d'inspection des navires (SIRE).Note de bas de page 23
Conclusion 2. Le contrôle des navires-citernes, le programme de rapport d'inspection des navires et les processus maritimes de l'Institut de distribution de produits chimiques sont des moyens généralement acceptés que les terminaux et les sociétés de GNL adoptent pour vérifier la conformité et améliorer la sécurité.
Recommandation 3. Le CET recommande que Pieridae adopte et applique des normes de contrôle, veille à ce que tous les navires faisant escale à son terminal disposent d'un certificat SIRE (Ship Inspection Report Programme - programme de rapport d'inspection des navires) à jour et satisfassent aux critères de compatibilité du terminal. Pieridae devrait inclure ses normes de vérification dans le Livre d'information sur les ports.
Recommandation 4. Le CET recommande que Pieridae demande à tous les navires faisant escale à son terminal maritime de suivre le programme d'auto-évaluation de la gestion des pétroliers du Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).
Recommandation 5. Le CET recommande que Pieridae utilise le questionnaire de compatibilité navire-terre publié par la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) lors de la phase de préfixation pour voir si un navire peut être amarré en toute sécurité au terminal.
3.1.3 Gestion des eaux de lest
Le projet Goldboro GNL impliquera des transporteurs de GNL d'une capacité maximale de 266 000 m3, qui transporteront probablement de l'eau de mer comme ballast. Tout navire étranger doit se conformer au Règlement sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast du Canada ainsi qu'à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments de ballast des navires.Note de bas de page 24
Les navires qui reçoivent des eaux de ballast à l'étranger doivent disposer d'un plan de gestion des eaux de ballast. Ils ne doivent pas rejeter des eaux de ballast étrangères dans les eaux canadiennes, à moins qu'elles n'aient été gérées par :
- Un échange en mer.
- Le traitement à bord.
- Le pompage à terre en vue d'un traitement; ou
- La rétention à bord.
La réglementation canadienne dépasse la Convention internationale en demandant que le ballast soit échangé à au moins 200 nm du rivage et dans des eaux d'au moins 2000 mètres de profondeur. La convention de l'OMI concernant les eaux de ballast exige l'échange des eaux de ballast à au moins 200 nm du rivage, mais seulement à 200 mètres de profondeur.
Un navire doit faire parvenir à TC un « Formulaire de déclaration des eaux de ballast » dès que la gestion des eaux de ballast est terminée et avant d'entrer dans les eaux sous juridiction canadienne. Les navires peuvent être inspectés par le SSM de TC pour vérifier qu'ils respectent le Règlement sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast, tel que modifié de temps à autre.
3.1.4 Normes relatives aux navires et à l'équipage
Tous les transporteurs de GNL sont tenus de respecter les Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), de la société de classification et des enquêtes de l'État du pavillon, et de se conformer à toutes les lois internationales et canadiennes.
La Convention STCW définit les normes internationales minimales de qualification pour toute personne travaillant à bord d'un navire. Il comprend des exigences de certification et de formation pour tous les emplois à bord d'un navire, y compris:
- Heures de repos pour les marins
- Certificats d'aptitude pour les gens de mer compétents, pour les départements du pont et des machines
- Exigences en matière de formation et de perfectionnement professionnel
- Formation obligatoire en matière de sécurité
- Normes médicales additionnelles
- Limites spécifiques d'alcoolémie dans le sang ou dans l'air expiré
Le Règlement sur le personnel maritime (RPM) est un règlement adopté en vertu de la LMMC, 2001. La partie 2 du RPM concerne les navires canadiens et les navires étrangers dans les eaux canadiennes. Elle exige que :
- Les officiers supérieurs (capitaine, second, chef mécanicien ou second mécanicien) à bord d'un transporteur de GNL doivent être titulaires d'un certificat/approbation de Formation spécialisée en matière de transport de gaz liquéfié par navire-citerne.
- Tout membre d'équipage ayant des responsabilités spécifiques dans les opérations de transfert de gaz liquéfié doit être titulaire d'un certificat/approbation de Familiarisation aux navires-citernes de gaz liquéfié.
Pieridae doit vérifier que les transporteurs respectent tous les éléments requis du RPM en vertu de la LMMC, 2001, y compris toute mise à jour future.
La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) exige que tous les « navires soient dotés d'un équipage suffisant et efficace ».Note de bas de page 25 Lorsque l'équipage de sécurité minimum d'un navire est fixé, plusieurs principes sont appliqués pour garantir que la sécurité n'est pas compromise à tout moment.
SIGTTO a publié deux documents relatifs aux qualifications des équipages :
- Directives d'utilisation de la matrice d'expérience SIGTTO en matière de GNL et de GPLNote de bas de page 26, pour faciliter la gestion de la sécurité des équipages à bord des navires GNL et GPL
- Normes de compétence pour le transport maritime de GNL
Le promoteur devra vérifier que les équipages des transporteurs GNL faisant escale au terminal proposé de Goldboro sont expérimentés et formés pour la cargaison et le navire spécifiques qu'ils exploitent.Note de bas de page 27 Ainsi, tout membre du personnel de bord concerné devrait avoir reçu la formation requise pour satisfaire aux Normes de compétence en matière de navigation SIGTTO LNG et aux Directives d'utilisation de la matrice d'expérience SIGTTO LNG et GPL.
Conclusion 3. Pieridae n'a pas indiqué dans sa soumission les exigences du Règlement sur le personnel maritime en matière de formation et de qualification des équipages.
Recommandation 6. Le CET recommande que tout le personnel à bord des navires soit formé pour répondre aux Normes de compétence pour le transport maritime de GNL et aux Directives d'utilisation de la matrice d'expérience SIGTTO en matière de GNL et de GPL.
3.2 Informations sur les itinéraires
3.2.1 Itinéraire global
Le projet de terminal GNL de Goldboro est situé sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, à l'entrée de Country Harbour et d'Isaacs Harbour. Il n'est accessible que depuis la haute mer et aucune route alternative n'a donc été envisagée. La plupart des transporteurs de GNL faisant escale à l'installation proposée proviendraient d'Europe (la Belgique, l'Espagne et la France sont des marchés clésNote de bas de page 28) L'accès maritime au terminal proposé est sécuritaire et sans restriction pour tous les navires prévus, les routes d'approche et de départ étant généralement de 20 m ou plus. Vous trouverez des renseignements complémentaires à l'annexe 4.
La zone de délimitation prévue pour l'installation proposée s'étend de Douvres (61 ° de longitude ouest) à Sherbrooke (62–° de longitude ouest), soit un total de 76 km (47 nm) le long de la côte, et jusqu'à la limite de la mer territoriale canadienne (jusqu'à une distance de 12 miles nautiques).
En 2016, Pieridae a présenté uneNote de bas de page 6 étude préparée par Amec Foster Wheeler comme partie de sa soumission. L'étude n'a pas été actualisée, mais les sections appropriées ont été ajoutées à une annexe du module 3.3 Enquête des itinéraires, des abords caractéristiques et de la navigabilité, présenté au CET le 26 juillet 2018.
Pieridae a également présenté un Rapport de simulation de manœuvre dans le module 3.10 - Éléments de manœuvre et d'ancrage et Goldboro GNL - Étude de simulation de navigation menée par HR Wallingford Ltd.
Dans les environs immédiats du terminal proposé, il y a deux gazoducs sous-marins qui ne sont plus en service :
- L'oléoduc Sable Offshore, propriété d'ExxonMobil
- Le pipeline Deep Panuke Offshore, propriété d'Encana Corporation
ExxonMobil, le principal opérateur du projet énergétique offshore de Sable, a cessé d'expédier du gaz naturel à terre le 31 décembre 2018Note de bas de page 29. Encana Corporation a arrêté d'expédier du gaz à terre le 7 mai 2018, pour ses activités à Deep Panuke. Ces oléoducs devraient être entièrement mis hors service d'ici 2021Note de bas de page 30 et réduiront le risque associé au passage et à l'accostage des transporteurs de GNL.
Les études de Pieridae ne tiennent pas compte du démantèlement des gazoducs sous-marins. La fin des opérations pour Sable Offshore et Deep Panuke auront un effet sur les mesures d'atténuation proposées que les navires devraient prendre lorsqu'ils naviguent dans la zone. Pieridae devra procéder à une réévaluation des risques liés à la navigation dans la zone et à la mesure d'atténuation des risques également. Par exemple, Pieridae a proposé que tous les transporteurs de GNL aient l'ancre levée et sécurisé, une fois que le pilote est à bord et qu'un remorqueur a été mis en route. Cette démarche pourrait ne pas être nécessaire si les gazoducs ne sont pas utilisés.
Conclusion 4. Les deux gazoducs offshore existants qui ont transporté le gaz naturel vers l'ancienne usine à gaz de Goldboro resteront probablement en place. Encana Corporation et ExxonMobil ont soumis à l'autorité de régulation de l'énergie du CanadaNote de bas de page 31 des demandes d'abandon des gazoducs et ont commencé à les mettre hors service. Les deux entreprises ont expliqué que les gazoducs seraient raclés et rincés, remplis d'eau de mer et laissés inertes sur le fond marin.
Recommandation 7. Le CET a recommandé que Pieridae évalue les mesures d'atténuation des risques proposées en ce qui concerne les gazoducs sous-marins abandonnés d'Encana et d'ExxonMobil situés à proximité du terminal; en particulier, les risques associés à un transporteur des GNL jetant l'ancre au-dessus des gazoducs sous-marins et procédant aux mises à jour correspondantes de son Livre d'information sur les ports et de son Manuel d'exploitation des terminaux.
3.2.2 Navigation et sécurité
3.2.2.1 Généralités
Comme tous les navires qui entrent dans les eaux canadiennes, les transporteurs de GNL à destination du terminal GNL proposé de Goldboro doivent respecter toutes les exigences en matière de sécurité de la navigation énoncées dans la Loi de la marine marchande du Canada, 2001, et la LMC et leurs règlements. Ils sont tenus de se conformer à la réglementation pendant toute la durée de leur séjour dans les eaux sous juridiction canadienne.
Ces règlements exigent que le capitaine du navire :
- Dispose à bord des cartes de navigation, des publications nautiques et des équipements de navigation et de communication appropriés.
- A élaboré un plan de passage qui tient compte de la profondeur d'eau existante sur l'ensemble du trajet afin de s'assurer qu'il y a un dégagement sous quille suffisant à tout moment.
- Avant d'arriver à la station d'embarquement des pilotes et de quitter le poste d'amarrage, vérifie que les systèmes de navigation, de contrôle et de propulsion du navire sont pleinement fonctionnels, en : Note de bas de page 32
- Fonctionnement du (des) moteur(s) en marche arrière
- Vérifier la direction (en testant l'arc de rotation complet du gouvernail [des gouvernails])
- Vérification :
- Systèmes de communication
- RADARs
- Autres équipements de navigation électronique
- Autres dispositifs de timonerie
- Ancre
- Équipement d'amarrage
- Système de remorquage en cas d'urgence pour les opérations de remorquage d'escorte
Les transporteurs de GNL vont s'approcher du terminal en haute mer sans trop d'interaction avec les autres navires, sauf pour manœuvrer pour suivre la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG) jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre le poste de mouillage ou de pilotage (si le port doit être considéré comme une zone de pilotage obligatoire).
3.2.2.2 Services de trafic maritime
Tous les transporteurs GNL de Goldboro devront se présenter aux Services de communication et de trafic maritime (SCTM) de la GCC :
- Quand on est à 96 heures des eaux canadiennes, conformément aux dispositions du Règlement sur la sûreté du transport maritime Note de bas de page 33 (SOR/2004-144). Parmi les autres enquêtes de sécurité, le navire doit déclarer toute défaillance de ses équipements et systèmes de sécurité, y compris ses systèmes de communication.
- Quand on est à 24 heures des eaux canadiennes, conformément aux dispositions du Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada Note de bas de page 34 (SOR/89-99). Les navires doivent signaler, en plus des détails relatifs à la certification légale et à la couverture de responsabilité, tout défaut de la coque du navire, des systèmes de propulsion ou de direction principaux, des RADARS, des compas, de l'équipement radio, des ancres ou des câbles.
Les centres des SCTM contrôlent également la navigation dans les zones STM (services de trafic maritime) en vertu du Règlement sur les zones de services de trafic maritime.Tout navire d'une longueur de 20 mètres ou plus et tout navire qui remorque ou pousse un autre navire doit se présenter à un officier des SCTM. Le navire doit respecter les exigences de déclaration prévues par le règlement. Les échanges d'informations entre les navires et un centre à terre contribuent à promouvoir une navigation sécuritaire et efficace et à renforcer la protection de l'environnement.
Pour le moment, il n'y a pas de système d'acheminement du trafic maritime dans la zone d'étude du projet GNL de Goldboro ( par exemple, un dispositif de séparation du trafic) ni de surveillance des STM (y compris la couverture RADAR et la couverture radio VHF sur la fréquence de travail), car la concentration du trafic ne nécessite pas de telles mesures.
L'analyse générale des risques effectuée par HR Wallingford a défini plusieurs mesures et procédures visant à réduire les risques à un niveau acceptable. La gestion du trafic maritime était l'une des mesures suggérées dans l'étude. Cette question est abordée de manière plus approfondie à la Section 3.4.2.
3.2.2.3 Aides à la navigation
Les aides à la navigation sont des instruments ou des systèmes, externes à un navire, qui :
- Aident les navigateurs à déterminer la position et la route du navire.
- Signalent de dangers ou d'obstacles.
- Indiquent le meilleur itinéraire ou l'itinéraire préféré.
Le système d'aides à la navigation Note de bas de page 35 canadien est composé d'aides visuelles, sonores et électroniques à la navigation. Les aides visuelles incluent les bouées, les balises de jour, les marques de jour et les feux. Les aides sonores sont des appareils produisant des sons qui avertissent les marins du danger dans des conditions de faible visibilité. Ces signaux comprennent les signaux de brouillard sur le rivage et les cloches et sifflets montés sur les bouées qui sont activés par l'action des vagues. La plupart des aides sonores fonctionnent lorsque la visibilité est réduite à moins de deux milles nautiques. Les aides électroniques sont notamment les réflecteurs radar, les balises radar, le système de positionnement global différentiel, les aides à la navigation « virtuelles » et le système d'identification automatique (SIA).
La GCC a pour mandat, mais n'est pas contrainte, de fournir des aides à la navigation dans les eaux canadiennes, à l'exception des voies navigables desservies par Parcs Canada.
Les aides à la navigation existantes dans Country Harbour et Isaacs Harbour répondent aux besoins du trafic maritime actuel. Les aides ne sont pas accordées au profit d'un seul utilisateur ou pour marquer l'accès à une installation privée. Étant donné que ce dernier est considéré comme un utilisateur unique, tous les coûts liés aux aides supplémentaires seraient à la charge de Pieridae.
Conclusion 5. Le CET remarque que le port est bien marqué par des bouées et qu'il répond aux besoins du trafic maritime actuel. Tout changement ou ajout proposé au système d'aides à la navigation nécessite l'apport de la GCC, le Programme des aides à la navigation, afin de s'assurer que le niveau de service est maintenu pour les utilisateurs existants dans la région.
3.2.2.4 Pilotage
Partout dans le monde, de nombreux pays maritimes font appel à des pilotes spécialisés pour faire naviguer les navires sur leurs voies navigables. Les pilotes agréés conduisent les navires pour s'assurer que les navires sont navigués et amarrés en toute sécurité dans des zones difficiles. Ils sont familiarisés avec les côtes, les eaux intérieures, les hauts-fonds, les ports, les ports, la météo, les marées, les règlements de navigation et les restrictions de la zone de pilotage dans laquelle ils sont autorisés. Les pilotes sont également familiarisés avec les différents systèmes de propulsion, la conception des coques et les caractéristiques des gouvernails des différents navires et leur réaction à des vitesses et des conditions météorologiques variées.
Les quatre administrations de pilotage au Canada chargées de fixer les exigences et de fournir des services de pilotage maritime dans toutes les régions géographiques du pays sont l'Administration de pilotage de l'Atlantique (APA), l'Administration de pilotage des Grands Lacs, l'Administration de pilotage des Laurentides et l'Administration de pilotage du Pacifique. Ils régissent les conditions de pilotage obligatoire dans lesquelles certaines catégories de navires, y compris les navires-citernes, sont tenues d'embarquer un pilote maritime ayant une connaissance du milieu local avant d'entrer dans un port ou une voie navigable très fréquentée.
L'APA suit et évalue tous les domaines relevant de son mandat afin de déterminer tout changement dans les facteurs et les circonstances qui peuvent avoir un impact sur la sécurité. Si un tel changement est jugé digne d'être examiné de plus près, l'Administration fera appel à un facilitateur externe pour mener une Méthode de gestion des risques de pilotage (MGRP).
Pieridae a expliqué que les navires devaient s'approcher du terminal sous la conduite d'un pilote en passant la bouée de chenal « TT » sur le côté bâbord du navire. Le navire maintiendrait son cap jusqu'à ce que le navire commence son mouvement pour s'approcher de la jetée, avec l'aide de remorqueurs. Pendant les simulations de manœuvre, les pilotes ont suggéré de placer un ensemble de feux d'alignement/feux de guidage pour le passage du rétrécissement aux approches de l'emplacement proposé du terminal (voir la Section 3.2.3.3 et l'Annexe 5 pour plus de détails).
Le terminal GNL envisagé à Goldboro n'est pas situé dans une zone de pilotage obligatoire. Pieridae a proposé d'inclure Goldboro dans la zone de pilotage obligatoire. Cette question est abordée de manière plus approfondie à la section 3.4.2.5
Conclusion 6. Le terminal GNL envisagé à Goldboro n'est pas situé dans une zone de pilotage obligatoire.
Recommandation 8. La TRC recommande que Pieridae demande un examen de la méthodologie de gestion des risques de pilotage avant ou pendant la construction du terminal.
3.2.2.6 Cartes marines
Les navires faisant escale au terminal proposé de Goldboro devront utiliser les cartes SHC 4234, 4321 et 4227 ou une carte équivalente acceptée par l'Organisation hydrographique internationale (OHI). Le SHC est l'agence gouvernementale fédérale responsable de la cartographie marine. Le SHC est responsable de la production et de l'entretien des cartes et des autres produits qui contribuent à la sécurité de la navigation dans les eaux canadiennes.Note de bas de page 36 L'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNL a proposé que les cartes soient mises à jour de manière à ce que Country Harbour soit centré, au lieu d'être situé au bord de la carte. Le SHC a indiqué qu'il est nécessaire de cartographier tous les mouillages, postes d'amarrage et zones d'exclusion proposés ainsi que tous les changements/ajouts aux aides à la navigation liés à l'installation proposée. Étant donné la nature et l'ampleur du projet, la révision des cartes pourrait prendre jusqu'à quatre ans. Le SHC doit réévaluer les systèmes de cartes existants. Un nouvel encart « d'amarrage » à grande échelle sera peut-être nécessaire afin de soutenir la navigation au terminal GNL. Les cartes électroniques et les publications nautiques devront également être mises à jour afin de faciliter la navigation au terminal, une fois que la conception du terminal, l'éclairage, les zones d'exclusion et les aides à la navigation seront finalisés.
Si le projet Goldboro GNL est confirmé, Pieridae doit en informer officiellement le SHC. Tous les plans proposés et réalisés doivent être transmis au SHC dans les meilleurs délais à Pieridae. Les notifications et les plans proposés doivent être envoyés à l'adresse suivante :
CHS Atlantic
À l'attention de :
Hydrographic Data Centre
1 Challenger Drive
Dartmouth NS B2Y 4A2
Conclusion 7. Le SHC serait affecté par la construction d'un nouveau grand terminal maritime.
Conclusion 8. Le CET est conscient que les cartes actuelles de la zone ne sont pas adaptées à la navigation en toute sécurité de l'augmentation et du type de trafic maritime prévus.
Recommandation 9. Le CET recommande que Pieridae collabore avec le SHC pour préparer et soumettre les données des relevés cartographiques le plus tôt possible, car le processus de cartographie pourrait prendre de 3 à 4 ans.
3.2.2.7 Conditions environnementales
La Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) a demandé à Pieridae Energy de réaliser une étudeNote de bas de page 37 sur les océans pour le projet Goldboro en 2015, afin de documenter les conditions météorologiques locales moyennes et extrêmes et les conditions de mer auxquelles on pourrait s'attendre à l'emplacement du terminal proposé. La zone étudiée s'étend jusqu'à 20 km de l'emplacement proposé pour le terminal, dans toutes les directions. Pieridae a joint les résultats de l'étude de 2015 à sa soumission de 2018.
Vagues, marées et courants
La marée la plus haute de cette zone peut atteindre 2,2 mètres et la marée la plus basse peut atteindre 0,2 mètresNote de bas de page 38. Tableau 3.2.2.7-1 est un échantillon provenant du tableau des marées pour Isaacs Harbour, montrant les marées hautes les plus hautes et les marées basses les plus basses pour 2019.
| Jour | Heure | Hauteur (m) |
|---|---|---|
| 22 janvier 2019 | 21 h 12 | 2,2 |
| 23 janvier 2019 | 21 h 51 | 2,2 |
| 21 mars 2019 | 20 h 33 | 2,2 |
| 22 mars 2019 | 21 h 07 | 2,2 |
| 3 août 2019 | 09 h 28 | 2,2 |
| 4 août 2019 | 10 h 06 | 2,2 |
| 31 août 2019 | 08 h 32 | 2,2 |
| 1 septembre 2019 | 03 h 05 | 0,2 |
| 1 septembre 2019 | 09 h 08 | 2,2 |
| 2 septembre 2019 | 09 h 43 | 2,2 |
| 29 septembre 2019 | 08 h 09 | 2,2 |
Le niveau moyen de la mer dans la région s'élève à un rythme d'environ 3,15 mm/an, soit environ 0,315 m en 100 ans. CB&I a calculé que le pire scénario, pour une période de retour de 100 ans, serait de +3,3 m au-dessus du zéro des cartes (+2,2 m de marée haute astronomique, +0,3 d'élévation du niveau de la mer et +0,8 m pour une onde de tempête).
La hauteur des vagues à l'extérieur de l'entrée de Country Harbour, près de Goose Island, est en moyenne de 1,35 m en provenance du sud et peut atteindre 8,24 m (5 cas signalés en 61 ans)Note de bas de page 37. Les vagues à proximité du projet de terminal GNL de Goldboro sont plus petites et plus courtes grâce à l'effet de protection des terres entourant le poste d'amarrage. Le poste d'amarrage du sud est plus touché que celui du nord; bien qu'en général, la hauteur des vagues soit inférieure à 1 mètre, avec de rares cas qui dépassent 1 m avec un maximum de 3 m (0,03 %). Pendant l'été, les vagues sont plus petites et proviennent du sud-sud-ouest ; pendant les mois plus froids, les vagues sont plus grosses et proviennent du sud.
L'étude a également décrit en détail les courants attendus à l'emplacement du terminal. Par le biais d'une modélisation après la construction, Pieridae a calculé que le courant maximum prévu au niveau du pont-jetée sud était de 0,44 m/sNote de bas de page 37, ce qui correspond à la vitesse de courant la plus élevée prévue à l'emplacement du terminal proposé. La figure 3.2.2.7-3 illustre la fréquence directionnelle des courants en six points :
- Poste d'amarrage sud, courant maximum prévu de 0,21 m/s (0,4 Kts)
- Poste d'amarrage nord, courant maximum prévu de 0,34 m/s (0,66 Kts)
- Structure de l'installation de déchargement des matériaux (MOF), courant maximum prévu de 0,18 m/s (0,35 Kts)
- Pont-jetée sud, courant maximum attendu 0,44 m/s (0,86 Kts)
- Point "S1", courant maximum prévu de 0,19 m/s (0,37 Kts)
- Pont-jetée nord, courant maximum attendu 0,17 m/s (0,33 Kts)
Vents et tempêtes
Les vents dominants dans la région sont de l'ouest - sud-ouest pendant les mois chauds et nord-ouest pendant les mois froids. À l'emplacement du projet, la direction du vent varie du sud-ouest et de l'ouest-sud-ouest. La vitesse maximale du vent pendant les 61 années étudiées était de 26 m/s (93,6 km/h), ce qui s'est produit au printemps.
Selon les données sur les conditions de vent saisonnières, les vitesses moyennes de vent les plus fortes se produisent en hiver. La vitesse moyenne est de 9,71 m/s (35 km/h) par rapport à 5,13 m/s (18,5 km/h) en été. En règle générale, les tempêtes avec des vents de plus de 12,86 m/s (46 km/h) sont plus fréquentes pendant l'hiver et peuvent durer jusqu'à 5 jours.
Brume
Le site du projet se trouve dans une zone qui est souvent affectée par la brume. La brume est plus importante pendant les mois les plus chauds et réduit la visibilité, ce qui peut entraîner des retards dans les activités de transport maritime du terminal. Selon l'Environnement et Changement climatique Canada, près de la moitié des matins de juin et juillet ont une visibilité réduite en raison de la brume dans la région. Ce pourcentage diminue considérablement en hiver, avec une moyenne de 16 % de jours où il y a de la brume.
Conclusion 9. Le CET est convaincu que l'installation d'une bouée intelligente [systèmes, aides et dispositifs pour l'acquisition de données océaniques (SADO) / bouée météo] à proximité de la station de pilotage proposée permettrait d'analyser en temps réel les conditions météo de l'océan.
Recommandation 10. Pieridae doit choisir les sources de financement pour la bouée intelligente [systèmes, aides et dispositifs pour l'acquisition de données océaniques (bouée SADO)/bouée)], en consultation avec Environnement et changement climatique Canada.
Recommandation 11. Pieridae doit vérifier les conditions limitatives du Metocean, y compris les facteurs qui affectent la visibilité et qui pourraient affecter les opérations et les inclure dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux.
3.2.2.8 Conditions hivernales
Embruns verglaçants
Les embruns verglaçants représentent un risque pour l'environnement pendant les mois froids d'hiver, lorsque les températures peuvent descendre jusqu'à -10 °C et que les valeurs de refroidissement éolien peuvent descendre en dessous de -25 °CNote de bas de page 39. Les embruns verglaçants peuvent provoquer l'accumulation de glace sur les infrastructures maritimes telles que la coque du navire, les ponts, les haubans, les câbles, les ancres, l'équipement de pont, etc. qui peuvent affecter la stabilité du navire ou le fonctionnement du pont. Un avertissement d'embruns verglaçants est émis quand on s'attend à ce que l'accumulation de glace provenant d'embruns verglaçants atteigne des niveaux modérés, entre 0,7 et 2 centimètres par heure (cm/h), ou des niveaux graves de plus de 2 cm/h.Note de bas de page 40
Glace de mer
Selon le Service canadien des glaces, la glace de mer dans la région est maximale de janvier à mars. La probabilité la plus importante de présence de glace de mer dans la région est de 15 % pour le mois de mars, avec une épaisseur maximale probable de 30 cm. Cette probabilité tombe à 10 % pour les mois de janvier et février. Lorsque la glace de mer est présente, la couverture serait de 50 % ou moins. La Figure 3.2.2.8-1 illustre la fréquence (%) de la glace de mer sur 30 ans.
Dans le passé, il y avait des événements glaciaires extrêmes qui ne correspondaient pas aux conditions prévues. En février 2003, des glaces de mer mesurant jusqu'à 120 cm ont été observées dans la région. En avril 1987, la banquise a été transportée par les courants sur toute la côte de la Nouvelle-Écosse, puis de forts vents du sud ont envoyé la glace de 2 à 2,5 mètres d'épaisseur dans les ports côtiers. Cette situation a eu un impact important sur le transport maritime commercial.
Au cours de l'hiver 2019, la concentration de glace dans la région a été plus importante que la moyenne. Le 25 février, la concentration totale de glace était de 7/10 dans la zone « Y », 4/10 couverts de glace grise (10 à 15 cm d'épaisseur) en floes de taille moyenne (100 à 500 mètres de large) et 3/10 de glace nouvelle (moins de 10 cm d'épaisseur). La Figure 3.2.2.8-2 présente un extrait de la carte des glaces avec ses codes.

Description
Extrait de la carte des glances dans le golfe Saint-Laurent (Goldboro est situé dans la zone orange en « Y »)
Le risque de dommages causés par la glace est présent sur la côte est du Canada durant l'hiver et le printemps. Étant donné que cette situation peut affecter la sécurité du personnel maritime, l'environnement marin et les navires naviguant dans les eaux couvertes de glace, TC a rédigé les Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l'est du Canada, TP 15163, en novembre 1979Note de bas de page 41.
Ces lignes directrices ne sont pas applicables aux transporteurs de GNL, mais uniquement aux pétroliers et aux transporteurs chargés de produits chimiques en vrac. Cependant, le CET recommande que les GNL qui font escale au terminal proposé respectent les lignes directrices, afin de réduire le risque de dommages causés par la glace.
Les eaux de l'est du Canada, au sud de la latitude 60º N, sont divisées en zones de contrôle des glaces. Le Centre des opérations des glaces de la Garde côtière canadienne considère qu'une zone de contrôle des glaces est « active » lorsqu'il constate que les conditions de glace dans une zone sont dangereuses pour la navigation.
En 2012, les directives ont été révisées pour inclure la zone de contrôle des glaces « X1 » pour la baie de Chedabucto et le détroit de Canso. La zone « X1 » est définie comme l'ensemble des eaux de la zone X entre la latitude 45 30' N et 45°00' N, allant du littoral vers l'est. Country Harbour, Isaacs Harbour et Goldboro sont tous situés dans la zone de contrôle des glaces « X1 ».
La zone de contrôle des glaces « X1 » a été active du 25 février au 27 mars 2019, de sorte que tous les navires pétroliers et les transporteurs de produits chimiques devaient avoir à bord un « Conseiller des glaces » lorsqu'ils traversaient la zone.
Le CET a constaté que Pieridae n'est pas d'accord pour que les transporteurs de GNL visitant le terminal de Goldboro soient tenus de suivre les lignes directrices.
« Nous constatons que ces lignes directrices sont applicables aux navires pétroliers et aux transporteurs de produits chimiques en vrac. Selon nous, un transporteur de GNL n'est pas, comme le déclare le code IBC, un transporteur de produits chimiques ni un pétrolier, et par conséquent les JIG ne s'appliquent pas. Cependant, Pieridae reconnaît qu'il serait judicieux d'inclure dans le Livre d'information sur les ports afin de préciser les procédures à suivre en cas de signalement de glace dans la zone qu'un transporteur de GNL doit traverser.Nous avons prévu de développer ces procédures dans la prochaine phase de développement du projet et nous serions heureux que TC participe à ce processus ».Note de bas de page 42
Conclusion 10. Le CET est convaincu que les transporteurs de GNL seraient plus sécuritaires s'ils avaient un « conseiller en glace » à bord lorsqu'ils voyagent dans des eaux couvertes de glace.
Recommandation 12. Le CET recommande que Pieridae oblige tous les transporteurs de GNL qui font escale au terminal proposé à suivre les Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l'est du Canada dans une zone de contrôle actif des glaces comme si les navires étaient des pétroliers chargés.
3.2.3 Navigabilité et exploitation des navires
3.2.3.1 Enquête sur les temps de transit et les retards
Dans la soumission de décembre 2015, Pieridae a soumis l'analyse de l'Utilisation des postes d'amarrage et des temps d'arrêt pour les transporteurs de GNL. Cette étude a utilisé un modèle mathématique pour :
- Étudier le temps d'arrêt éventuel des opérations maritimes (arrivée, chargement et départ des navires) en raison des conditions météorologiques locales (visibilité, vent, vagues et glace de mer).
- Prévoir le temps d'arrêt annuel des opérations maritimes.
Le CET a constaté que les conditions limites suivantes étaient incluses dans le modèle mathématique, qui utilisait des données de base provenant de Metocean et d'autres études Note de bas de page 43:
- Transit et accostage des navires à l'arrivée :
- Vagues offshore < 3,0 m
- Vagues à quai < 2,0 m
- Vitesse du vent < 25 kts
- Visibilité > 1,0 nm
- Glace de mer < 25 %, épaisseur < 15 cm
- Débarquement des navires et départ en transit :
- Vagues offshore < 3,0m
- Vagues à quai < 2,0m
- Vitesse du vent < 30kts
- Visibilité > 1,0 nm
- Glace de mer < 25 %, épaisseur < 15 cm
- Transfert de cargaison - arrêt du chargement :
- Vagues à quai > 2,0 m
- Vitesse du vent > 30kts
- Transfert de cargaison - déconnecter le bras de chargement maritime :
- Vagues à quai > 2,0 m
- Vitesse du vent > 35kts
Le tableau suivant affiche les résultats de l'Analyse de l'utilisation des postes d'amarrage et des temps d'arrêt pour les transporteurs de GNL. Les grands navires fréquenteraient moins souvent les postes d'amarrage que les petits navires, de sorte que le nombre de transits serait moins élevé. Les grands navires peuvent charger plus de GNL par escale et seraient plus efficaces.
Les plus petits navires passent plus de temps à chaque poste d'amarrage, car le temps consacré comprend des opérations de chargement de produits non GNL tel que les autorisations gouvernementales, les contrôles de sécurité, le jaugeage des réservoirs, etc.
| Utilisation annuelle | Conception des navires | ||
|---|---|---|---|
| Petit navire (120 000 m3) | Moyen navire (175 000 m3) | Grand navire (266 000 m3) | |
| Nombre minimum de navires par année | 190 | 128 | 84 |
| Nombre maximum de navires par année | 206 | 137 | 91 |
| Utilisation annuelle (% de l'année) | 63 % | 50 % | 42 % |
3.2.3.2 Étude de simulation de navigation
La soumission de Pieridae incluait un rapport sur les simulations de manœuvre de navires réalisés par HR Wallingford Ltd. L'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNLNote de bas de page 44, réalisée du 19 au 24 novembre 2018, a examiné :
- Les questions de sécurité des transporteurs de GNL (jusqu'à 266 000 m3 de capacité) naviguant vers et depuis le terminal et le poste d'amarrage proposés.
- Les questions de sécurité lors de l'utilisation de 4 remorqueurs à traction arrière en azimut (TAA) d'une capacité de traction de 70 tonnes, en utilisant les techniques d'escorte par câble standard de l'industrie.
L'étude visait notamment à :
- Confirmer la conception et la configuration du terminal GNL de Goldboro pour les transporteurs de GNL proposés.
- Veiller à ce qu'il y ait suffisamment de remorqueurs avec des capacités de tracteur/traction de bollard pour effectuer les opérations d'escorte et d'accostage.
- Confirmer les limites environnementales supérieures (vitesse/direction du vent, conditions des courants de marée et visibilité réduite) pour les activités de transit et d'amarrage/débarquement.
- Identifier les besoins en puissance de réserve des remorqueurs en cas d'accident de transporteur de GNL et/ou de panne de remorqueur.
- Évaluer la suffisance des aides à la navigation existantes et proposer de nouvelles aides ou la relocalisation des aides existantes.
HR Wallingford a créé un modèle géographique du terminal et de la zone environnante, en utilisant le plan qui a été développé au cours des études de la phase d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) achevée en 2015.Note de bas de page 45 Les études FEED ont aussi été utilisées pour d'autres données de référence comme le vent, le courant, les vagues, etc.
L'équipe de simulation était composée de représentants de Pieridae, de deux pilotes maritimes de l'APA, de deux représentants du SSM de TC et de représentants de HR Wallingford (dont un pilote maritime et un capitaine de remorqueur).
Les scénarios concernant les accidents sont essentiels pour choisir la meilleure configuration de remorqueur pour la section terminale de Goldboro et ont été inclus dans les simulations. Certaines des situations d'urgence ayant fait l'objet de la simulation ont été :
- Arrivée interrompue
- Départ accéléré
- Voyage d'aller avec panne de gouvernail
- Poste d'arrivée avec panne de moteur du navire
- Départ d'un navire en panne
- Poste d'arrivée avec panne de remorqueur
Au cours de la session, HR Wallingford a effectué 41 simulations, dont 28 manœuvres standards achevés, représentant 13 arrivées et 15 départs. Parmi les 28 manœuvres, 21 ont été réussies, 6 ont été jugées marginales et une a été considérée comme un échec. L'échec est dû au fait que les remorqueurs n'ont pas pu pousser le transporteur GNL du poste d'amarrage nord en raison de la hauteur significative des vagues (2 mètres).
Les résultats « marginaux » étaient pour les scénarios suivants :
- Arrivée interrompue au poste d'amarrage nord en amarrant à tribord
- Départ accéléré du côté bâbord du poste d'amarrage nord à l'aide d'un remorqueur
- Départ accéléré du côté bâbord sur le poste d'amarrage nord à l'aide de 2 remorqueurs
- Départ accéléré du côté tribord sur le poste d'amarrage nord à l'aide de 2 remorqueurs
Globalement, les simulations ont montré qu'il y avait suffisamment d'espace et de puissance de remorquage pour permettre d'arrêter la manœuvre d'accostage avec le navire sous contrôle, et pour que le navire se déplace vers une zone de mouillage temporaire avec une assistance de remorqueur.Note de bas de page 44
À partir des simulations, l'équipe est parvenue aux conclusions suivantes :
- Les tests ont confirmé que l'accès au terminal proposé et le départ de celui-ci sont sûrs et sans restriction. Il y a assez d'espace pour que les navires puissent être déplacés vers et depuis un poste d'amarrage, sans avoir à interagir avec un navire amarré au poste suivant. L'espace disponible, qui est naturellement profond, est suffisant pour permettre à l'armateur d'osciller à bâbord ou à tribord lors de l'arrivée, pour l'un ou l'autre poste d'amarrage.
- La ligne d'accostage de la jetée est suffisamment alignée avec la direction dominante des vagues, mais les remorqueurs opérant en mode de poussée sur la coque du navire sont entièrement exposés aux vagues. Tel que prévu, la principale contrainte sur les opérations maritimes a été constatée dans la performance des remorqueurs dans des conditions de vagues plus fortes, en particulier lorsque les remorqueurs fonctionnent en mode de poussée.
- Les remorqueurs TAA de 70 tonnes à traction de bollard se sont montrés efficaces en mode poussée jusqu'à 1 mètre de hauteur de vague, notamment lorsqu'ils sont combinés avec des remorqueurs travaillant sur des lignes à l'aide de treuils de récupération d'enduit.
- Les essais ont également révélé que, lorsque les remorqueurs naviguaient dans des conditions de vagues appropriées et avec des vents réguliers de 25 nœuds ou moins, la direction du vent n'avait pas d'importance.
- Aucune aide flottante complémentaire à la navigation n'était nécessaire. Toutefois, les essais ont clairement montré que les feux d'alignement (feux d'alignement ou feux à secteurs) seraient utiles et des recommandations ont donc été faites pour optimiser les aides à la navigation.
Consultez l'Annexe 5 pour la liste complète des conclusions et recommandations du rapport de l'étude de simulation de navigation de Goldboro GNL qui ont été soutenues par l'équipe de simulation.
Le CET a analysé chacune des recommandations de l'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNL et a élaboré des conclusions et des recommandations pour le terminal de Goldboro, qui sont incluses dans la section 3.4.2 Méthodes envisagées pour réduire les risques
Conclusion 11. Le CET reconnaît que les conclusions générales, recommandations et considérations supplémentaires de l'Étude de simulation de la navigation d'HR Wallingford permettraient d'améliorer la sécurité de la navigation maritime dans la zone de champ d'application de TERMPOL.
3.2.4 Considérations sur le trafic maritime
Pieridae a soumis son Enquête sur le trafic maritime en utilisant les données du rapport annuel 2017 de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, de Statistique Canada, de la Gestion des océans et des zones côtières (Pêches et Océans Canada), du Département américain de la défense, de la National Geospatial Intelligence Agency et du site web sur le trafic maritime « marinetraffic.com » (en anglais seulement). L'enquête sur le trafic n'a pas inclus les navires qui ne sont pas tenus d'être équipés d'un SIA.
Le trafic lié au projet Goldboro se développera en deux phases : la phase de construction et la phase opérationnelle. La phase de construction engendrera un trafic maritime supplémentaire. À la date de rédaction de ce document, Pieridae n'avait pas encore choisi la méthode de construction du terminal, qu'elle soit terrestre, maritime ou les deux. Le CET prévoit que la construction nécessitera des remorqueurs, des bateaux de travail, des barges et des cargos de projet, mais les détails exacts ne sont pas encore disponibles.
La phase opérationnelle du projet devrait compter, au maximum, 206 escales de navires (412 mouvements de navires), en supposant que les transporteurs aient une capacité de 125 000 m3. Les navires conçus pour ce projet ont une capacité maximale de 266 000 m3, ce qui réduirait le nombre d'escales et, par conséquent, l'augmentation du trafic maritime. Le volume des mouvements de navires dans la zone est directement proportionnel à la taille des transporteurs GNL qui feront escale au terminal. Les navires proposés sont énumérés à l'Annexe 3.
L'Enquête sur le trafic maritime a révélé qu'il n'y a pas beaucoup de trafic de navires dans la zone d'étude du projet. Il a également constaté l'absence de ports ayant un trafic maritime important entre Halifax et Port Hawkesbury.Note de bas de page 46
En ce qui concerne la partie des voyages de transporteurs de GNL située au large du « plateau néo-écossais », le CET s'attend à ce que les projets de transporteur de GNL puissent être facilement absorbés dans le réseau existant. Les transporteurs de GNL sont assujettis à des procédures de contrôle strictes de la part des affréteurs, de sorte que le CET ne se soit pas inquiété du fait que les navires du projet puissent accroître le risque pour le réseau.
La plupart du trafic de la côte atlantique est situé bien au large pour éviter tout risque naturel. Cela permettrait d'avoir assez de place pour tous les navires que les transporteurs de GNL pourraient rencontrer. Bien que l'itinéraire exact ne soit pas encore confirmé, les transporteurs de GNL évitent généralement les zones très fréquentées (comme Halifax et le détroit de Canso).
La partie côtière de la Nouvelle-Écosse aura un trafic plus important que les eaux hauturières. La collecte de données côtières n'est pas aussi rigoureuse que celle des eaux hauturières, car tout le trafic côtier ne doit pas être équipé de systèmes d'identification automatique (SIA), et la zone est à la portée des plaisanciers et des bateaux de pêche.
Le trafic récréatif devrait être peu important, car il n'y a pas de grands centres de population dans la région. Il existe quelques petits ports de pêche, mais aucun ne compte un grand nombre de bateaux. Néanmoins, cette portion du transit aura des variations saisonnières de densité de trafic, directement liées aux saisons de pêche locales, principalement le homard et le crabe des neiges. Ce trafic sera une combinaison de navires de pêche locaux et de navires de pêche d'autres ports.
La proposition de Pieridae ne traitait pas de l'impact du projet sur les communautés locales. Cependant, ils disposent d'un plan de communication permanent, d'activités d'engagement local et d'un groupe de travail constitué avec les pêcheurs locaux qui se poursuivra tout au long de la vie opérationnelle de la centrale GNL.
Il n'y a pas de zones opérationnelles spéciales à considérer pour ce projet, à part les zones d'exercices militaires cartographiées, qui s'étendent sur une grande partie de la côte de la Nouvelle-Écosse. Chaque fois que la Marine royale canadienne procède à des exercices dans ces zones, un avertissement de navigation (NAVWARN) est émis par le portail web eNavigation et ceci sera diffusé sur le réseau radio des SCTM Le CET conseille au promoteur de s'assurer que tous les transporteurs de GNL faisant escale au terminal proposé disposent de tous les avertissements de navigation pertinents avant de pénétrer dans les eaux canadiennes.
Tous les navires doivent se conformer au Règlement sur la sécurité de la navigation, en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada de 2001. Ces règlements régissent le transport des systèmes d'identification automatique (SIA).
TC envisage de modifier les exigences relatives à l'emport de SIA afin d'améliorer la surveillance des navires par les autorités canadiennes et par d'autres navires à proximité grâce aux modifications apportées au Règlement sur la sécurité de la navigation, 2020.Note de bas de page 47 Le CET reconnaît que cela permettra également d'améliorer la connaissance de la situation pour les navires qui circulent dans la zone du projet, compte tenu de l'augmentation prévue du trafic lié au projet.
Conclusion 12. Le CET est conscient que tous les navires opérant dans la zone ne sont pas tenus d'être équipés d'un SIA.
Conclusion 13. Pour la partie hauturière du transport de GNL, les navires supplémentaires peuvent être facilement absorbés dans le réseau existant. Les transporteurs de GNL sont assujettis à un processus de contrôle strict de la part des affréteurs, de sorte que le CET ne se soit pas inquiété du fait que les navires du projet puissent accroître le risque pour le réseau.
Conclusion 14. Pieridae a un plan de communication permanent et collabore avec les communautés locales, y compris tous les utilisateurs de l'eau. Il existe également un groupe de travail avec les pêcheurs locaux qui se poursuivra tout au long de la vie opérationnelle de l'usine.
Recommandation 13. Le CET conseille à Pieridae d'enquêter sur les navires « non-SIA » qui se déplacent dans la zone proposée et de prêter une attention particulière aux opérations de pêche saisonnières.
Recommandation 14. Le CET recommande que Pieridae approfondisse son étude sur l'impact sur les communautés côtières.
Recommandation 15. Le CET recommande que Pieridae poursuive son engagement par le biais d'un groupe de travail auprès des pêcheurs locaux.
Recommandation 16. Le CET recommande que Pieridae vérifie que les navires faisant escale au terminal de Goldboro disposent de tous les avertissements de navigation pertinents avant d'entrer dans les eaux canadiennes. Cela assurera qu'il n'y a pas de conflits avec les exercices de la Marine royale canadienne ou d'autres activités dans la région.
3.3 Exploitation des Terminaux
3.3.1 Terminal maritime
Les installations maritimes associées au projet comprendront une jetée GNL consistante en un seul chevalet marin s'étendant de la structure de la chaussée à une tête en T avec deux plates-formes de chargement de GNL. Ils incluront également une installation de déchargement des matériaux (MOF), qui sera utilisée pour la livraison de matériaux de construction et d'équipements pour la construction du terminal. Une fois la phase de construction achevée, le MOF sera converti en poste d'amarrage pour les navires de soutien, qui permettront d'amarrer les navires de soutien nécessaires à l'exploitation du terminal.
Les postes de chargement des cargaisons pourront accepter des navires d'une capacité allant de 125 000 à 266 000 m3, ce qui est le plus susceptible de faire régulièrement escale au terminal. Tableau 3.3.1-1 énumère les caractéristiques proposées pour les terminaux.
| Description | Valeur |
|---|---|
| Poste d'amarrage 1 - taille des navires | 125 000 - 266 000 m3 |
| Poste d'amarrage 2 - taille des navires | 125 000 - 220 000 m3 |
| Distance minimale de la bride par rapport au côté du navire | 2,8 m |
| Distance maximale de la bride face au côté du navire | 3,8 m |
| Dérive transversale perpendiculaire au poste d'amarrage (approchant/partant) | +3,0 m/-1,8 m |
| Dérive totale parallèle au poste d'amarrage (avant/arrière) | +/-3,0 m |
| Espacement minimal des brides sur le collecteur du navire | 3,0 m |
| Espacement maximal des brides sur le collecteur du navire | 4,0 m |
| Hauteur minimale des rails | 1,0 m |
| Distance minimale de l'axe de la bride du bateau par rapport au pont | 4,2 m |
| Distance maximale de l'axe de la bride du bateau par rapport au pont | 5,6 m |
| Collecteur | 16-20 1"/ASME CL150/SS |
Les deux plates-formes de chargement des jetées disposeront d'un espace suffisant pour toutes les installations de surface nécessaires à l'opération de chargement du GNL. Cela englobe des éléments tels que les bras de chargement maritime, les conduites, les vannes et autres équipements, une structure d'accès au navire, une grue de service, les manœuvres et le stationnement des véhicules, l'équipement d'éclairage d'incendie, l'éclairage de la zone, le confinement du GNL et le drainage général. La photo ci-dessous est un diagramme de la surface occupée par l'installation proposée par Pieridae en juillet 2018.
Les plates-formes de chargement de la jetée seront des structures de brassage et de structures d'accostage. On prévoit un total de quatre structures d'accostage et six structures d'amarrage pour chaque jetée.
Les structures (colonnes) de la plate-forme de déchargement seront situées de manière à maintenir un dégagement d'au moins un mètre sur la coque du navire d'accostage lorsque le navire est soumis à un roulis de trois degrés lors de la compression maximale des défenses.
La hauteur des plates-formes de chargement de la jetée va permettre aux crêtes des vagues prévues de passer nettement sous les éléments structurels du pont principal de la plate-forme, empêchant ainsi les charges de soulèvement d'être imposées à la structure. Tous les éléments structurels en acier de la jetée seront revêtus d'une finition anticorrosion conforme aux normes maritimes appropriées.
Les structures d'accostage seront équipées des éléments suivants :
- Un système de défenses approprié pour supporter les charges d'amarrage et les charges dues au vent sur les navires.
- Des crochets d'amarrage à dégagement rapide avec un cabestan intégré pour faciliter la manipulation des lignes.
Malgré que le projet soit censé être un terminal d'exportation, tous les calculs d'énergie d'accostage ont été effectués avec les masses de navires chargés, pour tenir compte de tout scénario qui pourrait nécessiter l'accostage d'un navire chargé au terminal. Cette recommandation est tirée des « Lignes directrices pour la conception de systèmes de défense : 2002 » par la World Association for the Waterborne Transport infrastructure, anciennement l'Association internationale permanente des congrès de navigation (PIANC).
Une structure permettant l'accès aux navires doit être prévue sur la plate-forme de chargement pour un accès en toute sécurité au transporteur de GNL et à partir de celui-ci. Des passerelles seront installées pour relier toutes les structures d'amarrage et d'accostage à la plate-forme de chargement correspondante.
Les postes d'amarrage comporteront des panneaux de défense pour réduire les charges d'amarrage sur les coques des navires lors de l'arrimage à quai.
L'équipement de transfert de cargaison sera composé de deux bras pour les liquides, d'un bras de retour de vapeur et d'un bras hybride (liquide primaire, vapeur secondaire). Les quatre bras devraient être installés sur chaque plate-forme de chargement de la jetée pour faciliter le chargement de toute la gamme de navires prévus dans toutes les conditions d'exploitation. La structure sera conçue de manière à pouvoir fonctionner avec tout navire conçu selon les directives de l'OCIMF.
Le matériel de lutte contre l'incendie, y compris les moniteurs d'incendie et les systèmes utilisant des produits chimiques secs, sera installé sur la plate-forme de chargement de la jetée. Le principal moyen de combattre les incendies et d'assurer le refroidissement sera le recours à des systèmes de lutte contre les incendies télécommandés. Ces derniers permettent de réduire les risques pour le personnel en minimisant le besoin de lutter manuellement contre les incendies.
La conception du système de lutte contre l'incendie sera fondée sur les hypothèses suivantes Note de bas de page 48 :
- Un seul incendie majeur surviendra à la fois
- Une détection précoce des incendies ou des gaz inflammables est prévue à l'intérieur des bâtiments et des zones protégés par des systèmes de détection
- Les incendies seront maîtrisés ou éteints par des systèmes d'extinction fixes, des moniteurs, des bornes d'incendie, des enrouleurs de tuyaux et/ou d'autres moyens mobiles
- Le moyen principal de contrôler les incendies sera d'isoler la source de combustible par un arrêt d'urgence automatique et une dépressurisation manuelle
- La principale méthode de lutte contre les incendies consistera à utiliser des systèmes fixes de pulvérisation d'eau et de surveillance
- Les petits incendies sont maîtrisés à l'aide d'extincteurs portables ou à roulettes
- La brigade de pompiers de l'usine de Goldboro va lutter contre les incendies en utilisant le bon type d'équipement
- Les incendies sur les transporteurs de GNL pendant le chargement seront contrôlés à l'aide des systèmes et équipements de lutte contre l'incendie du navire
- Les dispositifs de lutte contre l'incendie des jetées ne seront utilisés que pour refroidir l'installation de chargement des produits et empêcher la propagation de l'incendie à l'installation
- Selon l'incendie, les méthodes suivantes seront utilisées dans l'établissement :
- Les systèmes de protection automatiques contre l'incendie à base d'eau seront alimentés principalement en eau douce
- L'eau de mer sera utilisée comme source d'approvisionnement de secours et;
- Une mousse à faible expansion est indispensable pour maîtriser un incendie impliquant des hydrocarbures liquides inflammables et combustibles dont le point d'éclair est inférieur à 65 °C.
- Un remorqueur sera présent sur le site, muni d'un équipement de lutte contre les incendies.
La conception et la construction de cette installation seront conformes aux dernières versions des normes internationales reconnues, comme le Code national du bâtiment du Canada, la conception des structures en acier, la conception des structures en béton, etc.
Une zone d'exclusion de 200 mètres autour de chaque jetée de chargement est également prévue dans le schéma 3.3.1-1. La délimitation d'une zone d'exclusion autour d'un bras de chargement de terminal GNL permettrait d'éviter une inflammation accidentelle en cas de déversement lors des opérations de transfert de GNL.
Depuis 2001 en Nouvelle-Écosse, toutes les nouvelles installations de GNL doivent respecter l'Energy Resources Conservation Act, le Gas Plant Facility Regulations [Règlement sur les installations des usines à gaz] et le Nova Scotia Code of Practices for LNG Plants [Code de pratiques pour les usines de GNL de la Nouvelle-Écosse]. Le Gas Plant Facility Regulations [Règlement sur les installations des usines à gaz] est incorporé par référence :
- Le Code of practices [Code de pratiques] qui comporte des exigences et des orientations sur la conception, la construction, l'exploitation et l'abandon des installations terrestres de GNL et de leur jetée et terminal maritime.
- Gaz naturel liquéfié (GNL) : Production, stockage et manutention (CAN/CSA-Z276-18), du Conseil canadien des normes « Pour les installations qui chargent ou déchargent du GNL d'un navire maritime, cette norme contient des exigences relatives à la tuyauterie d'interconnexion entre la bride du bras de chargement/déchargement et le(s) réservoir(s) de stockage, ainsi que d'autres tuyauteries et accessoires sur le quai de la jetée elle-même ».Note de bas de page 49
Le CET n'a formulé aucune conclusion ou recommandation pour cette section (3.3.1).
3.3.2 Accostage et amarrage
Dans leur soumission de 2016, Pieridae a utilisé des simulations pour étudier les dispositions de l'accostage et l'amarrage, afin de déterminer si les éléments de conception pouvaient résister aux charges prévues de toute la gamme de navires qui devraient appeler le terminal. Des analyses d'amarrage statiques et dynamiques ont été réalisées à l'aide de critères metocean. Cette étude a examiné les vents, les vagues et les marées météorologiques et astronomiques historiques prévues sur le site pour les postes d'amarrage proposés pour le GNL de Goldboro.
Cette étude sur l'accostage et l'amarrage se référait aux normes, recommandations et directives pertinentes produites par diverses autorités internationales, comme celles de l'OCIMF et de l'AIPCN. Les normes d'ingénierie qui régissent la conception et l'installation comprennent celles qui sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
| Référence | Titre |
|---|---|
| CNBC 2010 | Code national du bâtiment – Canada 2010 |
| CSA S16-09 | Conception des structures en acier |
| CSA A23.3-04 | Conception de structures en béton |
| CSA A23.1-09 / A23.2-09 | Béton : Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton |
| G40.20-13 | Exigences générales relatives aux aciers de construction laminés ou soudés/Aciers de construction de qualité — Septième édition ; mise à jour n° 1 : Mai 2014 |
| G30.18-09 | Barres en acier au carbone destinées à l'armature du béton — Deuxième édition, mise à jour n° 1 : Août 2012 |
| CSA W48-14 | Métaux d'apport et matériaux connexes pour le soudage à l'arc |
| CSA W59-13 | La construction en acier soudé (soudage à l'arc) |
| Institut canadien de la construction en acier | Code de pratique standard de l'ICCA pour l'acier de construction 2009 - 7e édition |
| CSA S6 | Code canadien sur le calcul des ponts routiers |
| CSA S9 | Calcul des ponts routiers |
| NSTIR | Exigences de la Nouvelle-Écosse en matière de transport et de renouvellement des infrastructures |
| Institut canadien de la construction en acier | Code de pratique standard de l'ICCA pour l'acier de construction 2012 - 10e édition |
| Institut d'acier d'armature du Canada | IAAC Manuel de pratique standard pour l'acier d'armature |
| CSA Z276-15 | Gaz naturel liquéfié (GNL) : Production, stockage et manutention |
| ACI SP-66 | ACI Detailing Manual |
| API RP 2A | American Petroleum Institute - Pratiques recommandées pour la planification, la conception et la construction de plates-formes hauturières fixes |
| Spéc. API 2B | American Petroleum Institute - Spécifications pour la fabrication de tubes en acier de construction |
| Spéc. API 2C | American Petroleum Institute - Spécifications pour les grues offshore |
| BS 6349-1-1 | British Standard - Structures maritimes - Partie 1 : Code de pratique pour la planification et la conception des opérations |
| BS 03/01/6349 | British Standard - Structures maritimes - Partie 1 : Général - Code de pratique pour la conception géotechnique |
| BS 04/01/6349 | British Standard - Structures maritimes - Partie 1 : Général - Code de pratique pour les matériaux |
| BS 6349-2 | British Standard - Structures maritimes - Partie 2 : Conception des murs de quai, des jetées et ducs-d'Albe |
| BS 6349-4 | British Standard - Structures maritimes - Partie 4 : Code de pratique pour la conception des systèmes de défenses et d'amarrage |
| BS 6349-7 | British Standard - Structures maritimes - Partie 7 : Guide pour la conception et la construction de brise-lames |
| RSNS 1989, C. 49 | Réglementation du Code de la construction de la Nouvelle-Écosse |
| NACE RP 01.76 | National Association of Corrosion Engineers - Pratique recommandée - Contrôle de la corrosion de l'acier, des plates-formes offshore fixes associées à la production pétrolière |
| NFPA 59A | NFPA 59A : National Fire Protection Association - Normes pour la production, le stockage et la manutention du gaz naturel liquéfié (GNL) |
| MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE DE LA N.-É. | Code de bonnes pratiques - Installations de gaz naturel liquéfié (ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse) |
En plus d'avoir une profondeur d'eau et une manœuvrabilité adéquates, les installations d'accostage et de jetée doivent satisfaire aux spécifications des transporteurs destinés à faire escale au terminal. Les capitaines et les pilotes doivent veiller à ce que le transporteur puisse manœuvrer dans les installations de manière sécuritaire et efficace.
La stratégie de manœuvre et d'amarrage a été présentée dans l'étude TERMPOL 3.10 « Éléments de chenal, de manœuvre et d'ancrage ». L'Étude sur le dégagement sous quille a conclu que l'emplacement du poste d'amarrage a un dégagement sous quille adéquat pour les transporteurs et les navires de soutien à la construction. Par conséquent, le positionnement des postes d'amarrage ne nécessiterait pas de dragage.
L'Étude de simulation de la navigation a montré qu'il est préférable d'arrimer les navires à bâbord au poste d'amarrage. Il est préférable de s'amarrer à bâbord au poste d'amarrage parce que les navires vont entrer dans la baie par le sud avec le terminal à l'est. Si les navires sont amarrés au quai par leur côté tribord, ils devront faire un demi-tour au départ, à pleine charge, au lieu de faire un demi-tour sur lest à l'arrivée et d'amarrer le navire à bâbord au poste d'amarrage, ce qui lui permettrait de se diriger directement vers la mer. Un tel scénario permettra également de réduire les charges sur le navire liées à sa rotation, et de réduire la puissance nécessaire pour que les remorqueurs puissent faire tourner le navire.
Les plans de signalisation sont essentiels pour s'assurer que le système d'éclairage n'interfère pas avec le champ de vision du pont lors de l'arrivée ou du départ d'un transporteur de GNL. Étant donné que le plan d'éclairage n'était pas encore définitif au moment de la rédaction du présent rapport, Pieridae doit soumettre les plans d'éclairage proposés au CET pour examen dès que les plans sont disponibles et au plus tard 6 mois avant le début des opérations.
Un système de surveillance de l'approche des navires avec un panneau d'affichage approprié sera installé, situé sur le poteau d'amarrage arrière intérieur à chaque poste d'amarrage, bien visible depuis l'aileron de passerelle du navire pendant les manœuvres d'accostage.Note de bas de page 48 Les membres du CET qui ont participé aux simulations d'HR Wallingford ont proposé que des « panneaux d'amarrage de la jetée » aident les pilotes à calculer leur distance par rapport à la jetée et leur vitesse d'approche vers le poste d'amarrage.
Description
« Panneaux d'amarrage de la jetée » aident les pilotes à calculer leur distance par rapport à la jetée et leur vitesse d'approche vers le poste d'amarrage.
La conception du terminal permet aux travailleurs d'accéder aux passerelles d'accostage des ducs-d'Albe, et offre un accès suffisant aux véhicules, aux camions de pompiers ou aux grues mobiles.
Il est intéressant que le terminal soit doté d'une salle de contrôle entièrement équipée et formée, dédiée à la surveillance des opérations du terminal. Une communication cohérente entre l'équipage du navire, les opérateurs du terminal, l'équipage du remorqueur et toutes les parties impliquées dans le chargement ou le déchargement de la cargaison est indispensable lorsqu'un transporteur se trouve à quai.
Le système de contrôle de l'usine contrôlera les activités suivantes qui peuvent être surveillées sur place à la jetée :
- Crochet d'amarrage à dégagement rapide
- Contrôle de la tension des amarres
- Aides à l'accostage des navires et surveillance des défenses; et
- Surveillance de l'environnement et de l'état des océans
Les procédures d'accostage et d'amarrage doivent être définies au moins 6 mois avant le début des opérations et doivent être reflétées dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux (sections 3.3.4 et 3.3.5). Les procédures doivent préciser :
- Les méthodes d'accostage et de désaccostage des transporteurs de GNL et le nombre de remorqueurs requis.
- Le nombre de chaloupes d'amarrage et le personnel nécessaire pour l'amarrage.
- Vitesse d'amarrage.
- Limitation des limites/critères environnementales et opérationnelles pour l'accostage, le désaccostage.
- Systèmes d'aide à l'accostage disponibles :
- Un tableau d'amarrage de la jetée qui mesure la vitesse d'approche et la distance à la jetée, affichant les informations aux navires prévus; et
- Unité de pilotage portable (UPP) : appareil portatif doté d'un écran de carte de navigation électronique, d'un GPS, d'un SIA, de données Metocean et d'autres informations importantes.
Conclusion 15. Le CET partage la conclusion d'HR Wallingford concernant l'existence d'une marge de manœuvre suffisante en mer dans la voie navigable de transit.
Conclusion 16. Pieridae se référera et incorporera les normes, recommandations et directives pertinentes de diverses autorités internationales comme celles produites par l'OCIMF et l'AIPCN pour les procédures d'accostage et d'amarrage.
Conclusion 17. Le plan de signalisation n'était pas complet au moment de la rédaction du présent rapport. Les plans de signalisation sont essentiels pour s'assurer que le système d'éclairage bloque le champ de vision depuis la passerelle d'un transporteur de GNL à l'arrivée ou au départ.
Conclusion 18. Les procédures d'accostage et d'amarrage permettront au CET d'examiner le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux une fois les documents soumis.
Recommandation 17. Le CET recommande que Pieridae inclue des références aux listes de contrôle et aux directives de l'OCIMF et de l'AIPCN dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux de Goldboro GNL.
Recommandation 18. Le CET recommande que Pieridae applique la recommandation de l'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNL qui prévoit l'ajout de panneaux d'amarrage de la jetée qui aideraient les pilotes à déterminer leur distance de la jetée et leur vitesse d'approche vers le poste d'amarrage.
Recommandation 19. Le CET recommande que Pieridae présente son projet de plan de signalisation du terminal au CET afin d'évaluer les interactions avec les feux existants dans la zone. Ce plan doit être soumis dès qu'il est disponible et au moins 6 mois avant le début des opérations.
Recommandation 20. Le CET recommande que Pieridae fixe les procédures d'accostage et d'amarrage avant de soumettre le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux à TC afin que le ministère puisse en tenir compte lors de l'examen des documents.
Recommandation 21. Le CET recommande que Pieridae incorpore des planches d'amarrage dans la conception finale du poste d'amarrage.
3.3.3 Opérations de transbordement de la cargaison
Durant leur séjour dans les eaux canadiennes, les navires qui transfèrent du GNL doivent respecter le Règlement canadien sur la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux (VPDCR), le Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Code IGC), les directives de l'industrie et d'autres bonnes pratiques. Le VPDCR prévoit des normes environnementales strictes qui contribuent à prévenir le rejet délibéré, négligent et accidentel de polluants provenant des navires dans les eaux canadiennes.
Le terminal maritime de Goldboro est construit de manière à ce que six pompes de chargement de GNL fonctionnent avec un débit de 2 000 m3/h pour un débit continu maximum de 12 000 m3/h pour chaque transporteur de GNL. Deux bras à liquide et un bras hybride (retour de liquide ou de vapeur) auront un taux de charge nominal de 4 000 m3/heure.
Dans leur soumission, Pieridae a présenté des procédures de transfert et des listes de contrôle qui feront partie de leur Manuel de transfert de cargaison/Manuel d'exploitation des terminaux, sur la base des recommandations du SIGTTO. La construction des systèmes de transfert doit respecter tous les normes, codes et meilleures pratiques applicables.
Pieridae doit veiller à ce que tout le personnel d'exploitation et de maintenance travaillant à Goldboro soit correctement formé pour effectuer son travail en toute sécurité, y compris :
- Sécurité du GNL
- Opérations cryogéniques
- Procédures de chargement des navires
- Un fonctionnement correct de tous les équipements terminaux et ;
- Procédures d'urgence
Pieridae doit élaborer des procédures opérationnelles et des supports de formation une fois la conception finale du terminal terminée et fournir une formation suffisante pour s'assurer que le personnel opérationnel de Goldboro comprend les procédures de sécurité. Ces procédures devraient :
- Faire partie des plans d'urgence du terminal.
- Examiner les opérations des transporteurs de GNL, telles que le démarrage, l'arrêt, le refroidissement, la purge, l'exploitation et la surveillance régulières.
- Porter une attention particulière à la coordination avec les responsables locaux en matière de gestion et d'intervention en cas d'urgence pour les scénarios d'urgence.
Le guide MTOCT (Marine Terminal Operator Competences and Training) de l'OCIMF permet aux gestionnaires de terminaux maritimes de s'assurer que les personnes qui travaillent à l'interface navire/terre ont toutes les compétences et l'expérience nécessaires. Le guide identifie les compétences clés et les connaissances nécessaires pour différents rôles.
Recommandation 22. Le CET recommande que Pieridae développe des procédures d'exploitation et vérifie que tout le personnel est formé pour des opérations de transfert de cargaison en toute sécurité.
Recommandation 23. Le CET recommande que Pieridae assure que tout le personnel du terminal soit formé selon les normes recommandées par l'OCIMF dans le «Guide de compétence et de formation des opérateurs de terminaux maritimes ».
Recommandation 24. Pieridae devrait inclure la liste de contrôle de sécurité navire/terre SIGTTO dans son Manuel d'exploitation des terminaux.
Recommandation 25. Une fois que la configuration du système de transfert de cargaison est finalisée et avant de soumettre le Manuel d'exploitation des terminaux, Pieridae doit informer TC de toute révision de ces plans. Cela permettra à TC de décider si d'autres examens sont nécessaires.
3.3.4 Livre d'information sur les ports
Le Livre d'information sur les ports donne à l'équipage des informations sur le terminal maritime et sur la route à suivre pour s'y rendre. Conformément au processus d'examen TERMPOL, version 2014 (TP 743), le CET souhaite que Pieridae dépose son Livre d'information sur les ports, au moins six mois avant le début des opérations.
Cela permettra au CET de veiller à ce que des mesures d'atténuation soient mises en place avant le début des opérations. Une copie du Livre d'information sur les ports doit être fournie à tous les transporteurs de GNL avant qu'ils ne fassent escale au terminal GNL de Goldboro.
Le Livre d'information sur les ports doit comprendre :
- Consignes d'embarquement des pilotes et limites opérationnelles
- Renseignements sur les remorqueurs et exigences en matière d'assistance
- Informations relatives à l'entrée dans les ports
- Instructions de notification
- Description du terminal
- Cartes marines et publications nautiques utiles
- Instructions d'accostage spécifiques au site
- Limites maximales des opérations d'accostage
- Sécurité et questions relatives à la santé et à la sécurité industrielles
- Mesures d'urgence
- Politiques, procédures et listes de contrôle
Consultez le Processus d'examen TERMPOL (TP 743) pour consulter la liste complète des exigences en matière du Livre d'information sur les ports.
Recommandation 26. Le CET recommande que Pieridae leur fournisse une copie du Livre d'information sur les ports au moins 6 mois avant le début des opérations du terminal. Cela va permettre un examen rapide et contribuera à garantir que toutes les procédures et mesures d'atténuation sont en place avant le début des opérations. Le Livre d'information sur les ports doit être transporté à bord de tout transporteur de GNL faisant escale au terminal de Goldboro.
3.3.5 Manuel d'exploitation des terminaux
Le Manuel d'exploitation des terminaux renseigne le personnel des transporteurs de GNL sur les facteurs affectant la sécurité et l'efficacité des navires, du terminal et des opérations de transfert de cargaison.
Pieridae devrait remplir le Manuel d'exploitation des terminaux et le soumettre à TC au moins six mois avant le début des opérations. TC veillera à ce que le manuel englobe tous les points pertinents, y compris :
- Listes de contrôle avant l'arrivée et avant le départ
- Liste de contrôle de sécurité navire/terre de SIGTTO
- Procédures de transfert de la cargaison, y compris les inspections, les listes de contrôle et les réunions préalables au transfert
- Communications entre navires et terminaux, et hiérarchie
- Équipements de transfert de cargaison dans les terminaux, y compris des informations sur les inspections, les essais et la maintenance préventive
- Procédures d'urgence, interventions d'urgence et plans d'urgence
- Limite maximale de tous les facteurs atmosphériques qui nécessiteraient l'arrêt des opérations de transfert de cargaison ou la déconnexion du bras de chargement maritime.
- Procédures de gestion de l'accès au navire pendant les opérations de transfert
Consultez le Processus d'examen TERMPOL (TP 743) pour obtenir la liste complète des exigences en matière du Manuel d'exploitation des terminaux.
Recommandation 27. Pieridae doit vérifier que toutes les politiques et procédures basées sur le Rapport de simulation de navigation GNL d'HR Wallingford Goldboro sont complétées à temps pour être intégrées dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux.
Recommandation 28. Le CET recommande que Pieridae leur fournisse un exemplaire du Manuel d'exploitation des terminaux au moins 6 mois avant le début des opérations, afin que TC soit en mesure de vérifier que toutes les procédures et tous les plans d'urgence sont en place avant le début des opérations.
3.4 Évaluation des risques et planification d'urgence
3.4.1 Évaluation des risques
L'évaluation des risques par HR Wallingford a été organisée en utilisant l'évaluation formelle de la sécurité (FSA) de l'OMINote de bas de page 50. L'évaluation formelle de la sécurité (FSA) comporte cinq étapes :
- Identifier les risques, y compris une liste de tous les scénarios d'accident significatifs avec leurs causes et résultats potentiels. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner?
- Évaluer les risques. Jusqu'à quel point un accident peut-il être grave et quelle est la probabilité pour qu'il se produise?
- Prévoir des moyens de contrôler ou de réduire les risques. Comment peut-on améliorer les conditions?
- Établir le coût et l'efficacité de chaque option.
- Proposer des mesures à prendre.
La zone de délimitation prévue pour l'installation proposée s'étend de Douvres (61 ° de longitude ouest) à Sherbrooke (62 ° de longitude ouest), soit un total de 76 km (47 nm) le long de la côte, et jusqu'à la limite de la mer territoriale canadienne (jusqu'à une distance de 12 miles nautiques).
Selon l'évaluation des risques du promoteurNote de bas de page 51 , le projet proposé et les transporteurs de GNL associés augmenteront probablement le risque d'accidents et de déversements dans la zone d'étude. Une fois construit, Pieridae prévoit 206 escales de transporteurs au terminal chaque année, ce qui se traduirait par moins d'un transit de transporteurs entrants et sortants par jour.
Comme cette étude portait sur Country Harbour, où un seul transporteur de GNL se déplacera à la fois, l'évaluation des risques n'a pas utilisé la méthode de modélisation du trafic maritime. Les dangers possibles ont été identifiés dans le cadre de trois scénarios :
- Les transporteurs de GNL entrant et sortant de la zone du Country Harbour
- Les transporteurs de GNL arrivant et partant du poste d'amarrage, et
- Autres transports arrivant et sortant de la zone du Country Harbour
Conclusion 19. Le CET a constaté que l'évaluation des risques soumise par Pieridae n'incluait pas les risques suivants dans son analyse, conformément au document TP 743.Note de bas de page 2
- La probabilité d'un incident majeur de transfert de cargaison sur le quai du terminal
- Limites géographiques d'un rejet non contrôlé de GNL
- Faiblesses du système de confinement du GNL des transporteurs de GNL suite à une collision, un accrochage ou un échouement dans la zone
- La probabilité d'un rejet de GNL non contrôlé à grande échelle dans la zone
- La proximité de la population locale par rapport aux nuages de vapeur et aux sources d'inflammation éventuelles
- Analyse des risques de la zone offshore (y compris, mais sans s'y limiter, les tempêtes électriques violentes, les actes délibérés et les déversements pendant les opérations de cargaison)
Recommandation 29. Le CET recommande que Pieridae effectue une évaluation des risques supplémentaires sur les composants énumérés dans la conclusion 19.
3.4.2 Risques liés aux nuages de gaz
Le GNL est du gaz naturel, refroidi à -160 °C, à la pression atmosphérique, et réduit à l'état liquide. Les matériaux qui ne peuvent pas supporter le froid peuvent se fissurer s'ils entrent en contact avec le GNL. Par conséquent, la manipulation du GNL nécessite des équipements et des installations spécifiques.
En tant que liquide, le GNL est ininflammable et ne peut pas exploserNote de bas de page 52. Par contre, si le GNL est libéré et réchauffé, il peut se transformer en gaz inflammable. Ce gaz peut toutefois s'enflammer en présence d'une source d'inflammation, mais seulement dans une fourchette de 5 % (limite inférieure d'inflammabilité) à 15 % (limite supérieure d'inflammabilité) de vapeur dans l'air en volume. Bien que cette fourchette étroite réduise le risque global, la manipulation et le transfert en toute sécurité du GNL sont essentiels à la sécurité publique.
Un nuage de vapeur explosif peut causer la mort et des dommages matériels dans son voisinage. Les brûlures par rayonnement peuvent également se produire à proximité d'un nuage de vapeur enflammée. Des décharges avec surpression mortelle sont possibles si la vapeur s'accumule dans des espaces confinés avant de s'enflammer. L'évaluation de ces risques est un processus complexe, mais une approche judicieuse consisterait à calculer le nombre de décès potentiels dus à une explosion.Note de bas de page 2
La publication TP 743, section 3.13.1, oblige le promoteur à réaliser une étude d'analyse des risques pour :
- Analyser les risques de navigation et d'exploitation qui peuvent entraîner le rejet de polluants et de substances dangereuses et nocives soit en route, soit à un terminal
- Trouver des moyens de limiter ces risques
Le TP 743 prévoit des considérations particulières pour les navires transportant du GNL, notamment :
- La vulnérabilité du système de confinement de la cargaison du transporteur de gaz naturel liquéfié après une collision ou un échouement dans la zone
- La probabilité d'un rejet de GNL non contrôlé à grande échelle dans la zone
- La quantité « théorique », le taux et la durée du rejet de la cargaison de gaz liquéfié en vrac et les dimensions du nuage de vapeur résultant
- La proximité des populations par rapport aux limites des nuages de vapeur et la répartition des sources de combustion possibles
- Conséquences du rayon d'impact en cas de feu de nappe, de surpression d'un nuage de vapeur et d'explosions rapides en phase de transition
- Les conséquences du rayon d'impact pour l'asphyxie due au déplacement d'oxygène et l'exposition par contact cutané direct provoquant des gelures ou une mortalité potentielle due au gel
- La vulnérabilité des réservoirs de stockage adjacents quant à leur risque d'être compromis et leurs volumes cumulés de substances explosives pouvant contribuer à des incendies et des explosions supplémentaires, et donc, à des rayons d'impact et des conséquences plus importantes.
Conclusion 20. Le CET a observé que Pieridae n'a pas analysé les risques et les mesures d'atténuation liés à la libération d'un nuage de gaz.
Recommandation 30. La TRC recommande que Pieridae procède à une mise à jour de l'analyse des risques en tenant compte de la probabilité de libération d'un nuage de gaz, conformément au document TERMPOL TP 743. Cette analyse devrait inclure les limites géographiques d'une libération incontrôlée de la cargaison. Toute mesure d'atténuation doit être inscrite dans le Plan d'urgencede Goldboro.
3.4.3 Méthodes envisagées pour réduire les risques
L'évaluation des risques réalisée par HR Wallingford a défini les principales mesures d'atténuation suivantes pour réduire les risques :Note de bas de page 51
- Veiller à ce que quatre remorqueurs soient disponibles pour tout Transporteur GNL entrant et sortant.
- Assurer qu'un seul navire effectue des manœuvres à la fois.
- Créer des procédures et former les pilotes et les équipages de remorqueurs, afin de s'assurer qu'ils sont en mesure de savoir quoi faire en cas d'urgence.
- Ne pas effectuer de manœuvres en cas de mauvaise visibilité.
- Assurer que les remorqueurs sont équipés de moyens de lutte contre les incendies pertinents pour les transporteurs de GNL.
- Ne pas faire manœuvrer les transporteurs de GNL lorsque la vitesse du vent est supérieure à 25 nœuds ou à une autre vitesse de vent limite à déterminer.
- Assurer la disponibilité des navires de garde pendant les manœuvres si l'autre poste d'amarrage est occupé.
- Mettre fin aux opérations de transfert de cargaison sur le poste d'amarrage adjacent.
- Rédiger des instructions pour réduire la possibilité qu'un nuage de gaz s'enflamme si un navire s'approche du transporteur de GNL situé au quai, par exemple pour arrêter le transfert de GNL.
De plus, Pieridae a proposé une zone d'exclusion marine de 200 mètres à partir du navire au poste d'amarrage, car il s'agit d'une bonne pratique courante.
Pieridae a également défini des dispositions et des procédures d'urgence en cas d'incendie à bord d'un transporteur GNL alors qu'il se trouve à côté du terminal. Par exemple :
- Les recommandations de l'ISGOTT seront respectées, de sorte que le navire restera à quai pendant un incendie lorsque cela sera possible.
- Tous les remorqueurs seront équipés de moyens d'intervention en cas d'incendie. Au moins un parmi ces quatre remorqueurs doit être disponible en moins de 10 minutes et les trois autres en moins de 30 minutes.
- Les principaux moteurs d'un navire et les systèmes connexes seront prêts pour un départ d'urgence avec l'aide d'un remorqueur.
- Aucun maintien du navire, et plus précisément aucune réparation des moteurs du navire, ne sera autorisé sur le quai.
L'évaluation des risques a été soumise en juillet 2018. L'Étude de simulation de la navigation qui a été présentée en mars 2019, comprenait des recommandations supplémentaires concernant les aides à la navigation et l'utilisation de remorqueurs en vue de réduire les conséquences des pannes de moteur, des pannes de remorqueur, des pertes de direction, etc. (Voir la section 3.2.3 et l'Annexe 6).
3.4.3.1 Aides à la navigation
En avril 2016, la section 3.3 - Aides à la navigation, du rapport Preuve de concept - Rapport sur les simulations de manœuvresfaisait référence à « quatre aides à la navigation flottantes supplémentaires envisagées pour le projet ». L'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNL a conclu qu'aucune aide flottante supplémentaire à la navigation n'était nécessaire, bien que les pilotes aient pensé qu'une navigation par alignement (ensemble de feux d'alignement ou de feux à secteurs) serait utile.
Recommandation 31. Le CET recommande que Pieridae travaille en collaboration avec la Garde côtière canadienne afin de discuter de tout changement ou ajout proposés au système d'aides à la navigation afin de garantir le maintien d'un niveau de service continu pour les utilisateurs actuels de la région.
3.4.3.2 Metocean et les critères limitatifs des activités
Le CET a remarqué que les critères de limitation Metocean n'étaient pas clairement identifiés dans la conclusion ou les recommandations de l'Étude de simulation de navigation. Une bouée intelligente, également connue sous le nom de bouée météorologique ou de système pour l'acquisition de données océaniques (ODAS), située à proximité de la station de pilotage, permettrait de mesurer les conditions météorologiques en temps réel. Pieridae doit confirmer les conditions restrictives de l'exploitation du GNL de Goldboro dans l'océan.
Recommandation 32. Pieridae devrait consulter Environnement et changement climatique Canada pour examiner les exigences et les sources de financement d'une bouée intelligente (systèmes, aides et dispositifs pour l'acquisition de données océaniques (SADO) / bouée météo) à la station d'embarquement des pilotes.
Recommandation 33. Pieridae doit confirmer les limites Metocean identifiées dans les simulations et les inclure dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux.
3.4.3.3 Services de trafic maritime
Actuellement, il n'y a pas de zones de services de trafic maritime (STM) dans la zone du projet, et il n'y a pas non plus de couverture radio sur les fréquences du RADAR ou des STM. Le fait de disposer d'une zone STM dans la région de Goldboro permettrait de limiter le trafic d'autres navires si nécessaire, lorsque des navires méthaniers circulent, comme le terminal GNL de Saint John, au Nouveau-Brunswick.
La mise en place d'une mesure de routage, par exemple la création d'une zone de précaution à l'entrée de Country Harbour, pourrait être envisagée. Cependant, l'OMI recommande que des mesures alternatives soient envisagées avant de réaliser ces solutionsNote de bas de page 53. Le trafic est négligeable dans la région, de sorte qu'une étude devrait être réalisée pour établir ces exigences.
Les promoteurs qui exigent des services de trafic maritime pour un système à utilisateur unique sont responsables des coûts d'investissement initiaux pour établir l'infrastructure nécessaire pour appuyer le service. Il est essentiel pour Pieridae d'engager la GCC dès le début afin d'avoir une analyse complète des besoins de tout service nouveau et équipement requis dans la région de Goldboro. Cet examen vise à vérifier que tout nouveau système fonctionne bien avec l'équipement existant du centre des SCTM. Les coûts d'exploitation et de maintien des nouveaux systèmes feront l'objet d'un processus de consultation avec le promoteur.
Le personnel utilisant l'équipement de communication doit également respecter le Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF, le Règlement sur les stations de navire (radio) et le Règlement technique sur les stations de navire (radio) de la LMMC, 2001.Note de bas de page 54
Conclusion 21. Il n'y a pas de services de trafic maritime (STM) dans la zone d'étude de Goldboro. Si Pieridae souhaite une couverture STM pour Country Harbour, tous les frais y afférents seraient à sa charge, car le port serait pour un seul utilisateur.
Conclusion 22. Le CET a constaté que les SCTM sont en mesure d'appuyer soit l'établissement d'une nouvelle zone de services de trafic maritime, soit l'extension de la zone de services de trafic maritime existante de Canso.
Recommandation 34. Pour la couverture STM et RADAR, le CET recommande que Pieridae demande une étude aux SCTM de la GCC. La portée et le positionnement du site pour le STM, le RADAR et la couverture radio devront être discutés par Pieridae et le SCTM. Étant donné que le nouveau service serait destiné à un seul utilisateur, Pieridae devrait payer tous les frais associés.
Recommandation 35. Le CET recommande que Pieridae, en plus d'envisager l'établissement d'une zone de précaution, étudie d'autres solutions conformément à la résolution A.572(14) de l'OMI. Pieridae doit communiquer avec le bureau régional de TC si l'analyse des risques révèle qu'une telle mesure est nécessaire.
3.4.3.4 Remorqueurs
Selon les résultats de l'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNL, Pieridae a proposé que 4 remorqueurs soient mis à disposition au large de la bouée de chenal « TT » aux fins d'escorte, si nécessaire.
À l'intérieur du port, il y a amplement de place (plus d'un mille nautique du terminal à la rive opposée) pour des manœuvres avec l'aide de remorqueurs.
Les remorqueurs doivent satisfaire à toutes les exigences de la Loi de la marine marchande du Canada 2001, en matière d'enregistrement, d'équipage et de certification. Les exploitants de remorqueurs doivent détenir des certificats de classe 2 pour les voyages à proximité du littoral (ils peuvent naviguer jusqu'à 25 nm de la côte) ou des certificats de classification de voyage plus exigeants pour se conformer au régime d'immatriculation, d'équipage et d'inspection de Transports Canada. Les propriétaires de remorqueurs ont accès à ces informations directement par l'intermédiaire de SSM de TC ou du programme d'inspection statutaire délégué d'un organisme reconnu.
Une bonne communication entre les capitaines de remorqueurs et les responsables de projets est essentielle. La convention STCW, par le biais de la règle VIII/2, présente les exigences relatives aux dispositions et aux principes de veille pour les capitaines et l'ensemble du personnel. Le respect de ces dispositions assure une surveillance continue et sécuritaire des navires à tout moment.
Conclusion 23. Le CET approuve la proposition de Pieridae et les simulations d'HR Wallingford concernant l'utilisation de quatre remorqueurs pour escorter les transporteurs de GNL.
Conclusion 24. Le CET reconnaît que, sur la base des simulations, l'utilisation de remorqueurs d'escorte contribuera à réduire le risque d'échouage.
Conclusion 25. Le CET a constaté que Pieridae s'est engagé à fournir des remorqueurs d'escorte dotés d'une solide capacité de lutte contre les incendies.
Recommandation 36. Le CET recommande que les remorqueurs soient équipés de cellules de pesage pour mesurer les forces de traction sur la ligne lorsqu'ils sont attachés à un navire.
Recommandation 37. Le CET recommande que la conception des remorqueurs soit normalisée afin de permettre des remplacements de remorqueurs sans faille et des pièces et équipements interchangeables pour garantir qu'il y ait suffisamment de remorqueurs disponibles à tout moment.
Recommandation 38. Le CET recommande que tous les remorqueurs soient équipés de treuils d'extraction/récupération afin de renforcer les capacités pour les fonctions d'escorte et d'accostage.
Recommandation 39. Le CET recommande que tous les remorqueurs d'escorte soient équipés de matériel de sauvetage pour aider les transporteurs de GNL, y compris du matériel pour le remorquage en cas d'urgence. Les transporteurs doivent également disposer d'un équipement qui permet de relier rapidement les engins de remorquage en toute sécurité. Il est essentiel que les transporteurs de GNL et les remorqueurs d'escorte soient compatibles.
Recommandation 40. Le CET recommande que Pieridae installe sur tous ses remorqueurs les équipements de lutte contre l'incendie les plus récents.
Recommandation 41. Le CET recommande que Pieridae vérifie que tous les transporteurs du projet respectent les exigences des procédures de remorquage d'urgence de la règle 11-1/3-4 de la convention SOLAS (résolution 258 [84] de l'OMI).
3.4.3.5 Pilotage
Pieridae a annoncé qu'il prévoit la présence d'un pilote à bord lors de tout mouvement de transporteur de GNL, avec une station d'embarquement de pilotes au large de la bouée de chenal « TT ». Pour que le terminal proposé se transforme en zone de pilotage obligatoire avec une « station d'embarquement des pilotes », l'APA devra procéder à une Examen de la méthodologie de gestion des risques de pilotage (PRMM) qui estNote de bas de page 55 utilisée pour :
- Identifier ou réviser les zones de pilotage obligatoire.
- Déterminer la taille et le type de navires soumis au pilotage obligatoire
- Adopter ou modifier des politiques ou des pratiques essentielles comme le double pilotage ou le recours aux dérogations.
Si l'évaluation PRMM révèle qu'il n'est pas nécessaire que la zone soit une zone de pilotage obligatoire, Pieridae doit s'assurer que toutes les procédures opérationnelles du GNL Goldboro prévoient que le capitaine engage un expert maritime local pour aider le navire à se rendre au poste d'amarrage.
L'APA prend des dispositions pour que les pilotes et les apprentis pilotes suivent une formation en simulation afin d'assurer une bonne gestion du pont. La résolution A960 de l'OMI confère aux autorités le soin de définir et de gérer la formation des pilotes. Tous les pilotes brevetés de la région auront besoin d'une formation par simulation (modèles virtuels ou manœuvre sur modèles). Le directeur général de l'APA a également convenu que les pilotes devraient recevoir une formation avant le début des opérations.
Conclusion 26. Le CET reconnaît qu'il serait prudent d'avoir des pilotes de l'APA pour un accostage et un désaccostage sécuritaires au terminal proposé.
Conclusion 27. Le CET reconnaît qu'il existe de nombreuses façons de réduire les risques lors des déplacements vers et depuis le terminal. L'équipe de gestion de la passerelle du navire et les pilotes utilisent le RADAR et les aides électroniques pour contrôler la position, la vitesse et la rapidité de virage du navire afin de le diriger en toute sécurité. L'APA peut également restreindre l'accès d'un navire à un pilote s'il y a moins de 2 nm de visibilité.
Recommandation 42. Le CET recommande que tous les pilotes maritimes brevetés de la région devra suivre une formation par simulation ou un entrainement à la manœuvre sur modèles avant le début des opérations du terminal.
Recommandation 43. Pieridae doit veiller à ce que tous les transporteurs de GNL disposent d'un expert maritime local pour guider le navire vers son poste à quai, si l'APA décide que Goldboro n'a pas besoin d'être une zone de pilotage obligatoire (Section 3.4.2.5)
3.4.3.6 Autorité portuaire
Selon l'étude d'évaluation des risques, une autorité portuaire ayant les pouvoirs appropriés devrait être établie pour Country Harbour.Note de bas de page 51
La LMC a été créée en 1996 et propose un modèle de gouvernance pour gérer les ports et les installations gérés par le gouvernement fédéral. Cela comprend les ports qui étaient précédemment exploités sous la forme d'une commission portuaire, d'une « Société canadienne des ports » ou d'un port public fédéral. Country Harbour n'est pas un port inscrit sur la liste de la Loi, par conséquent il ne peut pas être reconnu comme une autorité portuaire canadienne ou comme un port public.
Après avoir consulté le conseiller national sur l'exploitation des ports, il a été établi clairement que le terminal de Goldboro est une entité privée et n'est pas sujet à la LMC. Bien qu'il soit réglementé par d'autres lois fédérales comme la LMMC, 2001, la LMC n'est pas applicable à ce port. Pieridae doit éviter toute référence à une autorité portuaire canadienne dans la documentation relative au terminal GNL de Goldboro.
Conclusion 28. Le CET a constaté l'utilisation constante du terme de marque déposée de TC « Autorité portuaire/Administration portuaire » pour désigner Goldboro dans les documents de soumission. Étant donné que Goldboro n'est pas un port public reconnu par la LMC, l'utilisation du terme « Autorité portuaire/Administration portuaire » pourrait être mal interprétée par le public et constituerait une violation des articles 7 et 9 de la Loi sur les marques.
Recommandation 44. Conformément à la Conclusion 28 du présent rapport, le CET recommande que Pieridae modifie toutes les références au terme de marque « Autorité portuaire/Administration portuaire » dans toute la documentation liée à Goldboro pour indiquer « Gestion portuaire » ou le poste générique de capitaine de port en tant que personne/employé désignée en charge des opérations portuaires.
3.4.3.7 Zones d'exclusion ou de sécurité
Des zones d'exclusion ont été créées pour protéger le public contre les conséquences d'un rejet accidentel de GNL. Les opérateurs sont tenus par la loi de contrôler toutes les activités se déroulant autour d'une installation de GNL qui pourraient être affectées par la chaleur rayonnante d'un incendie ou de vapeur.
Pieridae a identifié le besoin d'une zone d'exclusion marine autour du terminal de 200 mètres pendant le chargement des transporteurs de GNL. Cette zone est celle qui serait affectée par une perte de confinement pendant le chargement. Les restrictions seront mises en place pour éviter les sources de combustion dans cette zone pendant le chargement (par exemple, aucun navire ou véhicule dans la zone, personnel limité, zone autorisée).
Pieridae n'a pas inclus d'études liées à la zone d'exclusion ou de sécurité marine. Le rapport SANDIA « Guidance on Risk Analysis and Safety Implications of a Large Liquefied Natural Gas (LNG) Spill Over Water »Note de bas de page 56 peut servir de référence pour déterminer la nécessité de zones de sécurité. Ce processus permet de modéliser le panache gazeux afin de déterminer les distances auxquelles l'effet thermique d'un feu de nappe de GNL se produit à partir de rejets de réservoirs de différentes tailles, en tenant compte du vent, du courant et de la topographie. Cela permettrait également de déterminer les risques encourus par les populations le long de l'itinéraire de transit et lors de l'accostage à Goldboro.
L'Organisation maritime internationale (OMI) et la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ne disposent pas de normes concernant les zones d'exclusion ou de sécurité maritime. Au Canada, il y a quelques moyens de créer des zones de sécurité autour des navires. La LMC autorise les autorités portuaires à créer des zones de sécurité dans les limites des ports, avec leurs procédures et systèmes portuaires. L'Autorité portuaire de Saint John a établi des mesures de sécurité au terminal GNL Canaport, pleinement opérationnel dans le port de Saint John Note de bas de page 57:
- Contrôles de sécurité de l'équipage du navire par TC
- Aide aux remorqueurs attachés
- Une zone d'exclusion sécuritaire de 0,5 mille nautique (925 m) autour du transporteur de GNL en navigation
- Aucun ancrage dans 1,5 miles nautiques (2,7 km) du transporteur de GNL
- Aucun dépassement du transporteur de GNL en navigation dans le port
- Un rayon de 0,3 mille nautique (620 m) à partir du centre du terminal est fermé à tout trafic maritime, à l'exception des remorqueurs et des embarcations de service qui assistent le transporteur de GNL durant les opérations de déchargement du GNL
Comme Goldboro ne se trouve pas au sein d'une autorité portuaire, il ne serait pas possible de créer une zone de sécurité dans le port en vertu de la LMC.
TC mène un projet de recherche international concernant les zones de contrôle marines. La recherche est axée sur l'apprentissage :
- Si les zones de contrôle maritime actuelles diminuent le risque d'accidents maritimes qui nuisent à l'environnement.
- Comment aménager les zones de contrôle maritimes.
- Comment ils pourraient être réalisés et exécutés dans le cadre juridique et réglementaire canadien.
- Le coût de la mise en place des zones de contrôle maritimes et qui devra supporter le coût de leur application.
Le CET reconnaît la nécessité de poursuivre les travaux pour examiner la question des zones de sécurité pour les terminaux GNL dans le but de créer une approche qui intègre les circonstances uniques de chaque terminal maritime.
Conclusion 29. Le CET considère que le rapport SANDIA est un document de référence reconnu au niveau international qui identifie la création de zones d'exclusion comme un moyen de gérer les risques liés aux dangers thermiques, en cas de rejet accidentel ou intentionnel de GNL.
Conclusion 30. Le CET a constaté que l'analyse de Pieridae de la zone d'exclusion autour du GNL au poste d'amarrage est basée sur des zones existantes des autres juridictions.
Recommandation 45. Concernant la zone d'exclusion de 200 mètres, le CET recommande que Pieridae mène une étude en utilisant des méthodes comme SANDIA. L'étude doit tenir compte des conditions locales et devra inclure la contribution des utilisateurs des voies navigables, afin de justifier la nécessité et la taille d'une zone de sécurité. Les informations concernant la zone de sécurité devront être incluses dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux.
3.4.3.8 Gestion des incidents
Le CET propose que les incidents survenant au terminal de Goldboro soient gérés dans le cadre du système de commandement des interventions (SCI) du terminal GNL de Goldboro afin de faciliter les interventions d'urgence. Le système est un système de gestion des incidents multirisques qui se fonde sur les meilleures pratiques internationales. Il a été largement adopté par de nombreux organismes dans le monde, dont la Garde côtière canadienne et TC.
Il se caractérise par une normalisation qui permet aux organismes de travailler en collaboration sous une structure unique avec un plan d'intervention consolidé. Le SCI nécessite une formation et une certification officielles. Les gestionnaires de terminaux et autres personnels essentiels doivent être certifiés pour le SCI.
Recommandation 46. Le CET recommande que Pieridae vérifie que tout le personnel du terminal GNL de Goldboro est bien formé pour les urgences liées aux GNL.
Recommandation 47. Le CET a recommandé que Pieridae vérifie que le personnel du terminal GNL a reçu une formation officielle et accréditée en matière de système de commandement des incidents avant le début des opérations.
3.4.4 Planification d'urgence
Un plan d'urgence fournit des directives et des instructions qui permettent de réagir rapidement en cas d'urgence. Le succès de tout plan en cas d'urgence dépend de la capacité du personnel à exercer ses rôles et ses responsabilités lors des exercices planifiés.
Au jour de la rédaction du présent rapport, Pieridae n'avait pas encore défini un plan d'urgence pour le terminal, bien qu'il se soit engagé à préciser et à soumettre ce plan à TC et à la Garde côtière canadienne au moins six mois avant le début des opérations.Note de bas de page 58 Cet examen permettra aux Pieridae de
- Associer le plan d'urgence aux procédures d'urgence existantes.
- Prévoir une intervention coordonnée avec les autres autorités locales.
Le plan d'urgence doit se composer de deux parties : les navires et les opérations du terminal lorsqu'un navire est à côté. Ce plan doit inclure divers scénarios pour des événements tels qu'un incendie à bord, un transfert de cargaison inapproprié, une urgence au terminal, etc.Note de bas de page 2
Pieridae a également pris l'engagement de réaliser une étude montrant l'impact d'un accident sur une tierce partie, qui comprend des mesures correctives et une indemnisation.
Recommandation 48. Le CET recommande que Pieridae considère les résultats des scénarios d'urgence dans l'Étude de simulation de navigation de GNL Goldboro HR Wallingford afin d'inclure des stratégies de sécurité dans un plan d'urgence.
Recommandation 49. Le CET recommande que Pieridae développe et présente un plan d'urgence à TC au moins 6 mois avant le début des opérations.
Recommandation 50. La TRC recommande que Pieridae travaille en collaboration avec la communauté locale et les organismes de réglementation pour combler toute lacune dans les plans d'intervention d'urgence de l'installation. Pieridae doit soumettre le plan d'intervention en cas d'urgence pour le projet GNL Goldboro au CET au moins 6 mois avant l'exploitation aux fins d'examen.
Recommandation 51. Le CET recommande que Pieridae adopte des procédures d'évacuation et d'hébergement sécuritaires en cas d'urgence. Ils doivent être intégrés dans le Plan d'urgence, le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux.
3.5 Préparation et réponse aux déversements de GNL et de pétrole
Dans sa soumission de 2018, Pieridae s'est engagé à développer un programme de gestion de la sécurité et des sinistres avant le début des opérations. Ceci sera conforme à la norme CSA Z276 de l'Association canadienne de normalisation sur la production, le stockage et la manutention du GNL.
Pieridae développera aussi un plan d'intervention en cas d'urgence pour le projet Goldboro qui couvrira la réponse aux déversements d'hydrocarbures en milieu marin (pour la libération du combustible de soute des transporteurs de GNL) et l'intervention de sauvetage en mer pour les eaux proches du terminal.
Les procédures de contrôle des navires de Pieridae veilleront à ce que les propriétaires des transporteurs de GNL respectent la convention HNS de 2010.Note de bas de page 59
3.5.1 Déversement de GNL
En cas de déversement, le GNL se vaporise et se disperse. Les personnes et les animaux se trouvant à proximité immédiats peuvent suffoquer et développer des engelures en raison de la température extrêmement basse du gaz (le GNL redevient du gaz à environ -160 °C). Les nuages de vapeur se disperseront à mesure que l'eau et l'air réchaufferont le gaz naturel. Si le nuage de vapeur est en contact avec une source d'inflammation et qu'il s'enflamme, il y a un risque de mort immédiate pour les personnes et les animaux. En cas d'inflammation, le nuage de vapeur ne se dilaterait pas ou n'exploserait pas, mais reviendrait à sa source, provoquant un feu de nappe localisé qui pourrait nuire aux personnes ou à la vie aquatique dans la zone de rayonnement thermique.
Des mesures pour assurer l'intégrité des réservoirs de GNL à bord des navires sont incluses dans le code IGC. Le code IGC constitue une norme internationale pour la sécurité du transport maritime des gaz liquéfiés et de certaines autres substances énumérées au chapitre 19 du code, y compris les exigences relatives à :
- Les normes de conception et de construction des navires transportant du GNL.
- L'équipement qu'ils doivent transporter pour minimiser les risques pour le navire, son équipage et l'environnement, compte tenu de la nature des produits concernés.
Une collision grave, un accrochage ou un échouage peut entraîner des dommages à la citerne à cargaison, ce qui peut se traduire par une libération incontrôlée du produit. Le déversement pourrait provoquer l'évaporation et la dispersion de la cargaison; le froid extrême pourrait provoquer une rupture fragile de la coque du navire. L'objectif du code IGC est de minimiser ces risques autant que possible, sur la base des connaissances et des technologies actuelles.
La Convention sur les substances nocives ou potentiellement dangereuses (SNPD) - OMI
La Convention SNPD a été adoptée par l'OMI en mai 1996. Elle est basée sur la Convention sur la responsabilité civile et la Convention du Fonds, qui ont connu un grand succès et qui couvrent les dommages de pollution causés par les déversements d'hydrocarbures persistants provenant de navires-citernes. Conformément au régime original d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures, la convention SNPD prévoit un système à deux niveaux pour le paiement des amendes en cas d'accidents maritimes impliquant des substances dangereuses et nocives.
Le premier niveau sera couvert par l'assurance des propriétaires de navires, qui seront en mesure de limiter leur responsabilité. Dans les cas où cette assurance ne couvre pas un incident, ou n'est pas suffisante pour satisfaire la demande, un deuxième niveau d'indemnisation sera versé par un fonds, composé des contributions des receveurs de SNPD. Les contributions seront déterminées en fonction du montant de SNPD perçu dans chaque État membre au cours de l'année civile précédente.
En 2009, la Convention SNPD n'est toujours pas entrée en vigueur en raison du manque de ratifications des États membres. Une deuxième réunion internationale, tenue en avril 2010, a utilisé un protocole à la convention SNPD (Protocole SNPD 2010) pour régler les problèmes qui avaient entravé l'approbation de la convention originale par de nombreux États. En avril 2019, quatre États ont ratifié le protocole SNPD 2010 et huit autres États sont tenus de le faire entrer en vigueur.Note de bas de page 60
Lorsque le protocole SNPD 2010 sera entré en vigueur, la convention de 1996, mise à jour par le protocole 2010, sera intitulée
"Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport maritime de substances nocives et potentiellement dangereuses, 2010" (OPRC-HNS).Note de bas de page 61
Transports Canada a rédigé le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements,Note de bas de page 62 qui est entré en vigueur le 2 décembre 2016. Cette étape était la dernière pour la mise en œuvre par le Canada de la Convention SNPD, qui exige que les destinataires de SNPD en vrac fassent une déclaration pour l'année civile 2017. En avril 2018, le Canada a ratifié la Convention.
Limitation de responsabilité
Lorsqu'un déversement de substances nocives et potentiellement dangereuses en vrac provoque des dommages, les propriétaires de navires peuvent normalement limiter leur responsabilité financière entre 10 millions et 100 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (taux de change actuel à calculer), en fonction du tonnage brut du navire.
Le Fonds SNPD prévoit un niveau d'indemnisation supplémentaire jusqu'à un maximum de 250 millions de DTS (taux de change actuel à calculer), y compris tout montant payé par le propriétaire du navire et son assureur. La Convention SNPD de l'OMI établit des limites de responsabilité dans les articles 9 et 10 de la conventionNote de bas de page 61.
3.5.2 Déversement de pétroliers
Le Régime de préparation et d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures en milieu marin du CanadaNote de bas de page 63 est financé et géré par l'industrie dans le cadre du Régime national de préparation et d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures. Il a été élaboré pour garantir que l'industrie ait la capacité de nettoyer ses propres déversements.
Dans le cadre de ce régime, l'industrie est tenue de maintenir une capacité de réaction de 10 000 tonnes, englobant les régions marines au sud du 60e parallèle de latitude nord. La Loi de la marine marchande du Canada, 2001, exige que les navires et les installations de traitement des hydrocarbures prescrits aient conclu des accords avec un organisme d'intervention agréé par TC.Note de bas de page 64
En tant que complément au régime de l'industrie, la GCC peut :
- Fournir une intervention immédiate si nécessaire.
- Fournir une aide en cas de déversements en mer.
- Répondre aux déversements en mer au nord de 60° de latitude nord.
TC est tenu de :
- Vérifier que les normes et les réglementations en matière de planification d'urgence sont adéquates.
- Vérifier que les organismes d'intervention et les installations de traitement du pétrole respectent les normes et les réglementations.
- Surveiller le fonctionnement du régime et la diligence des organismes d'intervention et des installations de manutention des hydrocarbures.
Exigences réglementaires pour les navires
Le Règlement sur l'intervention environnementale (SOR/2019-252) exige que les catégories de navires suivantes soient réglementées aux fins du paragraphe 167(1) de la LMMC, 2001 :
- les navires pétroliers ayant un tonnage brut égal ou supérieur à 150 tonneaux
- les navires, autres que les pétroliers, ayant un tonnage brut égal ou supérieur à 400 tonneaux, qui transportent des hydrocarbures comme cargaison ou comme carburant, et
- les navires qui transportent du pétrole comme cargaison ou comme carburant et qui remorquent ou poussent au moins un autre navire qui transporte du pétrole comme cargaison ou comme carburant, si le tonnage brut combiné des navires est de 150 tonneaux ou plus.
Ces navires sont obligés d'avoir à bord un accord avec un organisme d'intervention canadien certifié et une déclaration sous la forme spécifiée par le ministre, lorsqu'ils opèrent dans les eaux canadiennes, comme l'exige le paragraphe 167 (1) de la LMMC, 2001.
Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du CanadaNote de bas de page 34 exige que les navires établissent des rapports sur un certain nombre d'éléments, y compris la date d'expiration du :
- Certificat d'assurance ou autre garantie financière au titre de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
- Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
- Certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac
- Certificat d'aptitude, Certificat de conformité, le cas échéant, délivrés au navire.
Les inspecteurs du SMM de TC vérifient également que les navires étrangers se conforment à plusieurs exigences de sécurité, y compris la nécessité d'un accord avec un organisme d'intervention agréé.
Le terminal de Goldboro à Country Harbour est situé dans la zone géographique d'intervention (ZGI) de l'organisme d'intervention certifié, Point Tupper Marine Services (PTMS), ayant la capacité de répondre à un déversement de pétrole de 10 000 tonnes au maximum.
Régime canadien d'indemnisation Note de bas de page 65
Le Régime canadien de responsabilité et d'indemnisation pour les sources de pollution par les hydrocarbures provenant des navires est constitué de règles nationales et internationales que le Canada a acceptées. Les deux sont établis en vertu de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM). Une des principales caractéristiques du régime canadien est la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (SSOPF). Les règles de la mise en place et de la gestion du SSOPF figurent dans la partie 7 de la LRMM. Le régime est fondé sur le principe fondamental que le propriétaire du navire est responsable des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures provenant du navire - c'est-à-dire le principe du pollueur-payeur.
Règles nationales
En vertu des règles nationales, les propriétaires de navires sont responsables des dommages de pollution pétrolière provoqués par leurs navires jusqu'à une limite de responsabilité basée sur le tonnage du navire. Pour ces réclamations, les règles qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires sont énoncées dans la partie 6 de la LRMM. La responsabilité du propriétaire est rigoureuse, ce qui signifie que celui-ci ne peut éviter la responsabilité que sur la base d'un nombre limité de moyens de défense énumérés au paragraphe 77 (3) de la LRMM. Si l'indemnisation du propriétaire est insuffisante ou n'est pas disponible, les demandeurs peuvent soumettre leurs demandes à l'administrateur du SSOPF pour tout montant qu'ils ne peuvent pas recouvrer auprès du propriétaire, conformément à la partie 7 de la LRMM.
Règles internationales
Les règles internationales régissant la responsabilité des propriétaires de navires pour les déversements d'hydrocarbures causés par des pétroliers transportant du pétrole en vrac en tant que cargaison sont :
- La Convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC)
- La Convention de 1992 sur la création d'un Fonds international pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention FIPOL).
Il existe un régime de responsabilité sévère pour les déversements des hydrocarbures de soute. Les hydrocarbures de soute sont tout combustibles qu'un navire utilise pour sa propulsion ou pour ses opérations. Le Canada est signataire de la « Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention « Hydrocarbures de soute »). Cela signifie qu'un propriétaire de navire ne peut se dégager de sa responsabilité que moyennant quelques défenses, semblables à celles prévues par les règles nationales et internationales énumérées à l'article 3.3 de la Convention Hydrocarbures de soute et à l'Annexe 8 de la LRMMNote de bas de page 66. Le propriétaire peut limiter sa responsabilité en fonction du tonnage du navire selon les règles énoncées dans la partie 3 de la LRMM.
Planification d'intervention localisée
Conformément aux recommandations du rapport du Comité d'experts sur la sécurité des navires-citernes « Un examen de la préparation et de l'intervention du Canada en cas de déversement accidentel provenant d'un navire [A Review of Canada's Ship Source Oil Spill Preparedness and Response Regime] »Note de bas de page 67, Port Hawkesbury et le détroit de Canso ont fait partie de l'une des quatre zones visées par le projet pilote dans le cadre de l'initiative de planification de l'intervention par zone. L'objectif du projet pilote était de faciliter l'adoption d'un système régional de préparation et d'intervention en fonction des risques en cas de déversement d'hydrocarbures par des navires dans tout le Canada. Sur la base d'un cadre de gestion des risques, les groupes de travail régionaux ont dirigé l'élaboration des plans d'intervention par zone qui permettent une flexibilité réglementaire en fonction des différences régionales et du niveau de risque. Le rapport sur les leçons tirées de la planification de l'intervention dans les zones est maintenant disponible.Note de bas de page 68
Indemnisations de pêche
Compte tenu du régime réglementaire en vigueur au Canada et partout dans le monde, le rejet accidentel d'une grande quantité de pétrole par les navires transportant du GNL est très peu probable et serait limité au fioul du navire. Les collisions avec des navires pétroliers circulant entre le détroit de Canso et Halifax sont des sources potentielles de déversements de pétrole.
Si cela se produit, le pétrole de soute pourrait entrer en contact avec les poissons et leur habitat, les mammifères marins, les oiseaux aquatiques et l'habitat du littoral, les pêcheries, l'aquaculture et la navigation maritime. Le CET recommande que Pieridae développe un Régime d'indemnisation des pêcheurs en consultation avec l'industrie locale de la pêche, afin de s'assurer que les pêcheurs et les aquaculteurs soient indemnisés en cas de dommages à l'équipement ou de perte d'accès aux zones de pêche.
Recommandation 52. Le CET recommande que Pieridae développe un Régime d'indemnisation des pêcheurs en consultation avec l'industrie locale de la pêche, afin de s'assurer que les pêcheurs et les aquaculteurs soient indemnisés en cas de dommages à l'équipement ou de perte d'accès aux zones de pêche.
4.0 Conclusion
Cette évaluation TERMPOL a porté sur la sécurité maritime et la prévention des accidents. Son objectif était de vérifier que Pieridae Energy et Goldboro GNL peuvent réaliser les composantes de transport maritime du projet proposé en gérant les risques de manière conforme au régime réglementaire canadien, aux conventions et codes internationaux, aux normes de sécurité et aux meilleures pratiques du secteur.
De nombreux outils sont déjà en place au Canada pour assurer que les navires entrant dans les eaux canadiennes respectent les exigences internationales et nationales et ne présentent pas de risque pour la sécurité ou l'environnement. En complément des lois et réglementations maritimes et des cadres internationaux existants, les mesures de sécurité proposées par Pieridae favoriseront une navigation plus sécuritaire pour le projet Goldboro proposé.
En raison du processus de contrôle et d'acceptation de Pieridae, les opérateurs de transporteurs de GNL doivent procéder à des améliorations supplémentaires en matière de sécurité. En tant qu'exploitant du terminal, Pieridae a le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation d'accostage aux navires. C'est un moyen important qui peut être utilisé pour exiger que les navires suivent le processus de contrôle et les procédures du terminal.
L'itinéraire proposé prévoit une marge de manœuvre adéquate pour les navires et permet aux transporteurs de GNL de naviguer en toute sécurité. La profondeur et la largeur du chenal sont plus que suffisantes pour les transporteurs de GNL que le terminal accueillera.
Le CET reconnaît l'importance de la mise à jour de la communauté et des parties prenantes dans le développement du projet. Pieridae doit continuer de mobiliser les communautés, les groupes autochtones et les parties prenantes du milieu marin pour les sensibiliser aux impacts du projet.
Bien que le CET soit convaincu que l'augmentation du trafic maritime ne constitue pas un problème de sécurité, il est en faveur de mesures supplémentaires qui favoriseraient une utilisation partagée et sécuritaire de la route maritime du projet. Parmi ces mesures figurent :
- Application d'un contrôle approfondi et de critères de compatibilité avant d'autoriser un navire à entrer dans le terminal
- Utilisation de remorqueurs ayant les caractéristiques adéquates pour escorter les transporteurs de GNL jusqu'à leurs postes d'amarrage et à partir de ceux-ci
- Définition de critères environnementaux limitatifs pour les arrivées, les départs et le transfert de marchandises
- Mise à jour des cartes marines du SHC pour la zone avant le début des opérations en terminal
- Demander à tous les pilotes maritimes brevetés de la région de suivre une formation par simulation ou un entrainement à la manœuvre sur modèles avant le début des opérations du terminal
- Envisager des zones de sécurité autour des transporteurs de GNL et du terminal pour un meilleur niveau de sécurité pour les navires, les vies et les biens à proximité. Cela correspond aux meilleures pratiques en vigueur dans des terminaux GNL similaires et pleinement opérationnels.
En conclusion, tout projet peut représenter un certain niveau de risque, mais, après avoir examiné les études de Pieridae et ses engagements, le CET n'a pas relevé de préoccupations majeures concernant les transporteurs de GNL, la route proposée, la navigabilité, les autres utilisateurs des voies navigables, les opérations de transfert de cargaison ou l'exploitation des terminaux maritimes.
Le CET a présenté 30 conclusions et 52 recommandations en réponse à la demande de Pieridae au sujet du terminal de Goldboro. Cela comprend les actions proposées que Pieridae peut entreprendre. Avec les engagements de Pieridae, ceci assurera un niveau de sécurité plus élevé pour les opérations des transporteurs de GNL et l'augmentation potentielle du trafic.
Si le projet se réalise, le CET demande à Pieridae de mettre pleinement en œuvre les engagements détaillés dans la soumission TERMPOL pour le terminal GNL de Goldboro. Cependant, si à un moment quelconque Pieridae modifie les critères ou les caractéristiques opérationnelles du projet, ou a besoin d'ajuster ses engagements, les autorités compétentes pourraient avoir besoin de faire un examen et une analyse plus approfondis.
Une liste complète des conclusions et recommandations du CET figure à l'Annexe 1.
Annexe 1 : Conclusions et recommandations
Les conclusions sont des déclarations ou des observations du CET qui reprennent, renforcent ou expliquent les recommandations et les principaux engagements de Pieridae. Ils peuvent souligner les actions en cours d'un ministère ou d'une autorité liées à un programme de service maritime particulier ou à une zone réglementée.
Les recommandations sont des actions proposées pour Pieridae qui pourrait améliorer la sécurité maritime au-delà du régime réglementaire actuel.
Conclusions
Conclusion 1. Le CET reconnaît que Pieridae doit discuter des délais avec toutes les autorités compétentes pour donner suite aux recommandations formulées dans le présent rapport.
Conclusion 2. Le contrôle des navires-citernes, le programme de rapport d'inspection des navires et les processus maritimes de l'Institut de distribution de produits chimiques sont des moyens généralement acceptés que les terminaux et les sociétés de GNL adoptent pour vérifier la conformité et améliorer la sécurité. (Section 3.1.2)
Conclusion 3. Pieridae n'a pas indiqué dans sa soumission les exigences du Règlement sur le personnel maritime en matière de formation et de qualification des équipages. (Section 3.1.4)
Conclusion 4. Les deux gazoducs offshore existants qui ont transporté le gaz naturel vers l'ancienne usine à gaz de Goldboro resteront probablement en place. Encana Corporation et ExxonMobil ont soumis à l'autorité de régulation de l'énergie du Canada des demandes d'abandon des gazoducs et ont commencé à les mettre hors service. Les deux entreprises ont expliqué que les gazoducs seraient raclés et rincés, remplis d'eau de mer et laissés inertes sur le fond marin. (Section 3.2.1)
Conclusion 5. Le CET remarque que le port est bien marqué par des bouées et qu'il répond aux besoins du trafic maritime actuel. Tout changement ou ajout proposé au système d'aides à la navigation nécessite l'apport de la GCC, le Programme des aides à la navigation, afin de s'assurer que le niveau de service est maintenu pour les utilisateurs existants dans la région. (Section 3.2.2.3)
Conclusion 6. Le terminal GNL envisagé à Goldboro n'est pas situé dans une zone de pilotage obligatoire. (Section 3.2.2.4)
Conclusion 7. Le SHC serait affecté par la construction d'un nouveau grand terminal maritime.
Conclusion 8. Le CET est conscient que les cartes actuelles de la zone ne sont pas adaptées à la navigation en toute sécurité de l'augmentation et du type de trafic maritime prévus. (Section 3.2.2.6)
Conclusion 9. Le CET est convaincu que l'installation d'une bouée intelligente [systèmes, aides et dispositifs pour l'acquisition de données océaniques (SADO) / bouée météo] à proximité de la station de pilotage proposée permettrait d'analyser en temps réel les conditions météo de l'océan. (Section 3.2.2.7)
Conclusion 10. Le CET est convaincu que les transporteurs de GNL seraient plus sécuritaires s'ils avaient un « conseiller en glace » à bord lorsqu'ils voyagent dans des eaux couvertes de glace. (Section 3.2.2.8)
Conclusion 11. Le CET reconnaît que les conclusions générales, recommandations et considérations supplémentaires de l'Étude de simulation de la navigation d'HR Wallingford permettraient d'améliorer la sécurité de la navigation maritime dans la zone de champ d'application de TERMPOL. (Section 3.2.3.2)
Conclusion 12. Le CET est conscient que tous les navires opérant dans la zone ne sont pas tenus d'être équipés d'un SIA.
Conclusion 13. Pour la partie hauturière du transport de GNL, les navires supplémentaires peuvent être facilement absorbés dans le réseau existant. Les transporteurs de GNL sont assujettis à un processus de contrôle strict de la part des affréteurs, de sorte que le CET ne se soit pas inquiété du fait que les navires du projet puissent accroître le risque pour le réseau. (Section 3.2.4)
Conclusion 14. Pieridae a un plan de communication permanent et collabore avec les communautés locales, y compris tous les utilisateurs de l'eau. Il existe également un groupe de travail avec les pêcheurs locaux qui se poursuivra tout au long de la vie opérationnelle de l'usine. (Section 3.2.4)
Conclusion 15. Le CET partage la conclusion d'HR Wallingford concernant l'existence d'une marge de manœuvre suffisante en mer dans la voie navigable de transit. (Section 3.3.2)
Conclusion 16. Pieridae se référera et incorporera les normes, recommandations et directives pertinentes de diverses autorités internationales comme celles produites par l'OCIMF et l'AIPCN pour les procédures d'accostage et d'amarrage. (Section 3.3.2)
Conclusion 17. Le plan de signalisation n'était pas complet au moment de la rédaction du présent rapport. Les plans de signalisation sont essentiels pour s'assurer que le système d'éclairage bloque le champ de vision depuis la passerelle d'un transporteur de GNL à l'arrivée ou au départ. (Section 3.3.2)
Conclusion 18. Les procédures d'accostage et d'amarrage permettront au CET d'examiner le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux une fois les documents soumis. (Section 3.3.2)
Conclusion 19. Le CET a constaté que l'évaluation des risques soumise par Pieridae n'incluait pas les risques suivants dans son analyse, conformément au document TP 743.2 (Section 3.4.1)
Conclusion 20. Le CET a observé que Pieridae n'a pas analysé les risques et les mesures d'atténuation liés à la libération d'un nuage de gaz. (Section 3.4.2)
Conclusion 21. Il n'y a pas de services de trafic maritime (STM) dans la zone d'étude de Goldboro. Si Pieridae souhaite une couverture STM pour Country Harbour, tous les frais y afférents seraient à sa charge, car le port serait pour un seul utilisateur. (Section 3.4.2.3)
Conclusion 22. Le CET a constaté que les SCTM sont en mesure d'appuyer soit l'établissement d'une nouvelle zone de services de trafic maritime, soit l'extension de la zone de services de trafic maritime existante de Canso. (Section 3.4.2.3)
Conclusion 23. Le CET approuve la proposition de Pieridae et les simulations d'HR Wallingford concernant l'utilisation de quatre remorqueurs pour escorter les transporteurs de GNL. (Section 3.4.2.3)
Conclusion 24. Le CET reconnaît que, sur la base des simulations, l'utilisation de remorqueurs d'escorte contribuera à réduire le risque d'échouage. (Section 3.4.2.4)
Conclusion 25. Le CET a constaté que Pieridae s'est engagé à fournir des remorqueurs d'escorte dotés d'une solide capacité de lutte contre les incendies. (Section 3.4.2.4)
Conclusion 26. Le CET reconnaît qu'il serait prudent d'avoir des pilotes de l'APA pour un accostage et un désaccostage sécuritaires au terminal proposé. (Section 3.4.2.5)
Conclusion 27. Le CET reconnaît qu'il existe de nombreuses façons de réduire les risques lors des déplacements vers et depuis le terminal. L'équipe de gestion de la passerelle du navire et les pilotes utilisent le RADAR et les aides électroniques pour contrôler la position, la vitesse et la rapidité de virage du navire afin de le diriger en toute sécurité. L'APA peut également restreindre l'accès d'un navire à un pilote s'il y a moins de 2 nm de visibilité. (Section 3.4.2.5)
Conclusion 28. Le CET a constaté l'utilisation constante du terme de marque déposée de TC « Autorité portuaire/Administration portuaire » pour désigner Goldboro dans les documents de soumission. Étant donné que Goldboro n'est pas un port public reconnu par la LMC, l'utilisation du terme « Autorité portuaire/Administration portuaire » pourrait être mal interprétée par le public et constituerait une violation des articles 7 et 9 de la Loi sur les marques. (Section 3.4.2.6)
Conclusion 29. CET considère que le rapport SANDIA5Note de bas de page 6 est un document de référence reconnu au niveau international qui identifie la création de zones d'exclusion comme un moyen de gérer les risques liés aux dangers thermiques, en cas de rejet accidentel ou intentionnel de GNL. (Section 3.4.2.7)
Conclusion 30. Le CET a constaté que l'analyse de Pieridae de la zone d'exclusion autour du GNL au poste d'amarrage est basée sur des zones existantes des autres juridictions. (Section 3.4.2.7)
Recommandations
Recommandation 1. Le CET conseille à Pieridae d'informer les autorités compétentes s'il souhaite modifier des parties du projet, des critères opérationnels ou des caractéristiques, afin que les autorités puissent examiner les éventuelles répercussions sur la sécurité qui résulteraient de ces modifications. (Section 3.0)
Recommandation 2. Le CET recommande que Pieridae identifie toutes les exigences canadiennes spécifiques qui ne font pas actuellement partie des conventions, codes ou normes internationaux. Pieridae devrait mettre l'accent sur ces exigences dans le Livre d'information sur les ports pour les navires faisant escale au terminal GNL de Goldboro. (Section 3.1.1)
Recommandation 3. Le CET recommande que Pieridae adopte et applique des normes de contrôle, veille à ce que tous les navires faisant escale à son terminal disposent d'un certificat SIRE (Ship Inspection Report Programme - programme de rapport d'inspection des navires) à jour et satisfassent aux critères de compatibilité du terminal. Pieridae devrait inclure ses normes de vérification dans le Livre d'information sur les ports. (Section 3.1.2)
Recommandation 4. Le CET recommande que Pieridae demande à tous les navires faisant escale à son terminal maritime de suivre le programme d'auto-évaluation de la gestion des pétroliers du Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). (Section 3.1.2)
Recommandation 5. CET recommande que Pieridae utilise le questionnaire de compatibilité navire-terre publié par la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) lors de la phase de préfixation pour voir si un navire peut être amarré en toute sécurité au terminal.
Recommandation 6. Le CET recommande que tout le personnel à bord des navires soit formé pour répondre aux Normes de compétence pour le transport maritime de GNL et aux Directives d'utilisation de la matrice d'expérience SIGTTO en matière de GNL et de GPL. (Section 3.1.4)
Recommandation 7. Le CET a recommandé que Pieridae évalue les mesures d'atténuation des risques proposées en ce qui concerne les gazoducs sous-marins abandonnés d'Encana et d'ExxonMobil situés à proximité du terminal; en particulier, les risques associés à un transporteur des GNL jetant l'ancre au-dessus des gazoducs sous-marins et procédant aux mises à jour correspondantes de son Livre d'information sur les ports et de son Manuel d'exploitation des terminaux. (Section 3.2.1)
Recommandation 8. Recommandation 8 La TRC recommande que Pieridae demande un examen de la méthodologie de gestion des risques de pilotage avant ou pendant la construction du terminal. (Section 3.2.2.4)
Recommandation 9. Le CET recommande que Pieridae collabore avec le SHC pour préparer et soumettre les données des relevés cartographiques le plus tôt possible, car le processus de cartographie pourrait prendre de 3 à 4 ans. (Section 3.2.2.6)
Recommandation 10. Pieridae doit choisir les sources de financement pour la bouée intelligente [systèmes, aides et dispositifs pour l'acquisition de données océaniques (bouée SADO)/bouée)], en consultation avec Environnement et changement climatique Canada. (Section 3.2.2.7)
Recommandation 11. Pieridae doit vérifier les conditions limitatives du Metocean, y compris les facteurs qui affectent la visibilité et qui pourraient affecter les opérations et les inclure dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux. (Section 3.2.2.7)
Recommandation 12. Le CET recommande que Pieridae oblige tous les transporteurs de GNL qui font escale au terminal proposé à suivre les Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l'est du Canada dans une zone de contrôle actif des glaces comme si les navires étaient des pétroliers chargés(Section 3.2.2.8)
Recommandation 13. Le CET conseille à Pieridae d'enquêter sur les navires « non-SIA » qui se déplacent dans la zone proposée et de prêter une attention particulière aux opérations de pêche saisonnières. (Section 3.2.4)
Recommandation 14. Le CET recommande que Pieridae approfondisse son étude sur l'impact sur les communautés côtières. (Section 3.2.4)
Recommandation 15. Le CET recommande que Pieridae poursuive son engagement par le biais d'un groupe de travail auprès des pêcheurs locaux. (Section 3.2.4)
Recommandation 16. Le CET recommande que Pieridae vérifie que les navires faisant escale au terminal de Goldboro disposent de tous les avertissements de navigation pertinents avant d'entrer dans les eaux canadiennes. Cela assurera qu'il n'y a pas de conflits avec les exercices de la Marine royale canadienne ou d'autres activités dans la région. (Section 3.2.4)
Recommandation 17. Le CET recommande que Pieridae inclue des références aux listes de contrôle et aux directives de l'OCIMF et de l'AIPCN dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux de Goldboro GNL. (Section 3.3.2)
Recommandation 18. Le CET recommande que Pieridae applique la recommandation de l'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNL qui prévoit l'ajout de panneaux d'amarrage de la jetée qui aideraient les pilotes à déterminer leur distance de la jetée et leur vitesse d'approche vers le poste d'amarrage. (Section 3.3.2)
Recommandation 19. Le CET recommande que Pieridae présente son projet de plan de signalisation du terminal au CET afin d'évaluer les interactions avec les feux existants dans la zone. Ce plan doit être soumis dès qu'il est disponible et au moins 6 mois avant le début des opérations. (Section 3.3.2)
Recommandation 20. Le CET recommande que Pieridae fixe les procédures d'accostage et d'amarrage avant de soumettre le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux à TC afin que le ministère puisse en tenir compte lors de l'examen des documents. (Section 3.3.2)
Recommandation 21. Le CET recommande que Pieridae incorpore des planches d'amarrage dans la conception finale du poste d'amarrage. (Section 3.3.2)
Recommandation 22. Le CET recommande que Pieridae développe des procédures d'exploitation et vérifie que tout le personnel est formé pour des opérations de transfert de cargaison en toute sécurité. (Section 3.3.3)
Recommandation 23. Le CET recommande que Pieridae assure que tout le personnel du terminal soit formé selon les normes recommandées par l'OCIMF dans le «Guide de compétence et de formation des opérateurs de terminaux maritimes ». (Section 3.3.3)
Recommandation 24. Pieridae devrait inclure la liste de contrôle de sécurité navire/terre SIGTTO dans son Manuel d'exploitation des terminaux. (Section 3.3.3)
Recommandation 25. Une fois que la configuration du système de transfert de cargaison est finalisée et avant de soumettre le Manuel d'exploitation des terminaux, Pieridae doit informer TC de toute révision de ces plans. Cela permettra à TC de décider si d'autres examens sont nécessaires. (Section 3.3.3)
Recommandation 26. Le CET recommande que Pieridae leur fournisse une copie duLivre d'information sur les ports au moins 6 mois avant le début des opérations du terminal. Cela va permettre un examen rapide et contribuera à garantir que toutes les procédures et mesures d'atténuation sont en place avant le début des opérations. Le Livre d'information sur les ports doit être transporté à bord de tout transporteur de GNL faisant escale au terminal de Goldboro. (Section 3.3.4)
Recommandation 27. Pieridae doit vérifier que toutes les politiques et procédures basées sur le Rapport de simulation de navigation GNL d'HR Wallingford Goldboro sont complétées à temps pour être intégrées dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux. (Section 3.3.5)
Recommandation 28. Le CET recommande que Pieridae leur fournisse un exemplaire du Manuel d'exploitation des terminaux au moins 6 mois avant le début des opérations, afin que TC soit en mesure de vérifier que toutes les procédures et tous les plans d'urgence sont en place avant le début des opérations. (Section 3.3.5)
Recommandation 29. Le CET recommande que Pieridae effectue une évaluation des risques supplémentaires sur les composants énumérés dans la conclusion 19 (section 3.4.1)
Recommandation 30. Le CET recommande que Pieridae actualise l'analyse des risques en tenant compte de la probabilité de libération d'un nuage de gaz, comme l'exige le document TERMPOL TP 743, conformément au point 3.5.2.2 Substances dangereuses et nocives. Cette analyse devrait inclure les limites géographiques d'une libération incontrôlée de la cargaison. Toute mesure d'atténuation doit être inscrite dans le Plan d'urgence de Goldboro. (Section 3.4.2)
Recommandation 31. Le CET recommande que Pieridae travaille en collaboration avec la Garde côtière canadienne afin de discuter de tout changement ou ajout proposés au système d'aides à la navigation afin de garantir le maintien d'un niveau de service continu pour les utilisateurs actuels de la région. (Section 3.4.2.1)
Recommandation 32. Pieridae devrait consulter Environnement et changement climatique Canada pour examiner les exigences et les sources de financement d'une bouée intelligente (systèmes, aides et dispositifs pour l'acquisition de données océaniques (SADO) / bouée météo) à la station d'embarquement des pilotes. (Section 3.4.2.2)
Recommandation 33. Pieridae doit confirmer les limites Metocean identifiées dans les simulations et les inclure dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux. (Section 3.4.2.2)
Recommandation 34. Pour la couverture STM et RADAR, le CET recommande que Pieridae demande une étude aux SCTM de la GCC. La portée et le positionnement du site pour le STM, le RADAR et la couverture radio devront être discutés par Pieridae et le SCTM. Étant donné que le nouveau service serait destiné à un seul utilisateur, Pieridae devrait payer tous les frais associés. . (Section 3.4.2.3)
Recommandation 35. Le CET recommande que Pieridae, en plus d'envisager l'établissement d'une zone de précaution, étudie d'autres solutions conformément à la résolution A.572(14) de l'OMI. Pieridae doit communiquer avec le bureau régional de TC si l'analyse des risques révèle qu'une telle mesure est nécessaire. (Section 3.4.2.3)
Recommandation 36. Le CET recommande que les remorqueurs soient équipés de cellules de pesage pour mesurer les forces de traction sur la ligne lorsqu'ils sont attachés à un navire. (Section 3.4.2.4)
Recommandation 37. Le CET recommande que la conception des remorqueurs soit normalisée afin de permettre des remplacements de remorqueurs sans faille et des pièces et équipements interchangeables pour garantir qu'il y ait suffisamment de remorqueurs disponibles à tout moment. (Section 3.4.2.4)
Recommandation 38. Le CET recommande que tous les remorqueurs soient équipés de treuils d'extraction/récupération afin de renforcer les capacités pour les fonctions d'escorte et d'accostage (Section 3.4.2.4)
Recommandation 39. Le CET recommande que tous les remorqueurs d'escorte soient équipés de matériel de sauvetage pour aider les transporteurs de GNL, y compris du matériel pour le remorquage en cas d'urgence. Les transporteurs doivent également disposer d'un équipement qui permet de relier rapidement les engins de remorquage en toute sécurité. Il est essentiel que les transporteurs de GNL et les remorqueurs d'escorte soient compatibles. (Section 3.4.2.4)
Recommandation 40. Le CET recommande que Pieridae installe sur tous ses remorqueurs les équipements de lutte contre l'incendie les plus récents (Section 3.4.2.4).
Recommandation 41. Le CET recommande que Pieridae vérifie que tous les transporteurs du projet respectent les exigences des procédures de remorquage d'urgence de la règle 11-1/3-4 de la convention SOLAS (résolution 258 [84] de l'OMI). (Section 3.4.2.4)
Recommandation 42. Le CET recommande que tous les pilotes maritimes brevetés de la région de suivre une formation par simulation ou un entrainement à la manœuvre sur modèles avant le début des opérations du terminal (Section 3.4.2.5).
Recommandation 43. Pieridae doit veiller à ce que tous les transporteurs de GNL disposent d'un expert maritime local pour guider le navire vers son poste à quai, si l'APA décide que Goldboro n'a pas besoin d'être une zone de pilotage obligatoire (Section 3.4.2.5)
Recommandation 44. Conformément à la conclusion 28 du présent rapport, le CET recommande que Pieridae modifie toutes les références au terme de marque « Autorité portuaire/Administration portuaire » dans toute la documentation liée à Goldboro pour indiquer « Gestion portuaire » ou le poste générique de capitaine de port en tant que personne/employé désignée en charge des opérations portuaires. (Section 3.4.2.6)
Recommandation 45. Concernant la zone d'exclusion de 200 mètres, le CET recommande que Pieridae mène une étude en utilisant des méthodes comme SANDIA. L'étude doit tenir compte des conditions locales et devra inclure la contribution des utilisateurs des voies navigables, afin de justifier la nécessité et la taille d'une zone de sécurité. Les informations concernant la zone de sécurité devront être incluses dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux. (Section 3.4.2.7)
Recommandation 46. Le CET recommande que Pieridae vérifie que tout le personnel du terminal GNL de Goldboro est bien formé pour les urgences liées aux GNL. (Section 3.4.2.8)
Recommandation 47. Le CET a recommandé que Pieridae vérifie que le personnel du terminal GNL a reçu une formation officielle et accréditée en matière de système de commandement des incidents avant le début des opérations. (Section 3.4.2.8)
Recommandation 48. Le CET recommande que Pieridae considère les résultats des scénarios d'urgence dans l'Étude de simulation de navigation de GNL Goldboro HR Wallingford afin d'inclure des stratégies de sécurité dans un plan d'urgence. (Section 3.4.3)
Recommandation 49. Le CET recommande que Pieridae développe et présente un plan d'urgence à TC au moins 6 mois avant le début des opérations. (Section 3.4.3)
Recommandation 50. La TRC recommande que Pieridae travaille en collaboration avec la communauté locale et les organismes de réglementation pour combler toute lacune dans les plans d'intervention d'urgence de l'installation. Pieridae doit soumettre le plan d'intervention en cas d'urgence pour le projet GNL Goldboro au CET au moins 6 mois avant l'exploitation aux fins d'examen. (Section 3.4.3)
Recommandation 51. Le CET recommande que Pieridae adopte des procédures d'évacuation et d'hébergement sécuritaires en cas d'urgence. Ils doivent être intégrés dans le Plan d'urgence, le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux. (Section 3.4.3)
Recommandation 52. Le CET recommande que Pieridae développe un Régime d'indemnisation des pêcheurs en consultation avec l'industrie locale de la pêche, afin de s'assurer que les pêcheurs et les aquaculteurs soient indemnisés en cas de dommages à l'équipement ou de perte d'accès aux zones de pêche. (Section 3.5.2)
Annexe 2 : Documents soumis au processus d'examen TERMPOL
| Titre du document | Numéro du document | Révision | Date d'émission |
|---|---|---|---|
| Rapport sur les données météorologiques | 13-1250-0139-014-Rev0 | Rév 0 | 2016-02 |
| Projet Goldboro GNL - Rapport sur les relevés bathymétriques | 13-1250-0139-CSR-REP-0009 | Rév 0 | 2015-06-16 |
| Rapport final sur les données de l'étude Metocean | 13-1250-0139-GAL-REP-0011 | Rév 0 | 2015-09-04 |
| Caractéristiques de conception des structures marines de la jetée | 188479-400-MA-BD-00001 | C | 2015-12-07 |
| Installations de déchargement des matériaux structures maritimes – Caractéristiques de conception | 188479-400-MA-BD-00002 | C | 2015-12-07 |
| Analyse de l'utilisation des postes de GNL et des temps d'arrêt | 188479-400-MA-RP-00001 | B | 2015-12-18 |
| Analyses de l'accostage et de l'amarrage | 188479-400-MA-RP-00002 | B | 2015-11-25 |
| Preuve de concept - Rapport sur les simulations de manœuvres | 188479-400-MA-RP-00003 | B | 2015-12-10 |
| Rapport Metocean mis à jour | 188479-400-MA-RP-00005 | B | 2015-12-10 |
| Spécifications - Matériel d'amarrage | 188479-400-MA-SP-00007 | D | 2016-01-05 |
| Soumission de l'examen du rapport TERMPOL, soumission 1 - résumé | GPL-PEL-TNO-0002_00 | 2016-04 |
| Titre du document | Numéro du document | Révision | Date d'émission |
|---|---|---|---|
| 3.2 Enquête du trafic maritime | DJR5960-RT101-R02-00 | Rév 1 | 2018-07-18 |
| 3.3 Enquête des itinéraires, des abords caractéristiques et de la navigabilité | GPL-PEL-MAR-RPT-0008 | Rév 0 | 2018-07-06 |
| 3.4 Dégagement spécifique sous quille | DJR5960-RT102-R02-00 | Rév 1 | 2018-07-18 |
| 3.5 Enquête sur les temps de transit et les retards | GPL-PEL-MAR-RPT-0001 | Rév 0 | 2018-07-06 |
| 3.6 Enquête sur les données relatives aux accidents | DJR5960-RT103-R02-00 | Rév 1 | 2018-07-16 |
| 3.7 Spécifications des navires | GPL-PEL-MAR-RPT-0002 | Rév 0 | 2018-07-06 |
| 3.8 Schémas et données techniques du site | GPL-PEL-MAR-RPT-0003 | Rév 0 | 2018-07-06 |
| 3.9 Manuel de transbordement des cargaisons | GPL-PEL-MAR-RPT-0004 | Rév 0 | 2018-07-06 |
| 3.10 Éléments de chenal, de manœuvre et d'ancrage (Preuve de concept - Rapport sur les simulations de manœuvres) | 188479-400-MA-RP-00003 | B | 2015-12-10 |
| 3.11 Procédures et dispositions en matière d'amarrage | GPL-PEL-MAR-RPT-0005 | Rév 0 | 2018-07-06 |
| 3.13 Analyse globale des risques et méthodes envisagées pour les réduire | DJR5960-RT104-R02-00 | Rév 1 | 2018-07-16 |
| 3.14 Manuel d'information sur les ports et 3.15 Manuel d'exploitation des terminaux | GPL-PEL-MAR-RPT-0006 | Rév 0 | 2018-07-24 |
| 3.16 Planification d'urgence | GPL-PEL-MAR-RPT-0007 | Rév 0 | 2018-07-06 |
| 3.18 Considérations sur les matières dangereuses et nocives | DJR5960-RT105-R02-00 | Rév 1 | 2018-07-16 |
| GNL Goldboro - Étude de simulation de navigation | DJR5960-RT001-R02-00 | Rév 2 | 2019-03-08 |
Annexe 3 : Conception des navires
Selon Pieridae, l'installation GNL de Goldboro inclura une jetée avec deux plateformes de chargement pouvant accueillir des navires GNL allant de 125 000 m3 à 266 000 m3.Note de bas de page 69 Deux types de transporteurs GNL feront une halte à Goldboro, avec des réservoirs sphériques ou des réservoirs à membrane. Ces navires du projet sont détaillés ci-dessous.
| Capacité des navires | 125 000 m3 | 177 000 m3 | 216 000 m3 | 266 000 m3 |
|---|---|---|---|---|
| Réservoir | Sphérique | Sphérique/membrane | Membrane | Membrane |
| LHT (m) | 285,3 | 300 | 315 | 345 |
| LPP (m) | 273,4 | 286,5 | 302 | 332 |
| Largeur (m) | 43,7 | 52 | 50 | 53,8 |
| Creux minimal (m) | 25 | 28 | 27 | 27 |
| Enfoncement (m) | 11,5 | 11,7 | 12 | 12 |
| Enfoncement du lest (m) | 10 | 9,5 | 9,4 | 9,6 |
| Déplacement en charge (mt) | 102804 | 128533 | 146054 | 178564 |
| Déplacement en lest (mt) | 82500 | 98887 | 111900 | 141990 |
| Limite des ailes avant (m) | 38,8 | 60,1 | 59,6 | 60 |
| Limite des ailes arrière | 81,7 | 95,8 | 98,4 | 104 |
| Type de fil | Fil d'acier | HMPE* | HMPE* | HMPE* |
| Résistance du fil - BL (t) | 132 | 137 | 137 | 137 |
| Diamètre du fil (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Nombre maximal de fils/côté | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Type de fil de la queue | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Résistance de la queue (t) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Diamètre de la queue (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Longueur de la queue (m) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Zone de charge du vent longitudinal (m2) | 6450 | 9918 | 7130 | 8759 |
| Zone de charge du vent transversal (m2) | 783 | 1943 | 1510 | 1612 |
| Charge du vent longitudinal du lest (m2) | 6865 | 10478 | 8000 | 9552 |
| Charge du vent transversal du lest (m2) | 850 | 2055 | 1650 | 1741 |
| Collecteur vertical au-dessus du pont (m) | 4,2 | 4 | 4,9 | 5,2 |
| Collecteur horizontal à partir de la proue (m) | 123 | 137,2 | 156,9 | 172,5 |
| Collecteur horizontal de la poupe (m) | 162,4 | 162,8 | 158,1 | 172,5 |
* HMPE - polyéthylène à haute résistance. Couramment utilisé pour les haussières et les câbles des navires comme une alternative plus légère aux fils d'acier.
Description
Typical 125,000 m3 LNGC with Spherical Containment Tanks - one of the two types of LNG carriers calling at Goldboro
Description
Typical 216,000 m3 LNGC with Membrane Type Containment - second type of LNG carriers calling at Goldboro
Les réservoirs sphériques, ou de type Moss, seront montés sur les transporteurs plus petits, et le type à membrane sur les plus grands navires. Vous trouverez ci-dessous des images en coupe des deux réservoirs.
Description
- Couvre-réservoir (acier)
- Tour en tube d'acier et Coupole de
- Isolation
- Réservoir aluminium
- Double coque
- Bac de récupération
- Jupe de support
Source : MOSS Maritime
Description
Representation of Membrane Tank Cargo Containment System
- Membrane tank
- Structure de la coque
- Isolation secondaire
- Membrane secondaire
- Isolation primaire
- Membrane primaire
Annexe 4 : Informations sur les terminaux et la navigation
Le site du projet proposé est localisé sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, à environ 160 kilomètres au nord-est de Halifax, dans la communauté de Goldboro.

Description
Présentation du occupée par l'installation de GNL proposée à Goldboro, NS
Annexe 5 : GNL Goldboro - Étude de simulation de navigation
Conclusions et recommandations
Comme indiqué à la section 3.2.3, pour appuyer la soumission, Pieridae a chargé HR Wallingford de réaliser une analyse générale des risques et de produire une Étude de simulation de navigation. Entre le 19 et le 24 novembre 2018, des membres du CET ont participé aux simulations à Howbery Park, Wallingford, au Royaume-Uni. Le rapport final, Goldboro GNL, Étude de simulation de navigation, a été soumis au CET le 2 avril 2019.
HR Wallingford a créé un modèle géographique du terminal et de la zone environnante, en utilisant le plan qui a été développé au cours des études de la phase d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) achevée en 2015.Note de bas de page 45
Les simulations ont porté sur les alignements des postes d'amarrage FEED qui tenait compte des conditions météorologiques, du vent, de l'état de la mer, des marées et des courants, avec des variations saisonnières pour l'amarrage et le désamarrage des navires au terminal. HR Wallingford a effectué 41 simulations, dont 28 manœuvres standard achevées, représentant 13 arrivées et 15 départs.
Le CET a analysé chacune des recommandations de l'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNL et a élaboré des conclusions et des recommandations pour le terminal de Goldboro, qui sont incluses dans la section 3.4.2 Méthodes envisagées pour réduire les risques.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des conclusions et recommandations de l'Étude de simulation de navigation de Pieridae :
Conclusions
Les simulations ont confirmé que l'accès maritime au terminal proposé est sécuritaire et sans restriction pour tous les navires simulés, avec des profondeurs minimales naturelles le long des routes d'approche et de départ généralement supérieures à 20 m.
Un espace de manœuvre adéquat a été identifié pour permettre aux navires d'être manœuvrés vers et depuis le poste d'amarrage concerné sans interagir avec un navire amarré sur le poste adjacent. Un espace de manœuvre adéquat, naturellement profond, s'est montré disponible pour permettre au capitaine du navire d'osciller à bâbord ou à tribord à l'arrivée, pour l'un ou l'autre poste d'amarrage.
L'accès au poste d'amarrage sud était confirmé comme étant plus simple, mais aucune difficulté significative n'a été rencontrée lors des opérations à destination et en provenance du poste d'amarrage nord.
Limitation des conditions environnementales
La ligne d'accostage de la jetée est alignée avec la direction dominante des vagues, mais les remorqueurs opérant en mode de poussée sur la coque du navire sont entièrement exposés aux vagues. Tel que prévu, la principale contrainte sur les opérations maritimes a été constatée dans la performance des remorqueurs dans des conditions de vagues plus fortes, en particulier lorsque les remorqueurs fonctionnent en mode de poussée.
Les simulations ont démontré que les opérations avec des remorqueurs en mode de poussée deviennent plus difficiles au-dessus d'une hauteur de vague significative de 1 m, avec une période de pointe d'environ 8 à 9 secondes. Dans de tels cas, toutes les parties impliquées dans les opérations de manœuvre doivent être informées des problèmes éventuels avant de commencer toute manœuvre d'arrivée ou de départ.
Malgré la possibilité d'effectuer des manœuvres d'arrivée et de départ dans des conditions de vagues plus intenses, ces opérations ont été effectivement réalisées avec 2 remorqueurs travaillant sur les lignes. Les remorqueurs en mode de poussée étaient largement inefficaces et il n'y avait donc pas de réserve de puissance de remorquage disponible en cas de défaillance d'un remorqueur.
Les essais ont également révélé que, lorsque les remorqueurs naviguaient dans des conditions de vagues appropriées et avec des vents réguliers de 25 nœuds ou moins, la direction du vent n'avait pas d'importance.
La force de remorquage
Les remorqueurs TAA de 70 tonnes à traction de bollard se sont montrés efficaces en mode poussée jusqu'à 1 mètre de hauteur de vague, notamment lorsqu'ils sont combinés avec des remorqueurs travaillant sur des lignes à l'aide de treuils de récupération d'enduit.
Aides à la navigation
La nécessité de disposer d'aides à la navigation flottantes supplémentaires n'a pas été identifiée lors des simulations. Les simulations ont clairement montré qu'une ligne de tête (ensemble de feux d'alignement) était avantageuse, comme on peut le voir sur les tracés de la voie.
Recommandations
Remorqueurs
Ces simulations ont clairement montré qu'une flotte de 4 remorqueurs est nécessaire pour fournir la puissance de réserve nécessaire. Les exigences minimales pour les remorqueurs doivent inclure ce qui suit :
- Tous les remorqueurs doivent être capables d'assurer une traction de 70 tonnes sur les bollards dans les conditions environnementales prévues
- Tous les remorqueurs devaient être équipés de treuils de récupération d'équarrissage, à deux tambours
Aides à la navigation
La navigation par alignements doit être prévue pour aider un manutentionnaire de navires à suivre une voie centrale à travers Country Harbour à l'arrivée et au départ.
Les structures frontales et arrière doivent être conçues de manière à ce que la navigation par alignement soit visible depuis la zone d'embarquement des pilotes pendant les heures d'obscurité et de jour.
Une attention particulière devra être accordée à la visibilité de la ligne dans différentes conditions de visibilité, notamment la pluie, la neige et le grésil, le brouillard et la brume.
La ligne d'accostage des jetées comme ligne de dégagement
Les pilotes ont découvert que la jetée du terminal GNL sert de ligne de dégagement pour l'épave près de la bouée TT6 et que, par conséquent, tout feu fixe sur la jetée devrait en tenir compte.
Observation de l'environnement en temps réel
Une surveillance environnementale en temps réel est nécessaire pour garantir que les informations minimales suivantes soient fournies :
- Capteurs de brouillard à la zone d'embarquement des pilotes et au terminal
- Capteurs de vent, de vagues et de courant sur la zone d'embarquement des pilotes et au terminal
Considérations complémentaires
Carte 4234 du Bureau hydrographique du Canada
La carte 4234 doit être révisée, ou une nouvelle carte doit être établie, pour indiquer l'approche du port de Country Harbour au centre de la feuille, de sorte que les approches du port de Country Harbour depuis la mer et les risques offshore pertinents soient indiquées sur une seule feuille. Il est actuellement nécessaire de consulter également d'autres cartes, telles que la carte 4233, pour avoir une vue d'ensemble de l'approche. Cela constitue une exigence de sécurité essentielle.
Les autres révisions qui sont susceptibles d'être nécessaires sont les suivantes :
- La carte devra éventuellement être mise à jour pour tenir compte du ou des relevés bathymétriques effectués pour le projet GNL Goldboro.
- L'épave cartographiée près de la bouée TT6 peut exiger une bouée d'épave et la bouée TT6 peut nécessiter un enlèvement.
- Un « pas d'ancrage » peut être exigé pour mieux définir les gazoducs sous-marins de Deep Panuke et de l'île de Sable à une échelle appropriée, carte à grande échelle munie d'un carton intérieur.
Aides à la navigation existantes
Il est nécessaire d'examiner davantage s'il existe un risque que l'une des aides flottantes existantes induise en erreur les manutentionnaires de navires à l'approche et au départ du terminal GNL. Par exemple, certaines marques latérales, telles que la bouée TT4, sont mieux remplacées par des marques cardinales.
Transfert de pilotage à distance
La possibilité que des opérations d'embarquement et de débarquement de pilotes se déroulent dans la baie de Chedabucto (Canso) doit être envisagée si ces opérations ne peuvent avoir lieu ailleurs qu'au port de Country Harbour.
Annexe 6 : Glossaire
Aides à la navigation - Dispositifs ou systèmes qui :
- Aident les marins à trouver leur position et leur route;
- Signalant de dangers ou d'obstacles; ou
- Présentent généralement la meilleure route à travers une voie d'eau.
Système d'identification automatique des navires (SIA) – Le SIA fournit automatiquement des informations aux stations côtières équipées, aux autres navires et aux avions. Ces données peuvent inclure l'identité, le type, la position, le cap, la vitesse, l'état de la navigation et d'autres informations relatives à la sécurité du navire.
Eau de lest - Eau, avec des matières en suspension, transportée à bord d'un navire depuis un plan d'eau afin de :
- Contrôler l'assiette ou les angles de gîte
- Augmenter son tirant d'eau
- Régler sa stabilité
- Maintenir les charges de stress dans des limites acceptables
Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast – En vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande au Canada, ces règlements régissent la manière de gérer les eaux de ballast de tous les navires qui arrivent au Canada en provenance de l'extérieur de la zone économique exclusive canadienne.
Loi sur la marine marchande au Canada, 2001 (LMMC, 2001) – La LMMC, 2001, est la principale loi qui réglemente la sécurité du transport maritime et la protection de l'environnement marin. Cela :
- Trouve un équilibre entre la sécurité du transport maritime et la protection de l'environnement marin tout en encourageant le commerce maritime.
- Concerne tous les navires naviguant dans les eaux canadiennes et les navires canadiens dans le monde entier. Dans certains cas, notamment en cas de pollution, elle s'applique également aux navires étrangers dans la zone économique exclusive du Canada.
Eaux canadiennes - la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada
Sociétés de classification - ces organismes veillent à ce que les navires soient sécuritaires. Par exemple, le Lloyd's Register (LR), l'American Bureau of Shipping (ABS) et Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV-GL) inspectent, vérifient et garantissent que les navires sont construits, entretenus et exploités conformément aux règles, réglementations et normes établies.
Code de pratique - ligne directrice élaborée ou adoptée par le ministre de l'Énergie ou l'administrateur et, en ce qui concerne une usine de GNL, désigne le code de pratique de la Nouvelle-Écosse pour les usines de GNL, telles que modifiées, publié par le ministère de l'Énergie et des mines de la Nouvelle-Écosse.
Règlement sur les abordages - En vertu de la LMMC, 2001, des règles basées sur la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer que les navires doivent respecter pour prévenir les abordages dans les eaux canadiennes.
Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG) – publié par l'Organisation maritime internationale (OMI) et énonce, entre autres, les « règles de route » ou les règles de navigation que les navires et autres navires doivent respecter en mer pour éviter les collisions entre deux ou plusieurs navires.
Système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) – Un système informatique de renseignements sur la navigation, avec des dispositifs de sauvegarde adéquats, qui répond aux normes de l'Organisation maritime internationale. Il affiche des informations tirées de cartes de navigation électroniques ou de cartes nautiques numériques et intègre des informations de position provenant du système mondial de navigation par satellite et d'autres capteurs de navigation, tels que le RADAR et les systèmes d'identification automatique (SIA). Il permet au marin de planifier et de surveiller son itinéraire, et d'afficher des informations supplémentaires relatives à la navigation si nécessaire.
Remorqueur d'escorte - Un navire qui aide et accompagne un autre navire. Certains remorqueurs d'escorte se fixent à un autre navire pour offrir un niveau de service différent.
État du pavillon – Pays où est immatriculé un navire, souvent un navire de mer. Un État du pavillon établit les normes de sécurité et les exigences en matière de prévention de la pollution qui sont applicables aux navires battant son pavillon.
Projet Goldboro GNL (Goldboro) - Le projet Goldboro GNL est une installation de traitement de GNL avec des réservoirs de stockage et des travaux maritimes qui se trouvent dans le parc industriel de Goldboro dans le comté de Guysborough, en Nouvelle-Écosse, au Canada.
Système de commandement des incidents (SCI) - un système standardisé de gestion des incidents sur place, couvrant tous les risques, qui offre aux utilisateurs une structure organisationnelle intégrée pour répondre aux complexités et aux exigences d'un ou de plusieurs incidents sans être entravé par les frontières juridictionnelles.
Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Code IGC) - Norme internationale qui permet de transporter de manière sûre des gaz liquéfiés en vrac et d'autres substances (énumérées au chapitre 19 du Code) par mer. Le code explique les normes de conception et de construction des navires impliqués dans ce type de transport et les équipements qu'ils doivent transporter pour minimiser le risque pour le navire, son équipage et l'environnement, en fonction de la nature des produits concernés.
Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires - Adoptée en 2004, cette convention vise à empêcher la propagation d'organismes aquatiques nuisibles d'une région à l'autre, en :
- Élaboration des normes et des procédures de gestion et de contrôle des eaux de ballast et des sédiments des navires.
- Exiger de tous les navires en trafic international qu'ils gèrent leurs eaux de ballast et leurs sédiments selon une procédure déterminée, conformément à un plan de gestion des eaux de ballast spécifique au navire.
- Exiger que tous les navires soient munis d'un certificat international de gestion des eaux de ballast.
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention « Hydrocarbures de soute ») - L'OMI a adopté la Convention « Hydrocarbures de soute » en mars 2001, qui a instauré une responsabilité stricte pour les propriétaires de navires (soutenue par une assurance obligatoire) afin de fournir une couverture pour les déversements d'hydrocarbures de soute provenant de leur navire. Les hydrocarbures de soute sont les combustibles qu'un navire utilise pour sa propulsion ou pour ses opérations. Les modifications apportées à la Loi sur la responsabilité maritime pour faire respecter la Convention sur les hydrocarbures de soute ont reçu la sanction royale en juin 2009. Par la suite, le Canada a ratifié la Convention sur les hydrocarbures de soute, qui est entrée en vigueur en janvier 2010.
Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, (Convention SNPD) – Adoptée par l'OMI en 2010. Cet accord est issu du modèle pour les dommages de pollution causés par les déversements d'hydrocarbures persistants provenant de navires-citernes. Une fois en vigueur, il instaurera un système à deux niveaux pour indemniser les demandeurs en cas d'accident en mer causé par un navire et impliquant des substances nocives pour la santé.
Convention internationale pour la prévention de la pollution causée par les navires (MARPOL) – Le plus grand accord international visant à prévenir la pollution marine par les navires.
Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (Convention OPRC) – Adopté en 1990, l'accord OPRC vise à établir un cadre mondial de coopération internationale pour faire face aux incidents majeurs ou aux menaces en matière de pollution marine. Les pays qui ont signé cette Convention, dont le Canada, doivent instaurer des processus pour traiter les incidents de pollution, soit au niveau national, soit en coopération avec d'autres pays.
Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) – Cet accord établit des normes de formation, de certification et de surveillance des équipages de navires que les pays doivent respecter ou dépasser.
Organisation maritime internationale (OMI) – Établie en 1948 lors d'une conférence internationale à Genève, la convention de l'OMI est en vigueur depuis 1958 et la nouvelle organisation s'est réunie pour la première fois l'année suivante. La mission principale de l'OMI a été de développer et de maintenir un cadre de réglementation complet pour le transport maritime. Aujourd'hui, ses activités portent sur la sécurité, les préoccupations environnementales, les questions juridiques, la coopération technique, la sécurité maritime et l'efficacité du transport maritime. Le Canada est l'un des 174 États membres de l'OMI.Note de bas de page 70 Quand l'OMI conclut un accord, les États membres (comme le Canada) établissent des cadres réglementaires nationaux pour le secteur du transport maritime. Il y a plus de 50 conventions de l'OMI qui couvrent un large éventail de sujets. Les conventions sont intégrées dans le système de sécurité et de sûreté maritime du Canada, y compris la LMMC, 2001.
Gaz naturel liquéfié (GNL) – Le GNL est le gaz naturel à l'état liquide. Lorsqu'il est refroidi à environ -160 °C (-260 °F) à pression atmosphérique, le gaz naturel se transforme en un liquide clair, incolore et inodore. Le GNL est non toxique, cryogénique et est classifié comme une substance dangereuse et nocive par l'OMI. Dans son état liquide, le GNL représente environ 1/600e du volume de gaz naturel, ce qui assure un transport efficace dans des navires spécialement conçus à cet effet.Note de bas de page 9
Services de communication et de trafic maritimes (SCTM) – Un programme de la GCC qui offre des services de communication radio de sécurité, des informations sur le trafic maritime et un service commercial d'appel téléphonique maritime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rend le ministre du MPO responsable de la gestion et des opérations des SCTM.
Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM) – En vigueur depuis août 2001, la LRMM est la loi principale traitant de la responsabilité des propriétaires et des exploitants de navires en matière de passagers, de cargaison, de pollution et de dommages matériels. Cette loi fixe des limites de responsabilité et assure l'uniformité en équilibrant les intérêts des propriétaires de navires et des autres parties. La LRMM a pour effet de donner force de loi à de nombreuses conventions internationales de l'OMI.
Metocean – Données météorologiques et océanographiques
Régime canadien de préparation et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures – Établi en 1995 en tant que partenariat entre le gouvernement et l'industrie. En tant que régulateur fédéral principal, TC établit les lignes directrices et la structure réglementaire pour la préparation et l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en milieu marin.
Loi sur les eaux navigables canadiennes – La loi qui approuve et réglemente les travaux et les obstacles qui risquent de porter atteinte au droit public de navigation dans les eaux navigables énumérées à l'annexe de la loi.
Service des Avertissements de navigation (NAVWARN) – Lancé en 2019, le nouveau service des avertissements de navigation (NAVWARN) remplace le service d'avis à la navigation (NOTSHIP) offert par la GCC. Ce service informe la communauté maritime des dangers, des activités en cours et d'autres informations pertinentes comme les modifications des aides à la navigation, les zones de pêche, les exercices militaires, le dragage ou d'autres obstacles maritimes.
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) : Constituée en 1970, cette association volontaire regroupe toutes les grandes compagnies pétrolières du monde et la plupart des compagnies pétrolières nationales. L'OCIMF :
- Encourage la conception et l'exploitation sécuritaires des pétroliers et des activités des terminaux liés au pétrole brut, aux produits pétroliers, aux produits pétrochimiques et au gaz.
- A pour objectif d'être l'autorité en matière d'exploitation sécuritaire et écologique des pétroliers et des terminaux pétroliers.
- Défend régulièrement les points de vue de l'industrie à l'OMI; et
- Il est un ardent défenseur des normes et des réglementations en matière de sécurité maritime.
Mémorandum d'entente de Paris (MOU) – Un accord international entre 27 administrations maritimes, y compris le Canada. Cet accord concerne les eaux de l'Europe côtière et du bassin de l'Atlantique Nord, de l'Amérique du Nord à l'Europe. Son objectif est de :
- Empêcher les navires non conformes aux normes de naviguer grâce à un système de contrôle par l'État du port qui assure que tous les navires répondent aux normes internationales de sécurité, de sûreté et d'environnement.
- Assurer que les membres de l'équipage bénéficient de conditions de vie et de travail adéquates.
Pieridae Energy (Canada) Ltd. – Pieridae Energy (Canada) Ltd. (Pieridae) est le promoteur du projet GNL Goldboro. Elle est une société canadienne cotée en bourse dont le siège social est à Calgary, en Alberta, avec des bureaux à Québec et à Halifax. Fondée en 2011, cette société développe des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL), depuis l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel jusqu'au développement et à l'exploitation d'un terminal GNL completNote de bas de page 71.
Règlement sur le pilotage (Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique) - Règlement qui exige que les navires circulant dans des eaux particulières aient à leur bord un pilote maritime ayant des connaissances du milieu pour les guider en toute sécurité jusqu'à leur destination.
Loi sur le pilotage - Cette loi, créée en 1972 et mise à jour en 1998, a établi quatre administrations de pilotage qui exploitent, maintiennent et administrent le service de pilotage dans leurs régions respectives. Entre autres choses, cette loi permet aux autorités de pilotage d'établir, avec l'approbation du gouverneur en conseil, des zones de pilotage obligatoire où les navires doivent amener des pilotes à bord.
Contrôle des navires par l'État du Port - Programme d'inspection des navires créé par l'OMI, dans le cadre duquel les pays qui partagent des eaux acceptent de contrôler les navires étrangers pour vérifier qu'ils respectent les accords internationaux relatifs à leur état, leur équipement, leur équipage et leurs opérations. Le contrôle des navires par l'État du port est la principale méthode utilisée par TC pour s'assurer que les navires respectent la LMMC, 2001, la Loi sur la sûreté du transport maritime et d'autres accords internationaux pertinents.
Promoteur - la personne, l'organisme, l'autorité fédérale ou le gouvernement qui propose la réalisation d'un projet désigné. (promoteur)
Règlement sur les organismes d'intervention et les installations de manutention des hydrocarbures - En vertu de la LMMC, 2001, les règles concernant les procédures, l'équipement et les ressources des organismes d'intervention et des installations de manutention lors d'un incident de pollution par les hydrocarbures.
Programme de rapport d'inspection des navires (SIRE - Ship Inspection Report Programme) - Lancé en 1993 par Oil Companies International Marine Forum pour répondre aux préoccupations concernant les navires non conformes aux normes, il sert d'évaluation des risques des pétroliers pour les affréteurs, les exploitants de navires, les exploitants de terminaux et les organismes gouvernementaux concernés par la sécurité des navires. Le programme gère une très grande base de données contenant des informations récentes sur les navires-citernes et les barges.
Society of International Gas Tankers and Terminal Operators (SIGTTO) - Cette société à but non lucratif a été enregistrée aux Bermudes en octobre 1979. La société a plus de 170 membres à part entière et membres associés qui représentent la quasi-totalité du secteur mondial du GNL et plus de la moitié du secteur mondial du GPL. La société :
- C'est une voix qui fait autorité dans le domaine du transport maritime et des terminaux de gaz liquéfié.
- Définit et fait la promotion des normes et des meilleures pratiques parmi les membres de l'industrie mondiale, afin de maintenir la confiance dans la sécurité des industries du gaz liquéfié et de promouvoir leur acceptation en tant que partenaires industriels responsables.
- Un statut d'observateur auprès de l'Organisation maritime internationale (OMI).
- Une réputation d'intégrité et d'impartialité dans le traitement des questions opérationnelles et de sécurité.
SOLAS – Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer – Ce traité international sur la sécurité maritime exige que les États du pavillon s'assurent que leurs navires respectent des normes minimales de construction, d'équipement et d'exploitation. Il a été initialement adopté en 1914, en réponse à la catastrophe du Titanic.
Droit de tirage spécial - Dans ce cas, toutes les parties impliquées dans les opérations de manœuvre doivent être informées des problèmes éventuels avant de commencer les manœuvres d'arrivée ou de départNote de bas de page 72.
TERMPOL – « Processus d'examen technique des systèmes de terminaux maritimes et des sites de transbordement. » Il existe depuis la fin des années 1970, où un comité interministériel chargé d'examiner les questions de pollution marine a identifié la nécessité de disposer d'un moyen fiable pour mesurer les risques de navigation liés à la mise en place et à l'exploitation de terminaux maritimes pour les grands pétroliers. TERMPOL est un processus d'examen volontaire qui peut être exigé par un promoteur impliqué dans la construction et l'exploitation d'un système de terminal maritime pour la circulation de pétrole, de produits chimiques et de gaz liquéfiés en vrac. Il est axé sur les aspects du transport maritime d'un projet proposé.Note de bas de page 2
Comité d'examen TERMPOL (CET) – Sous la présidence de TC, les membres du CET proviennent de ministères et d'autorités ayant des compétences en matière de réglementation, de programmes et de services maritimes. Le CET du projet Goldboro GNL est composé de représentants de TC, MSS, MPO, GCC, SHC et Gestion des écosystèmes, ECC, Comté de Guysborough et APP.
Mer territoriale du Canada - En général, les eaux canadiennes s'étendent jusqu'à 12 milles nautiques de la côte. La définition formelle se trouve dans la Loi d'interprétation et la Loi sur les océans.
Tonne - Également connue sous le nom de tonne métrique (mt), unité de mesure égale à 1 000 kilogrammes.
Règlement sur la pollution par les navires et les produits chimiques dangereux – Dans le cadre de la LMMC, 2001, les règles établissent des normes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le pétrole, les eaux usées, les déchets et la pollution de l'air par les navires.
Services de trafic maritime (STM) - Un système d'échange d'informations entre les navires et un centre basé à terre. Le système STM du Canada est dirigé par la GCC. Les opérateurs sont des officiers des Services de communication et de trafic maritime (SCTM) désignés qui contrôlent les mouvements des navires en utilisant un réseau de radio VHF (très haute fréquence), un RADAR de surveillance, un système d'identification automatique (SIA), un équipement de radiogoniométrie et un réseau informatique de gestion du trafic maritime et de suivi du système d'information.
Règlement sur les zones de services de trafic maritime – En vertu de la LMMC, 2001, ils définissent les exigences imposées aux navires canadiens et étrangers en matière de communication d'informations avant d'entrer dans les eaux canadiennes, de les fréquenter et de les quitter.
Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF – En vertu de la LMMC, 2001, ils ont défini les procédures de bord pour l'utilisation des radiotéléphones en VHF de poste à poste pour aider à la sécurité de la navigation.
Eaux de compétence canadienne – Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, définies dans la Loi sur les océans et la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
*Remarque : Vous pouvez consulter le texte intégral des lois et règlements canadiens.
Il suffit de préciser le nom de la loi ou du règlement dans la zone de recherche située dans le coin supérieur droit de l'écran.
Annexe 7 : Acronymes et abréviations
- SIA
- Systèmes d'identification automatique
- APA
- Administration de pilotage de l'Atlantique
- COLREG
- Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer
- LMMC, 2001
- Loi sur la marine marchande du Canada, 2001
- EE
- Évaluation environnementale
- CEE
- Certificat d'évaluation environnementale
- GIIGNL
- Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié
- HAZID
- Analyse d'identification des dangers
- SNPD
- Substances nocives et potentiellement dangereuses
- IACS
- Association internationale des sociétés de classification
- IGC
- Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement de navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac
- OMI
- Organisation maritime internationale
- KPI
- Indicateurs clés de performance
- GNL
- Gaz naturel liquéfié
- TGNL
- Transporteur de GNL
- MARPOL
- Convention internationale pour la prévention de la pollution causée par les navires
- SCTM
- Services de communication et de trafic maritime
- LRMM
- Loi sur la responsabilité en matière maritime
- MOF
- Installation de déchargement des matériaux
- MSRA
- Analyse des risques pour la sécurité maritime
- mt
- tonne métrique (tonne)
- MTPA
- Millions de tonnes par an
- NAVWARN
- Service des Avertissements de navigation (remplace le Service d'avis à la navigation (NOTSHIP))
- nm
- mille nautique
- NSE
- Ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse
- OCIMF
- Oil Companies International Marine Forum
- PIANC
- The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (anciennement l'Association internationale permanente des congrès de navigation (PIANC)
- PRMM
- Examen de la méthodologie de gestion des risques de pilotage
- OI
- Organismes d'intervention
- DTS
- Droit de tirage spécial, aussi appelé DTX
- SIGTTO
- Society of International Gas Tanker and Terminal Operators
- SIRE
- Ship Inspection Report Programme (programme de rapport d'inspection des navires)
- SOLAS
- Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
- SOPEP
- Plan d'urgence en cas de pollution marine à bord des navires
- SSOPF
- Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
- STCW
- Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
- TERMPOL
- Processus d'examen technique des systèmes de terminaux maritimes et des sites de transbordement.
- TMSA
- Programme d'auto-évaluation de la gestion des pétroliers
- CET
- Comité d'examen TERMPOL
- DSQ
- dégagement sous quille
- VHF
- Très haute fréquence
- STM
- services de trafic maritime
- DTX
- Droit de tirage spécial, aussi appelé DTS
Annexe 8 : Liste de références
- Loi maritime du Canada, Lois du Canada (1998, c.10)
- Loi sur la marine marchande du Canada, 2001, Lois du Canada (2001, c.26)
- Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada (SOR/89-99)
- Évaluation environnementale pour le projet GNL de Goldboro, Ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse (en anglais seulement)
- Guidance on Risk Analysis and Safety Implications of a Large Liquefied Natural Gas (LNG) Spill Over Water. Laboratoires Sandia, 2004. Albuquerque, Nouveau-Mexique
- Pêches et Océans Canada, Water levels, Isaac's Harbour NS, 2019 Tide Tables
- Organisation maritime internationale. Code pour la construction et le matériel des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, version de 1983. London: Organisation maritime internationale, 1983.
- Organisation maritime internationale. Code pour les navires existants transportant des gaz liquéfiés en vrac. London: Organisation maritime internationale, 1976.
- Organisation maritime internationale. Code international pour la construction et le matériel des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Code IGC), version de 1993. London: Organisation maritime internationale, 1993.
- Organisation maritime internationale. Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, 2010 (2010 Convention SNPD)
- Organisation maritime internationale. Protocole sur la préparation, la réaction et la coordination en cas d'incidents de pollution par des substances nocives et potentiellement dangereuses, 2000 (Protocole OPRC-HNS). London: 2000.
- Organisation maritime internationale.Convention internationale pour la prévention de la pollution causée par les navires (MARPOL)
- Organisation maritime internationale. Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)
- Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, entreposage et manutention, CSA Z276-15, janvier 2015 CSA Group, Toronto, Canada
- Loi sur la responsabilité en matière maritime, Lois du Canada (2001, c. 6)
- Ressources naturelles Canada, gaz naturel liquéfié
- Règlement sur la sécurité de la navigation (SOR/2005-134)
- Aides radio à la navigation maritime 2019, (Atlantique, Saint-Laurent, Grands Lacs, lac Winnipeg, Arctique et Pacifique), publié sous l'autorité du directeur général, Opérations, MPO, GCC
- Groupe d'experts sur la sécurité des navires-citernes. Un examen de la préparation et de l'intervention du Canada en cas de déversement accidentel provenant d'un navire : Fixer le cap pour l'avenir, Phase II, Exigences pour l'Arctique et pour les substances dangereuses et nocives au niveau national (2014).
- Groupe d'experts de la Société royale du Canada : Les impacts environnementaux et le comportement du pétrole brut rejeté dans les milieux aqueux (PDF, 7,3 Mo, en anglais seulement), Ottawa, novembre 2015
- Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l'est du Canada, 2015, TP 15163
- Pilotage Risk Management Methodology (PRMM), TP 13741
- Processus d'Examen TERMPOL2014 (TP 743) (12/2014). Processus d'examen TERMPOL TP 743, 2019 (PDF, 877 Ko)
- Règlement sur la pollution par les navires et les produits chimiques dangereux (SOR/2012-69)
- Règlement sur les zones de services de trafic maritime (SOR/89-98)